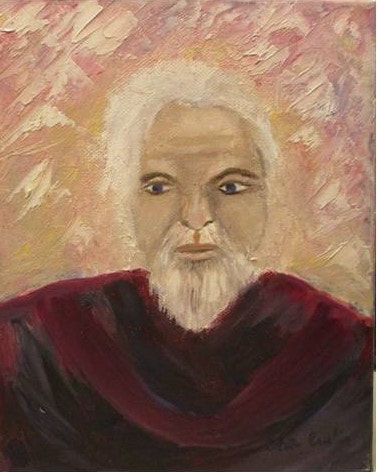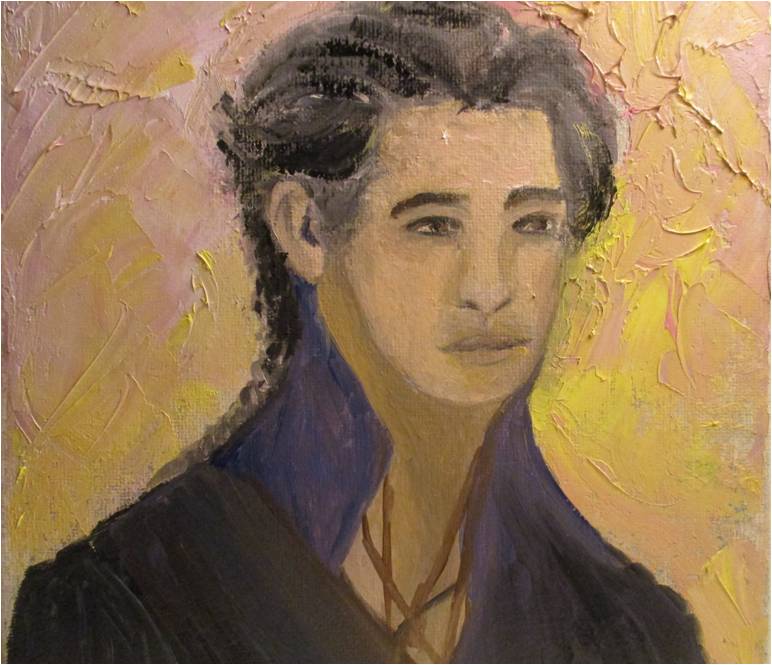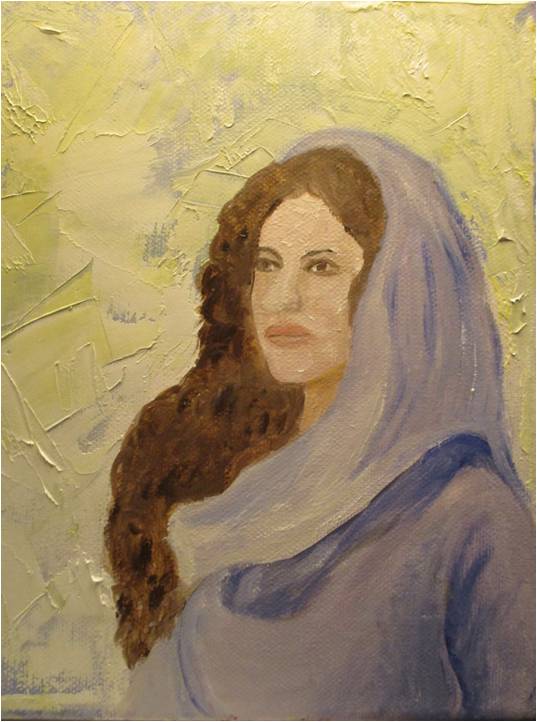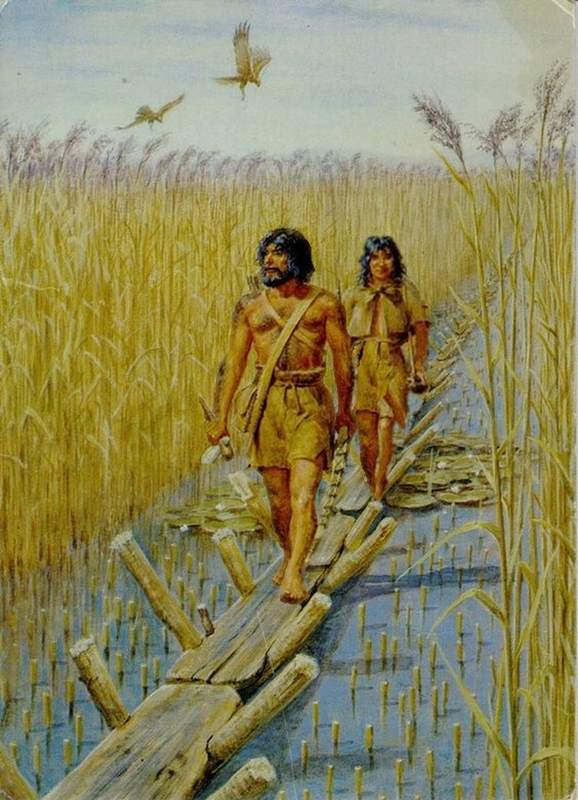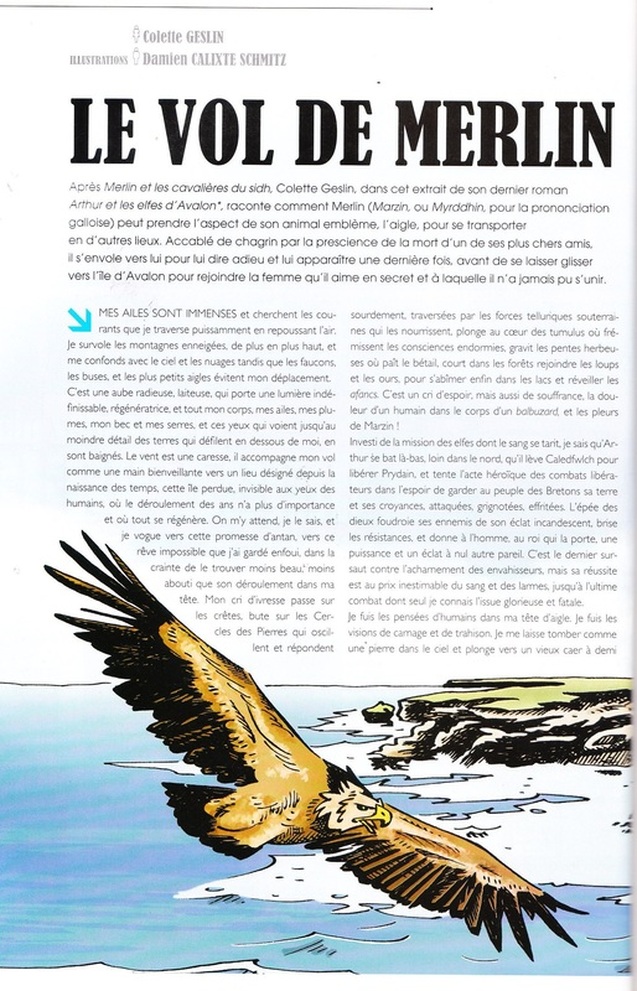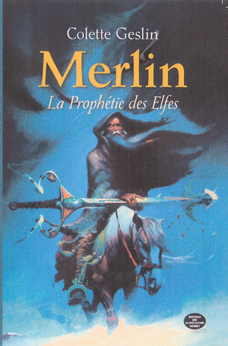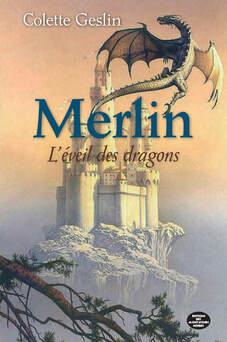Extraits de romans
Extrait : Le loup du Ménez Hom, février 2022

Domaine de Trévélec- Ysaure- 1460
–Je n'épouserai pas ce...ce Kermazan!
Abasourdie et en colère, je me suis dressée pour la première fois contre mon père qui me regarde d'un air furieux. Ma mère, presqu'invisible derrière lui et en retrait comme toujours, ne dit rien et je cherche en vain son regard et sa protection.
La gifle me fait perdre l'équilibre et je n'entends plus les voix que dans un brouillard. Je ferme les yeux sous le coup qui m'atteint à la joue et à l'oreille et j'essaie en vain de me rattraper à quelque chose de solide. Tout tourne autour de moi, je perçois juste la voix de mon père qui sort en claquant la porte: "c'est un ordre".
Déséquilibrée et embarrassée dans mes jupons, je tombe en arrière sur le sol, foudroyée par son regard noir. Et ce regard-là, je ne suis pas prête de l'oublier tant il contient de fureur, certes, mais aussi d'une sorte de haine que je ne comprends pas.
Mon père disparu, ma mère s'est avancée pour me soutenir, mais son visage ravagé de chagrin me montre son impuissance, sa terreur à l'idée de l'affronter. Je sais trop bien qu'elle ne le fera pas et pliera, comme toujours, face à sa volonté.
Je commence seulement à percevoir que sa vie n'a pas dû être heureuse ni calme auprès de cet homme embourbé dans sa morgue, son autorité, son manque absolu de tendresse et d'empathie pour les autres.
Il décide, il ordonne, il punit. C'est ainsi que je l'ai toujours connu. D'un seul coup, malgré mon chagrin et ma peur de devoir quitter cette demeure pour je ne sais où, je me demande si, après tout, je ne serais pas plus heureuse ailleurs.
Mon père m'a vendue aujourd'hui! Pour se débarrasser d'une fille encombrante ? Pour laisser de la place à mon jeune frère ? Et je ne sais pour quelle autre raison qu'on ne m'explique pas, bien entendu.
Je ne connais même pas l'homme destiné à être mon époux et futur maître. Je ne sais pas quel visage il a, s'il est jeune ou vieux. On ne m'a rien dit. Juste que je dois l'épouser et quitter le castel dans quelques jours.
Terrifiée, je me suis tournée vers ma mère, mais elle a fui mon regard suppliant, car elle ne s'est jamais opposée à une décision de mon père. Je sais que je n'ai aucun secours à attendre d'elle, pas plus que de quiconque car chacun au castel est soumis aux ordres du seigneur de Trévélec.
Dans ma chambre, les domestiques font déjà mes bagages en silence, et ma vieille nourrice me regarde à la dérobée d'un air désolé, sans savoir comment me consoler, ni me rassurer. Comment le pourrait-elle d'ailleurs, puisqu'elle ne sait même pas qui est cet homme dont je vais désormais devoir partager la vie et le lit?
Je sais juste qu'il vit dans un castel au bord de la mer, à l'ouest de la Bretagne, dans une région rocheuse, battue par les vents marins.
Si j'ai un jour rêvé de partir au bras d'un époux aimant et attentionné, en espérant que ma vie changerait, en mieux, je ricane maintenant tout bas, car ce sont des contes, comme dit ma nourrice.
–Tu partiras dès que ton escorte sera arrivée, m'a annoncé froidement mon père.
Puis il a tourné les talons, désamorçant toute discussion, toute question de ma part, d'un air agacé, comme s'il avait hâte de se débarrasser de moi. Je n'ai pas pleuré devant lui, mais maintenant, en regardant les femmes vider ma chambre, j'ai peine à retenir mes larmes.
Ma mère n'est pas venue me voir pour me consoler, ou me donner une explication à cette décision. Sans doute mon père le lui a-t-il interdit. Je me demande si elle a jamais osé lui tenir tête un jour. Je l’ai toujours vue baisser les yeux sous son regard glacial, s'incliner, sans récriminer, quels que soient ses ordres. Car ce sont bien des ordres que mon père lui donne, jamais autre chose, jamais une discussion chaleureuse entre eux, courtoise, bienveillante. Toujours cet air cassant, autoritaire, hautain, qu'il a envers chacun de nous.
Seul mon jeune frère Aubin trouve grâce à ses yeux, mais il n'a que six ans. Il serait né de façon accidentelle, enfin c'est ce que tout le monde pense en secret, car mes parents vivent à part, chacun dans sa tour, chacun dans sa chambre. Raoul de Trévélec ne doit pas traverser souvent le corridor qui conduit à celle de son épouse.
–Emballez ma harpe, dis-je. Je veux l'emporter.
J'aime la musique et j'aurai au moins la consolation de jouer lorsque je serais trop seule. A moins que cela ne me soit interdit par cet homme qui va régenter ma vie.
Que faire pour refuser cette union? Fuir! Mais où? Avec quelle aide? Et chez qui me réfugier? Personne n'oserait tenir tête au seigneur de Trévélec. Seule, peut-être, ma tante Louise, sœur aînée de ma mère, serait assez téméraire pour s'opposer à lui. Mais elle habite sur la côte, près de Kemper, et ne doit même pas savoir ce qui se trame ici. Je ne l'ai vue que quelques fois dans mon enfance et je ne souviens même plus de son visage. Mon père s'est bien gardé de la prévenir et je ne sais pas le pourquoi de leur inimitié. On la dit riche, titrée, et deux fois veuve! Elle connaît les personnes influentes à la cour du duc, et peut-être pourrait-elle agir pour me tirer de ce guêpier. Mais il sera bien trop tard lorsqu'elle en sera informée. Je serai déjà mariée et prise au piège à jamais.
Je sais que mon père ne l'aime pas, qu'il fustige la vie qu'elle mène, sans doute trop libre selon ses principes rigides, et il lui a interdit notre demeure, empêchant ainsi ma mère, qui se désole en secret, de revoir sa sœur, pour de sombres raisons que l'on n'a jamais voulu m'expliquer.
Je ne suis pas descendue pour le souper. Je ne veux pas les voir, ni l'un ni l'autre, et mon père, bizarrement, ne m'a pas fait chercher, comme s'il craignait un esclandre, des pleurs, des cris, tout ce dont il a horreur de la part des femmes.
Ma mère le sait bien, qui ne pleure qu'en secret et évite de lui montrer des yeux rouges lorsqu'il revient au castel.
Une domestique compatissante m'apporte un repas léger, un reste de viande froide, une purée de navets, des galettes au miel.
Je mange du bout des lèvres, le cœur chaviré. Puis une servante vient frapper à ma porte pour m’apporter un coffret.
–Dame Ysa vous envoie quelques bijoux en vous conseillant de bien les cacher et de les utiliser si vous en avez besoin un jour. Ce sont ceux qui faisaient partie de sa dot. Elle voudrait pouvoir vous aider autrement, mais...
–J'ai compris, dis-je d'un ton froid. Remerciez-la puisqu'elle n'a pas jugé bon de venir me voir avant mon départ.
–Elle est triste, je vous assure, damoiselle. Mais votre père n'a rien voulu entendre de ses objections.
–Je m'en doute, dis-je en haussant les épaules. Quand diable a-t-il écouté quelqu'un?
La servante repartie je mis une mante et un capuchon sur ma tête et je descendis rapidement les escaliers pour traverser la cour et me rendre dans le bâtiment où logeaient les serviteurs. Erin était là, près de son feu qu'elle remuait pensivement, et elle leva la tête à mon entrée.
–Viens t'asseoir, Ysaure. Le feu m'a révélé quelque chose que je ne comprends pas bien...
Elle semblait perplexe, ce qui m'intrigua, car son don de divination était habituellement assez clair, même s'il ne l'était pas pour celui ou celle qui la consultait. C'était une étrange femme, et l’on ne savait trop d'où elle venait. Je devais avoir un peu plus de cinq années lorsqu'elle était apparue un jour, s'était installée dans une manse inoccupée du hameau, et était restée comme guérisseuse. Ma mère, cette fois, avait affronté son époux, qui, étonnamment, avait plié sous son exigence, pour accepter sa présence. Je me doutais bien, le connaissant maintenant, qu'il avait dû lui faire payer cher sa désobéissance ensuite, mais elle n'en avait jamais soufflé mot.
Je vins m'asseoir près d'elle, sur un coussin à même le sol, tandis qu'elle continuait à observer le feu.
–Tu vas partir, dit-elle enfin.
Ce n'était pas une question, elle avait déjà compris.
Je haussai les épaules.
–Mon père me fait épouser un homme que je ne connais même pas, et qui vit à l'autre bout du pays. Cet homme-là envoie quelqu'un me chercher, d'après ce que j'ai compris. Personne ne m'accompagne non plus jusque chez lui. Je crois que mes parents veulent se débarrasser de moi.
Erin fixa son regard sur moi mais j'eus l'impression qu'elle ne me voyait pas vraiment.
–Il y a un homme...mais...fais attention à lui, Ysaure. Il est puissant. Combatif et dangereux.
–Est-ce...celui que je dois épouser?
Erin fronça les sourcils.
–Ce sera à toi de comprendre. Tu vas te métamorphoser, apprendre...combattre aussi...
–Erin, je ne suis pas un guerrier...protestai-je.
–Tu auras tes propres armes, ma fille, fais-leur confiance.
–Mais pourquoi m'envoyer si vite dans un endroit si éloigné ? Je n'ai jamais vu, ni entendu parler du seigneur de Kermazan! Je pensais épouser...
–Qui donc? grimaça Erin. L'écuyer de ton père, peut-être? Ysaure, ce n'est pas ton destin, ma fille...
–Oui, eh bien, pour l'instant, mon destin est d'être vendue comme de la marchandise. Personne ne tient compte de ce que veulent les femmes! Obéir! Toujours obéir et plier devant ce qu'ordonnent les hommes, criai-je sourdement en colère.
–Tu choisiras un jour, ma fille. Et ce choix sera lourd de conséquences. Rien n'est jamais gratuit. Nos actes ne sont pas anodins, et déclenchent toujours des événements imprévisibles. Souviens-t’ en.
–Erin, ne peux-tu...venir avec moi là-bas? priai-je avec l'espoir insensé d'avoir une présence amie à mes côtés.
–Je ne suis plus assez jeune pour cela, Ysaure. Je n'y vois plus guère. Qui voudrait héberger une vieille femme comme moi? Je dois mourir ici. Ta vie à toi commence demain mon enfant. Va sans crainte. Je te suivrai en pensée. Je vais faire prévenir ta tante Louise. Elle saura te retrouver là où tu seras...
Je compris ainsi qu'Erin était toujours secrètement en relation avec la sœur de ma mère, sans doute en cachette. J'avais un jour surpris une conversation entre elle et ma mère et en avais déduis que c'était cette riche et influente tante Louise qui l'avait envoyée jusqu'à nous nous nous aider et continuer à l'informer de notre vie à Trévélec. Un peu rassérénée, je pris sa main ridée entre les miennes et la portai à mes lèvres.
–Merci Erin! J'essaierai de t'envoyer des nouvelles, dis-je en formant le vœu qu'en effet je serais assez libre pour agir selon mes désirs une fois mariée.
Je remontai dans ma chambre le cœur un peu apaisé, même si je n'avais pas bien compris ce qu'Erin avait essayé de me révéler à mots couverts.
C'était ma dernière nuit de jeune fille dans le castel de mon père.
Mon futur époux, le seigneur de Kermazan, n'avait donc pas daigné venir me chercher chez mon père. Cela montrait bien l'importance qu'il m'accordait! Je fus sidérée lorsque je vis arriver les cavaliers qui devaient m'escorter. Il m'avait envoyé son intendant!
Enfin, je ne savais pas vraiment qui était l'homme qui se présenta à la poterne, entouré de cinq cavaliers fortement armés. Je le pris d'abord pour un simple intendant ou régisseur, mais, lorsqu'il mit pied à terre dans notre cour, je retins mon souffle. Cet homme-là n'était certes pas un serviteur, plutôt un maître d'armes à l'allure inquiétante, puissante et dangereuse. Un homme imposant, aux épaules bien développées, comme j'en avais rarement vu dans l'entourage de mon père. Ses bras nus sous un surcot de cuir révélaient des muscles saillants et impressionnants. Il avait des cheveux longs attachés sur la nuque, une barbe drue et sombre ornait ses joues et son menton et, si ses vêtements n'étaient pas somptueux, ils semblaient de bonne facture et indiquaient tout de suite sa qualité de guerrier. Du cuir, des bottes hautes, une cape sombre. Tout pour impressionner.
Les hommes qui l'accompagnaient semblaient lui obéir sans discuter ses ordres.
De ma fenêtre je vis sortir mon père qui avait sans doute espéré saluer le seigneur de Kermazan, car son visage marquait nettement sa réprobation. L'homme s'avança vers lui et Trévélec retint un mouvement de colère en l'écoutant, puis il tourna les talons et rentra dans le castel. Une servante vint alors me chercher.
–Messire Raoul demande à vous voir damoiselle. L'homme qui vient d'arriver n'est pas votre futur époux, chuchota-t-elle, mais un soldat, et votre père ne semble pas content.
–Le mariage est peut-être annulé, fis-je avec espoir.
Elle haussa les épaules et m'escorta jusqu'à la grande salle où mes parents m'attendaient en compagnie de l'inconnu.
–Ma fille, messire Josse est l'envoyé du seigneur de Kermazan, ton futur époux...qui n'a pas pu se déplacer lui-même. Il préfère que l’union se fasse ici, avant ton départ. Messire Josse sera son représentant.
J'écarquillai les yeux sans comprendre. Comment pouvais-je devenir l'épouse de quelqu'un sans sa présence?
–Cela se pratique parfois lorsque le futur époux est indisponible.
–Et mon futur époux l'est? Indisponible? rétorquai-je d'une voix froide qui fit lever la tête du dénommé Josse qui me regarda droit dans les yeux.
Je ressentis quelque chose d'insolite, alors que je soutenais son regard. Des yeux bleus et froids, autoritaires. L’homme ne devait pas être habitué à la désobéissance. De ses hommes tout au moins. Quant à moi, je n'étais ni un homme, ni un soldat, juste celle qui allait devenir sa châtelaine.
Josse eut ce qui pouvait passer pour un mince sourire. Presque un rictus.
–Il l'est! Il regrette de ne pouvoir se déplacer mais il vous a confiée à moi, et vous serez en sécurité.
Je haussai les épaules.
–Je ne veux pas d'un simulacre d'union...ni de cette union tout court! déclarai-je d'une voix glaciale en leur tournant le dos.
Du moment où je n'allais plus dépendre de mon père, je m'offrais le plaisir de le contrecarrer pour une fois. Il pouvait bien tempêter. J’étais décidée à ne pas lui faciliter la tâche!
J'avais atteint la porte pour sortir et les planter là, lorsque ledit Josse me barra le chemin et s'inclina légèrement.
–Puis-je vous parler damoiselle? Seul!
Je jetai un coup d'œil en arrière pour voir mon père ravaler sa rage, démuni d'arguments pour une fois. Car, si je refusais cette cérémonie grotesque, il ne pourrait pas m'obliger à dire oui à un prêtre! D'ailleurs, que pensait de cette mascarade notre vieux prêtre qui m'avait vu naître et m'avait baptisée, et qui allait devoir procéder à cette union?
Josse me suivit sans rien dire et nous sortîmes dans la cour que je traversai à grands pas, lui toujours sur mes talons. Je longeai les douves pour parvenir dans le petit jardin de simples qui était le territoire d'Erin. Et je m'arrêtai pour lui faire face.
–Bien! Que voulez-vous messire?
–Je comprends que votre père n'a pas été très...franc avec vous, damoiselle. Il semble qu'il ne vous ait pas tout dit!
–Que devait-il me dire...à part m'ordonner d'épouser votre...votre... je ne sais pas ce qu'est le seigneur de Kermazan pour vous, d'ailleurs...
Josse écarta la question d'un geste agacé.
–Il a confiance en moi, c’est pourquoi il m’a envoyé vous escorter avec mes hommes Et vous mettre sous ma protection.
Je haussai les épaules.
Il pouvait toujours me l'affirmer, je n'avais aucun argument pour le contredire.
–Cela ne m'explique pas pourquoi vous devez le représenter...ni pourquoi je suis obligée de l'épouser.
–A cause du duc François II. Il lui a ordonné de se marier dans un délai de deux mois.
–Ah bon! Comme ça, bougonnai-je. Le duc ordonne et le seigneur de Kermazan m'épouse, sans même me connaître, sans m'avoir jamais vue. Je pourrais être bossue...difforme...laide...sorcière...
Josse eut un rire bas et rauque qui me fit frissonner tout à coup.
–Faites voir. Vous n'êtes ni bossue, fit-il en me prenant par le poignet pour me faire tourner, ni difforme... je ne vois rien d'apparent en tout cas...ni laide, ça fichtre non, vous êtes même plutôt...attirante. Enfin je ne sais pas si vous êtes une sorcière, mais toutes les femmes le sont un peu, n'est-ce-pas...lorsqu'il s'agit d'amour? ajouta-t-il plus bas avec une sorte de ricanement.
Je crus avoir mal entendu et je fis une grimace. Qui diable était cet homme que l'on m'envoyait?
–Pourquoi le duc oblige-t-il ce seigneur à se marier ? S'est-il mal conduit? A-t-il tué quelqu'un...et doit-il se racheter? ironisai-je.
–Rien de tout cela, damoiselle. Le nouveau duc veut autour de lui des hommes fiables, avec une famille et des valeurs, sur lesquels il pourra compter pour asseoir son autorité. Kermazan se trouve en un lieu stratégique, à l'ouest de la Bretagne, et vous serez garante de la fidélité de votre époux auprès de lui.
–Eh bien qu'il lui donne donc une damoiselle de sa cour! Et qu'il la choisisse lui-même.
–Votre père a reçu le même ordre du duc, à votre propos! reprit Josse.
–Ah! Et qu'est-ce que le duc leur a accordé pour leur obéissance? fis-je en colère en me sentant au milieu d'un maelström qui tournoyait pour m'engloutir. J'étais devenue un fétu de paille ballotté par des flots ingouvernables.
Josse haussa les épaules.
–Je n’en sais fichtre rien! Mais voyez le bon côté des choses...
–Ah! Parce que vous en voyez un, vous?
–Mais oui. Aujourd'hui vous dépendez de votre père. Vous n'avez guère de liberté. Demain, une fois la dame de Kermazan...
–Je dépendrai de mon époux! Cela changera quoi? fis-je en haussant les épaules, peu décidée à me laisser convaincre.
–Oh! Quantité de choses. Tous les hommes ne sont pas des tyrans. Jaouen de Kermazan n'en est pas un. Il est un peu...disons, secret, et pas du tout enclin à courir les gueuses...si vous me pardonnez l'expression. Il a besoin de quelqu'un comme vous pour l'aider à faire prospérer son domaine.
–N'êtes-vous pas là pour cela vous-même? osai-je.
Josse regarda au loin, avec une crispation des mâchoires. Quelque chose semblait le tourmenter en secret.
–Non! dit-il enfin. Ce n'est pas mon rôle. Je ne suis à Kermazan que pour...entraîner ses hommes à devenir de bons soldats, de bons combattants...s'il en a besoin un jour. Jaouen vous laissera libre d'organiser votre vie, je vous assure.
–Qui êtes-vous exactement?
–Une sorte de mercenaire, si vous voulez, ricana-t-il. J'ai combattu pour tous ceux qui ont bien voulu faire appel à mes services...et pour le duc lui-même!
–Et maintenant vous le faites pour Jaouen de Kermazan?
–Si vous voulez. Il faut parfois savoir...se poser quelque part, dit-il d'un ton laconique. Que voulez-vous faire? Renoncer? Ou obéir au duc, et à votre père?
–Je n'ai envie d'obéir ni à l'un ni à l'autre. Il s'agit de ma vie, fis-je en colère. Et ils disposent de moi comme si j'étais...comme si j'étais...encombrante!
Tout près de moi, Josse m'entoura les épaules, puis se recula tout de suite.
–Pardonnez-moi damoiselle! Je n'avais pas le droit...
–Ce n'est rien. Ne devez-vous pas ...m'épouser demain?
Je l'entendis déglutir et je me réjouis intérieurement de l'avoir surpris.
–Pour le compte de votre maître, bien entendu, ajoutai-je après un instant de silence.
–Ah! Oui. Cela!
–Puis-je vous appeler Josse?
–Euh! Oui, bien entendu. C'est mon nom.
–Faut-il vraiment...enfin, cette union doit-elle se dérouler de cette façon?
Il ne répondit pas tout de suite et se baissa pour ramasser une feuille de gentiane.
–C'est ce qui m'a été demandé, en effet! Remplacer Jaouen de Kermazan le temps de...votre serment.
–Je ne savais pas que cela était possible.
–Oh! Plusieurs unions de princes et de rois l'ont été de cette façon, lorsque le futur époux était trop éloigné...
–Mais Jaouen de Kermazan n'est qu'à l'autre bout de la Bretagne!
–C'est vrai.
–Il aurait donc pu venir lui-même.
–Eh bien...Il se racla la gorge et, un peu sceptique, j'attendis son explication.
–Il s'est blessé profondément à la jambe et ne peut monter à cheval pour honorer sa promesse au duc François.
Josse ne me répondait plus que du bout des lèvres et je sentais son embarras.
–Je vois, constatai-je en songeant que l'on me cachait quelque chose que je ne parvenais pas à saisir.
–Est-il difforme? Laid?
Josse me prit les mains.
–Non, non. Rien de tout cela! Je vous assure qu'il vous respectera et facilitera votre vie à Kermazan. Mais je ne peux pas savoir comment vous vous entendrez, damoiselle. Ce qui se passe entre deux époux...ne me concerne pas. Je ne suis qu'un...
–Intermédiaire? dis-je.
Josse haussa les épaules et répondit d'une voix rogue.
–C'est cela! Un intermédiaire. Qui doit accomplir une mission...difficile.
–Bien. Je suppose que vous y êtes habitué, n'est-ce-pas? Je pense que mon père vous a offert le gite en attendant la fin de votre mission! rétorquai-je froidement. Je vous souhaite la bonne nuit.
Je lui tournai le dos et repartis vers le castel en passant devant mon père sans m’arrêter, tant j'avais envie de l’accabler de paroles acerbes et peu aimables.
Mais l’irrémédiable s’était déjà produit! Je n'avais plus de foyer, et surtout je n'avais aucun moyen de me sortir de cette impasse. Ou bien je refusais cette union, mais mon père, se sentant déshonoré, pouvait me faire épouser n'importe qui d'autre. Ou bien j'acceptais et je devais partir, quitter le castel sans espoir de retour, pour aller dans une contrée inconnue, vivre auprès d'un homme dont je ne savais rien, en dépit de l'assurance que cherchait à me donner Josse.
J'avais pensé quelque temps pouvoir épouser Gavin, l’écuyer de mon père. Un jeune homme d'une gentillesse et d'une serviabilité à toute épreuve, qui acceptait de s'intéresser à une très jeune fille qui ne connaissait rien de la vie réelle en dehors des murs du castel. Rien d'autre enfin que ce que j'avais pu en lire dans certains grimoires anciens qui traînaient sur des étagères poussiéreuses dans une pièce où personne ne venait jamais.
Car je savais lire, contrairement aux filles qui ne se donnaient pas la peine d'apprendre, pensant sans doute que cela ne leur servirait à rien une fois mariées.
Gavin, en cachette de mon père bien sûr, m'avait aussi appris à me servir d'un couteau sur une cible, et d'une épée.
Je lançais assez bien le coutelas, après m'être entraînée dans les bois sur les arbres qui, à cause de moi, portaient maintenant maintes égratignures. Quant à l'épée, je ne la maîtrisais pas bien car celle de Gavin était lourde et peu maniable pour ma main. On ne fabriquait évidemment pas d'arme pour les jeunes filles.
Mais, en cas de danger, je pensais pouvoir me défendre, enfin si une brute ne la faisait pas sauter de ma main du premier coup.
C'est en rentrant de promenade la veille que mon père m'avait annoncé ce mariage de but en blanc, froidement. Il avait dû le promettre et l'organiser depuis des mois sans m'en parler car, bien entendu, je n'avais pas mon mot à dire. Et peut-être même l'avait-il appris à ma mère en même temps qu'à moi! Ce que je ne lui pardonnerais jamais.
Je n'étais qu'un corps que l'on jetait en pâture dans le lit d’un homme qui allait pouvoir en disposer à sa guise.
Je tournai en rond dans cette chambre qui n'était déjà plus mienne, encombrée de malles et de coffres refermés sur les quelques possessions que j'avais le droit d'emporter.
Je m'assis près du fenestron pour regarder la nuit tomber sur le parc. Josse avait sans doute raison. Ma place n'était plus ici, sous la férule de mon père. Un époux, même imposé, allait me permettre de m'émanciper, de trouver une certaine forme de liberté et, peut-être même, cette autonomie à laquelle j'aspirais de toutes mes forces.
Je finis par me coucher en me promettant que le temps de l'obéissance serait révolu pour moi, quel que soit l'homme qui allait être mon époux!
A l'aube je fis porter un message à mon père que je refusais toujours de rencontrer, pour l'informer que je consentais à cette union dans laquelle Josse devait représenter mon futur époux.
Extrait: "Le diable ne danse jamais loin"
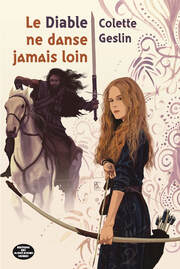
29 septembre 1364- Bataille d'Auray
J'espérais vraiment me faire tuer dans cette bataille.
Cela avait été l'enfer. Clisson se battait là-bas comme un dément face à nos troupes, il avait été blessé vilainement à l'oeil mais cela ne l'avait point arrêté, et il continuait à manier sa hache avec des ahanements de diable.
De mon côté je ne valais guère mieux, lardé de coups d'épée, mais la malchance voulait qu'aucun ne fut mortel alors que tant d'hommes, aussi braves, sinon plus que moi, jonchaient notre sol.
C'était des rivières de sang qui couraient sur la Bretagne, des milliers d'hommes qui mouraient pour défendre, ou donner, selon leur parti, ce territoire à un homme qui serait duc le soir même.
Foutue bataille dont je ne savais pas encore l'issue. Du Guesclin l'emporterait-il? Montfort gagnerait-il son duché contre le duc de Penthièvre grâce à la férocité d'Olivier de Clisson? C'était un vrai boucher que cet homme-là, et je n'avais oncques vu quelqu'un se battre comme lui. Une hache avait entamé son casque, et sans doute lui avait-elle aussi crevé l'oeil, mais il avait continué, le visage en sang, comme si cela n'avait été qu'une méchante piqûre d'abeille.
Pour ma part je ne savais plus qui gagnait, qui perdait. Les hommes continuaient à se battre, et peut-être même ne savaient-ils plus non plus contre qui ils le faisaient. Ils défendaient leur vie, ils étaient épuisés, ils n'avaient plus visage d'homme et, là, ils se rapprochaient de ce que j'étais moi-même. Monstrueux!
Vers le soir tout sembla s'arrêter. Il n'y eut plus guère d'adversaire devant moi. Où diable étaient-ils? Blessés? Morts? Déserteurs? Sur le champ de bataille en fureur une étrange paix tomba. Juste quelques bruits, des gémissements, des jurons, des prières, des soupirs de fin de vie!
Je me laissai tomber à mon tour au sol, sans plus de forces pour tenir mon épée, et je glissai dans une sorte de sommeil proche de la mort.
Je ne sais combien d'heures je suis resté ainsi au milieu des morts, incapable de me relever. Mes bras ne répondaient pas plus que mes jambes devenues aussi flasques que du coton. Je ne voulais qu'une chose. Mourir!
Lorsque j'ouvris les yeux il faisait presque nuit et l'homme étendu près de moi était mort. Je le connaissais vaguement, il habitait sur la côte, non loin de mon manoir mais, comme je fuyais mes semblables, je ne savais presque rien de lui. Je l'avais vu se battre quelque temps, puis je l'avais perdu de vue, cette danse macabre nous éloignant les uns des autres pour mieux nous réunir à la fin.
Je fermai les yeux et je perdis conscience de l'environnement plusieurs fois, dans une sorte d'hébétude dont je ne voulais plus sortir. Qu'on en finisse! Que Dieu me prenne enfin en pitié et m'extirpe de cette vie qui me pesait. Pourquoi m'avait-il mis ce fardeau sur des épaules qui ressemblaient à celles des bêtes de la forêt? Ours? Créature d'Outre-Monde?
Puis je perçus des cris d'appels que je ne compris pas, et un mouvement confus autour de moi. Sans doute des pilleurs de cadavres qui n'hésitaient pas à achever les mourants pour les détrousser. Dans un réflexe inné, je levai mon épée avec difficulté pour embrocher celui qui essaierait de me piquer de sa dague, en ricanant tout bas. Puisque je voulais mourir, alors pourquoi ne pas me laisser faire, là, sur ce champ de désolation où la Bretagne jouait son avenir et allait sans aucun doute changer de chef. Qu'elle le fasse donc sans moi!
Mais je décidai, après tout, que je ne voulais pas être embroché par un manant après avoir combattu en chevalier. C'était une chose que d'être tué dans un combat. Dégradant et peu reluisant que d'être occis de cette façon!
Une voix que je reconnus, celle de Gondran, qui hurlait mon nom à l'encan, traversa l'épaisseur du silence. Fidèle d'entre les fidèles, il était bien sûr à ma recherche dans ce charnier puant, et je levai une main qui tremblait, tout à coup rassuré de savoir que les miens voulaient me retrouver.
–Messire Aldren! criait-il en s'époumonant. Messire Aldren!
Puis il fut près de moi et je perçus son corps rassurant qui se penchait pour me prendre contre lui.
–Messire! Enfin...vous êtes vivant!
Il y avait une note presque hystérique dans sa voix, et j'essayai de rire malgré moi. Enfin ce qui ressemblait le plus à un rire, mais qui ne devait être qu'un chevrotement.
–Oui, grognai-je. Ce n'est pas faute...pourtant...d'avoir cherché à me faire tuer!
Gondran grommela un juron bien senti dans sa barbe en m'agrippant pour me relever.
–Bon Dieu de bon Dieu de bon Dieu! Je vous ai cherché partout dans ce satané champ de bataille....
–Dieu n'a pas voulu de moi, voilà tout. Inutile de l'appeler! Vois donc ce qu'il a fait aujourd'hui en laissant tous ces gens mourir!, fis-je en désignant à l'aveugle le terrain défoncé autour de nous.
Pour ma part je voyais trouble, tout dansait devant mes yeux et, dans le visage tout proche de Gondran, je devinai que je ne devais pas être en bon état. Enfin, encore moins que d'habitude!
–Appuyez-vous sur moi, messire. Nous allons vous ramener dans une des tentes là-bas. Venez m'aider vous autres, cria-t-il derrière lui.
Je sentis d'autres mains qui me relevaient avec précaution et je compris qu'il avait dû amener avec lui deux de mes serviteurs.
–Ecoute Gondran, il faut plutôt déguerpir d'ici, je ne veux pas qu'on me voie dans cet état...
–Je sais, mais vous ne pourrez pas aller bien loin, sans parler de chevaucher. Et puis Clisson a fait demander de vos nouvelles...
–Allons bon! Nous ne sommes pas spécialement des amis... grommelai-je. Je ne veux pas le voir, ni lui, ni personne. A-t-il gagné? Où bien est-ce notre parti?
Gondran haussa les épaules.
–Je n'ai que de vagues rumeurs. On dirait que Penthièvre est mort, que du Guesclin a été fait prisonnier par les Anglais, et que Montfort l'a emporté, grâce à Clisson...
–Grand bien leur fasse à tous, ricanai-je. Mais j'ai de la peine pour Bertrand s'il est vraiment prisonnier des Godons! C'est un bon combattant et un homme comme on en fait peu. Foutus Anglais. Envoie quelqu'un dire à Clisson que je veux regagner Tréhani. Ou plutôt non, ne dis rien à quiconque et partons d'ici. Je ne veux voir personne. Je dois être effrayant...
–Plutôt oui, messire, acquiesça Gondran sans se formaliser, car nous vivions depuis tant d'années l'un près de l'autre, qu'il connaissait mes humeurs, mes colères, mes désillusions, mes envies d'en finir parfois, sans se laisser impressionner. Maintenant je dois trouver un médecin pour vous examiner, vous saignez de partout....
–Pas de ces foutus chirurgiens qui ne pensent qu'à couper un membre!
– Voulez-vous que je retire votre casque?
–Que nenni...les gens s'enfuiraient en hurlant comme si j'étais le diable.
–Il n'y a guère de monde autour de nous, céans, messire...à part les morts, ricana Gondran.
–Alors, trouve-moi un seau d'eau pour me laver de toute cette saleté, fis-je avec dégoût. Tu vas devoir m'aider à marcher... Ce tref[1] est loin?
Gondran haussa les épaules.
–S'il le faut on va vous porter à nous trois...
C'est ce qu'ils firent, en m'installant tant bien que mal sur leurs mains unies sans protester que ma cotte de mailles devait leur écorcher la peau.
Nous mîmes un long moment pour parvenir jusqu'aux trefs qui avaient été dressés à l'arrière du champ de bataille, loin de la plaine d'Auray, et où affluaient maintenant les blessés. Il y avait un va-et-vient incessant, des cris et des hurlements, des bruits effrayants de scies, car les mires devaient couper des membres impossibles à sauver. J'eus un mouvement de recul.
–Je ne veux pas entrer là-dedans, décidai-je.
Gondran fit signe de me poser à terre et je marchai tant bien que mal, soutenu par leurs épaules, jusqu'à la petite tente qu'il avait réussi à isoler et à récupérer je ne sais trop comment. Je l'entendis héler un médecin qui accueillait les blessés apportés sur des brancards, mais celui-ci rétorqua d'une voix bourrue que, si j'étais capable de marcher, il me faudrait patienter car il y avait des cas plus graves.
–Mais je vais vous envoyer un de mes apprentis. Il est dégourdi et verra ce qu'il peut faire. Je ne comprends pas toujours ce qu'il fait...mais il a un don, ricana-t-il.
Gondran ravala sa colère car il comprenait combien les médecins de chaque camp devaient être surchargés, et il escorta le dit-apprenti jusqu'à moi. Je m'étais plongé la tête dans le seau d'eau et m'ébrouai en secouant ma longue crinière lorsqu'il entra. Je vis, du coin de l'oeil, qu'il semblait assez jeune et songeai qu'il n'allait pas pouvoir faire grand chose pour améliorer mon état.
Il posa une sorte de sacoche à terre, me jeta un bref coup d'oeil et s'adressa à Gondran.
–Retirez-lui donc cette fourrure, comment voulez-vous que je l'examine et que je vois ses blessures...
Il releva la tête devant le silence qui accueillit sa déclaration et nous regarda, décontenancé.
–Il faut que je voie vos plaies, messire, insista-t-il en s'approchant. Retirez ce vêtement.
Il faisait sombre heureusement, et seule la lueur des torches, qui avaient été allumées en dehors de la tente, éclairait chichement l'endroit.
Gondran se racla la gorge.
–Vous êtes un jeune médecin, commença-t-il.Vous verrez certaines choses qui vous paraîtront...disons étranges...
Le jeune homme s'approcha de moi et me toucha le bras qui n'avait plus sa cotte de mailles. On m'avait aidé péniblement à la retirer, ainsi que mon justaucorps et, de ma poitrine maintenant libérée, le sang avait commencé à couler de différentes entailles.
Il tiqua un peu, recula, et me regarda plus attentivement. Puis il parut réfléchir, se rapprocha à nouveau et toucha ma peau, enfin ce qui me tenait lieu de peau, l'épaisse toison qui me couvrait de la tête aux pieds.
Je l'entendis jurer tout bas lui aussi, mais, comme il ne s'enfuit pas en hurlant, je décidai qu'il allait peut-être faire l'affaire.
–Ce n'est pas...
–Non, ce n'est pas! déclarai-je alors d'une voix rauque.
–Pouvez-vous rapprocher un flambeau... messire…? demanda-t-il alors.
–Gondran, rétorqua celui-ci imperturbable.
–Gondran, votre...maître... est vilainement blessé, mais comment faire pour voir les plaies? Pourriez-vous...? Messire, puis-je vous parler franchement, reprit-il en s'adressant cette fois à moi.
Je ris sourdement.
–Puisque vous êtes toujours là, jeune homme, c'est que vous n'êtes pas froussard!...Alors qu'avez-vous en tête?
–Vos hommes...ou votre ami, fit-il avec un coup d'oeil vers Gondran qui se tenait près de moi...pourraient-ils...vous raser? Vous comprenez, reprit-il très vite, vos plaies vont s'infecter si vous gardez ce... cette...
Comme il cherchait à éviter le mot qui, selon lui, pouvait me blesser ou me mettre en colère, je terminai pour lui.
–Cette toison, vous pouvez dire ainsi, jeune homme. Je vis avec depuis si longtemps...
Il eut un mince sourire et, à cela, je compris qu'il devait être solide et que j'avais de la chance de ne pas être tombé sur un crétin.
–Alors, allons-y, j'ai apporté de quoi vous soigner mais j'irai chercher...autre chose dans notre infirmerie...encore que nous n'ayons plus beaucoup de charpie, ni de médicaments. Là-bas, on coupe plutôt les membres, ajouta-t-il dans un soupir navré. Au fait je me nomme Thibaut de la Mandeuille.
–Eh bien, Thibaut, j'espère que vous n'aurez pas à tailler dans les miens, rétorquai-je, tandis que Gondran et mes serviteurs aiguisaient leurs rasoirs et commençaient à raccourcir ma toison qui tomba peu à peu à terre en formant une épaisse couche de fourrure. Mon visage sortit de sa gangue de poils, et révéla sans doute mon état de fatigue et d'épuisement car le jeune médecin me fit boire aussitôt le contenu d'une petite fiole qu'il tira de son sac.
–Mon maître ne croit pas à ce remède mais je l'ai expérimenté plusieurs fois, et toujours pour le plus grand bien...
–Qu'y-a-t-il là-dedans? demandai-je en avalant sans protester le liquide verdâtre.
–Des herbes! rétorqua-t-il d'un ton laconique en haussant les épaules.
–Alors, va pour les herbes, dis-je.
Je l'entendis pester tout bas en découvrant les multiples blessures que la cotte avait arrêtées en partie, mais mes cuisses étaient labourées, ainsi que mes bras, et il s'affaira sans parler pendant un bon moment pour dégager les blessures des poils qui restaient, les nettoyer et les bourrer d'un emplâtre, sans doute aussi de sa composition. J'avais de la chance d'être tombé sur un tel homme qui, malgré sa jeunesse, était habile, et devait s'y connaître dans les herbes et les plantes médicinales de nos ancêtres.
–Ma grand-mère est guérisseuse, marmonna-t-il d'un ton neutre en plissant le front avec application. Je crains que vous ne puissiez chevaucher tout de suite, messire Aldren, déclara-t-il.
–On verra, répliquai-je. Je veux pourtant quitter ce maudit endroit au plus vite.
–Hon! grogna-t-il en continuant ses investigations sur mon corps poilu, certes, mais maintenant acceptable. Il n'avait pas posé la question qui devait le tarauder, mais je l'entendais tourner dans sa tête car je devais être le premier humain qu'il rencontrait dans un tel état.
Un cavalier déboula soudain devant les tentes et cria des nouvelles.
–Montfort a gagné, Blois est mort, du Guesclin est prisonnier.
Nous relevâmes tous la tête à cette confirmation de la rumeur qui avait couru. La Bretagne avait un nouveau duc, en la personne de Jean de Montfort, soutenu par les Anglais, et sans doute aussi par Clisson, et je ne sus s'il fallait s'en réjouir. Puis il cria encore quelque chose que je ne compris pas et je fis signe à Gondran d'aller aux nouvelles.
Une fois seuls, Thibaut osa alors poser la question qu'il retenait.
–Etes-vous... toujours ainsi, messire?
–Toujours, dis-je brièvement.
–Les...poils...repoussent même lorsqu'on vous ...rase?
–Oui, grommelai-je, ils repoussent aussi drus quelques jours plus tard.
J'entendis son soupir.
–Je voudrais pouvoir vous aider, commença-t-il d'un ton hésitant.
–Personne ne le peut, jeune homme. Vous verrez bien des maux durant votre existence de médecin, certains que vous pourrez soulager...d'autres...probablement pas, malgré votre bonne volonté.
–Avez-vous un médecin pour vous soigner, une fois rentré chez vous?
–Mannaig, une guérisseuse sur mon domaine, fera l'affaire. Elle me connaît...et elle sait beaucoup de choses.
–Bien, dit-il. Ma grand-mère aussi m'a beaucoup appris...même des façons de soigner qui ne plaisent pas toujours à maistre La Feuillée que j'assiste. Mais pourtant il me laisse souvent faire à ma guise, ajouta-t-il dans une grimace.
–Comme aujourd'hui?
–Oui, comme avec vous, messire. Où se trouve votre domaine? Je pourrais peut-être...venir vérifier vos plaies!
–La presqu'île. Castel Tréhani. Mais les visiteurs évitent ce lieu...
Thibaut parut soudain embarrassé mais Gondran revint à cet instant, l'air abattu.
–Penthièvre a été assassiné, dit-il. Il s'était résolu à se rendre en voyant la bataille perdue et il avait à peine ôté son casque qu'on lui a fracassé le crâne en dépit de toutes les règles de la guerre. L'Anglais Chandos, Clisson et Montfort sont en train de fêter leur victoire à Auray, dit-on.
–La peste soit de ces hommes-là, bougonnai-je, laminé par ces jours de batailles, et par nos marches forcées à travers les marais. Il faut que je dorme, Gondran.
–Messire, restez dans cette tente jusqu'à demain, vous verrez ensuite comment rentrer chez vous, dit Thibaut. Je reviendrai à l'aube refaire vos pansements avant votre départ.
–Et tu me retrouveras transformé à nouveau en ours, grimaçai-je.
–Je dois y aller maintenant. Il y a beaucoup de blessés à soigner. Dormez, si vous le pouvez, messire. Nous nous reverrons.
Il partit rapidement en ayant récupéré son sac et ses fioles, et Gondran m'aida à m'étendre sur la paillasse qu'il avait réussi à dénicher.
–Nous monterons la garde à tour de rôle, messire. Dormez en paix.
Je dormis. En paix, je ne sais pas, mais la potion que Thibaut m'avait fait boire dut faire son effet car je ne fis ni cauchemar, ni insomnie, je n'entendis plus les épées s'entrechoquer, les chevaux hennir de terreur, les combattants hurler de douleur ou de haine. Je dormis enfin.
Durant mon sommeil, Gondran et mes serviteurs avaient organisé notre retour et, après la visite matinale et rapide de Thibaut, nous prîmes la route pour rentrer au castel. Il nous faudrait des jours de voyage dans mon état car, après avoir récupéré nos chevaux qui avaient été mis à l'abri dans un village au-delà d'Auray, je dus monter en croupe avec Gondran, laissant mon cheval libre afin de ne pas le fatiguer. Nous changeâmes ainsi de chevaux après quelques lieues, pour nous arrêter dans une mauvaise auberge afin de nous reposer durant la nuit. Nous dûmes dormir à quatre dans la seule chambre qui restait à louer et je bus à nouveau la potion de Thibaut pour arriver à dormir.
Les routes étaient encombrées de soldats qui essayaient de rentrer chez eux, éclopés, blessés, la tête souvent enveloppée d'un linge car ils avaient combattu sans casque, et les blessures d'épée étaient vilaines. D'aucuns avaient perdu qui un oeil, qui un morceau de nez, parfois une partie de visage, et ils en garderaient des séquelles insoignables à vie. Pour ma part, j'avais choisi de conserver mon casque pour dissimuler ma tête, car les poils repoussaient vite et je voulais éviter de nous faire arrêter ou montrer du doigt.
Le troisième jour enfin, Tréhani fut en vue, et il était grand temps car je titubais après avoir failli tomber de cheval plusieurs fois, si bien que Gondran avait dû m'attacher à lui. Nos chevaux étaient eux aussi exténués d'avoir dû porter un tel poids, et je les remis aux soins du palefrenier avec soulagement, après avoir craint de perdre deux si belles bêtes.
On vint m'accueillir en silence dans l'entrée fraîche de la grande salle, et Mannaig, la guérisseuse qui me soignait depuis mon adolescence, s'empressa de me faire conduire jusque dans ma chambre d'où elle chassa tout le monde excepté Gondran.
Mais il était lui-même si éprouvé par notre périple que je le renvoyais se reposer en lui demandant d'appeler le barbier qui prenait soin de moi chaque jour pour essayer de discipliner cette toison qui m'envahissait et me faisait de plus en plus ressembler à une bête. Eux seuls savaient le calvaire que je devais supporter, eux seuls n'avaient pas peur de mon aspect animal, et il fit le nécessaire pour me laver car j'avais été incapable, durant ces jours de chevauchée, de pouvoir le faire entièrement, faute d'intimité et de cuveau.
–Demain, j'irai me tremper dans la mer, murmurai-je en m'endormant enfin dans mon lit fraîchement refait avec des draps propres et parfumés. Demain!
Car désormais, revenu de cette bataille meurtrière, il y aurait encore un lendemain!
[1]tref: pavillon, tente que l'on dressait près des champs de bataille pour les soldats et les chirurgiens.
J'espérais vraiment me faire tuer dans cette bataille.
Cela avait été l'enfer. Clisson se battait là-bas comme un dément face à nos troupes, il avait été blessé vilainement à l'oeil mais cela ne l'avait point arrêté, et il continuait à manier sa hache avec des ahanements de diable.
De mon côté je ne valais guère mieux, lardé de coups d'épée, mais la malchance voulait qu'aucun ne fut mortel alors que tant d'hommes, aussi braves, sinon plus que moi, jonchaient notre sol.
C'était des rivières de sang qui couraient sur la Bretagne, des milliers d'hommes qui mouraient pour défendre, ou donner, selon leur parti, ce territoire à un homme qui serait duc le soir même.
Foutue bataille dont je ne savais pas encore l'issue. Du Guesclin l'emporterait-il? Montfort gagnerait-il son duché contre le duc de Penthièvre grâce à la férocité d'Olivier de Clisson? C'était un vrai boucher que cet homme-là, et je n'avais oncques vu quelqu'un se battre comme lui. Une hache avait entamé son casque, et sans doute lui avait-elle aussi crevé l'oeil, mais il avait continué, le visage en sang, comme si cela n'avait été qu'une méchante piqûre d'abeille.
Pour ma part je ne savais plus qui gagnait, qui perdait. Les hommes continuaient à se battre, et peut-être même ne savaient-ils plus non plus contre qui ils le faisaient. Ils défendaient leur vie, ils étaient épuisés, ils n'avaient plus visage d'homme et, là, ils se rapprochaient de ce que j'étais moi-même. Monstrueux!
Vers le soir tout sembla s'arrêter. Il n'y eut plus guère d'adversaire devant moi. Où diable étaient-ils? Blessés? Morts? Déserteurs? Sur le champ de bataille en fureur une étrange paix tomba. Juste quelques bruits, des gémissements, des jurons, des prières, des soupirs de fin de vie!
Je me laissai tomber à mon tour au sol, sans plus de forces pour tenir mon épée, et je glissai dans une sorte de sommeil proche de la mort.
Je ne sais combien d'heures je suis resté ainsi au milieu des morts, incapable de me relever. Mes bras ne répondaient pas plus que mes jambes devenues aussi flasques que du coton. Je ne voulais qu'une chose. Mourir!
Lorsque j'ouvris les yeux il faisait presque nuit et l'homme étendu près de moi était mort. Je le connaissais vaguement, il habitait sur la côte, non loin de mon manoir mais, comme je fuyais mes semblables, je ne savais presque rien de lui. Je l'avais vu se battre quelque temps, puis je l'avais perdu de vue, cette danse macabre nous éloignant les uns des autres pour mieux nous réunir à la fin.
Je fermai les yeux et je perdis conscience de l'environnement plusieurs fois, dans une sorte d'hébétude dont je ne voulais plus sortir. Qu'on en finisse! Que Dieu me prenne enfin en pitié et m'extirpe de cette vie qui me pesait. Pourquoi m'avait-il mis ce fardeau sur des épaules qui ressemblaient à celles des bêtes de la forêt? Ours? Créature d'Outre-Monde?
Puis je perçus des cris d'appels que je ne compris pas, et un mouvement confus autour de moi. Sans doute des pilleurs de cadavres qui n'hésitaient pas à achever les mourants pour les détrousser. Dans un réflexe inné, je levai mon épée avec difficulté pour embrocher celui qui essaierait de me piquer de sa dague, en ricanant tout bas. Puisque je voulais mourir, alors pourquoi ne pas me laisser faire, là, sur ce champ de désolation où la Bretagne jouait son avenir et allait sans aucun doute changer de chef. Qu'elle le fasse donc sans moi!
Mais je décidai, après tout, que je ne voulais pas être embroché par un manant après avoir combattu en chevalier. C'était une chose que d'être tué dans un combat. Dégradant et peu reluisant que d'être occis de cette façon!
Une voix que je reconnus, celle de Gondran, qui hurlait mon nom à l'encan, traversa l'épaisseur du silence. Fidèle d'entre les fidèles, il était bien sûr à ma recherche dans ce charnier puant, et je levai une main qui tremblait, tout à coup rassuré de savoir que les miens voulaient me retrouver.
–Messire Aldren! criait-il en s'époumonant. Messire Aldren!
Puis il fut près de moi et je perçus son corps rassurant qui se penchait pour me prendre contre lui.
–Messire! Enfin...vous êtes vivant!
Il y avait une note presque hystérique dans sa voix, et j'essayai de rire malgré moi. Enfin ce qui ressemblait le plus à un rire, mais qui ne devait être qu'un chevrotement.
–Oui, grognai-je. Ce n'est pas faute...pourtant...d'avoir cherché à me faire tuer!
Gondran grommela un juron bien senti dans sa barbe en m'agrippant pour me relever.
–Bon Dieu de bon Dieu de bon Dieu! Je vous ai cherché partout dans ce satané champ de bataille....
–Dieu n'a pas voulu de moi, voilà tout. Inutile de l'appeler! Vois donc ce qu'il a fait aujourd'hui en laissant tous ces gens mourir!, fis-je en désignant à l'aveugle le terrain défoncé autour de nous.
Pour ma part je voyais trouble, tout dansait devant mes yeux et, dans le visage tout proche de Gondran, je devinai que je ne devais pas être en bon état. Enfin, encore moins que d'habitude!
–Appuyez-vous sur moi, messire. Nous allons vous ramener dans une des tentes là-bas. Venez m'aider vous autres, cria-t-il derrière lui.
Je sentis d'autres mains qui me relevaient avec précaution et je compris qu'il avait dû amener avec lui deux de mes serviteurs.
–Ecoute Gondran, il faut plutôt déguerpir d'ici, je ne veux pas qu'on me voie dans cet état...
–Je sais, mais vous ne pourrez pas aller bien loin, sans parler de chevaucher. Et puis Clisson a fait demander de vos nouvelles...
–Allons bon! Nous ne sommes pas spécialement des amis... grommelai-je. Je ne veux pas le voir, ni lui, ni personne. A-t-il gagné? Où bien est-ce notre parti?
Gondran haussa les épaules.
–Je n'ai que de vagues rumeurs. On dirait que Penthièvre est mort, que du Guesclin a été fait prisonnier par les Anglais, et que Montfort l'a emporté, grâce à Clisson...
–Grand bien leur fasse à tous, ricanai-je. Mais j'ai de la peine pour Bertrand s'il est vraiment prisonnier des Godons! C'est un bon combattant et un homme comme on en fait peu. Foutus Anglais. Envoie quelqu'un dire à Clisson que je veux regagner Tréhani. Ou plutôt non, ne dis rien à quiconque et partons d'ici. Je ne veux voir personne. Je dois être effrayant...
–Plutôt oui, messire, acquiesça Gondran sans se formaliser, car nous vivions depuis tant d'années l'un près de l'autre, qu'il connaissait mes humeurs, mes colères, mes désillusions, mes envies d'en finir parfois, sans se laisser impressionner. Maintenant je dois trouver un médecin pour vous examiner, vous saignez de partout....
–Pas de ces foutus chirurgiens qui ne pensent qu'à couper un membre!
– Voulez-vous que je retire votre casque?
–Que nenni...les gens s'enfuiraient en hurlant comme si j'étais le diable.
–Il n'y a guère de monde autour de nous, céans, messire...à part les morts, ricana Gondran.
–Alors, trouve-moi un seau d'eau pour me laver de toute cette saleté, fis-je avec dégoût. Tu vas devoir m'aider à marcher... Ce tref[1] est loin?
Gondran haussa les épaules.
–S'il le faut on va vous porter à nous trois...
C'est ce qu'ils firent, en m'installant tant bien que mal sur leurs mains unies sans protester que ma cotte de mailles devait leur écorcher la peau.
Nous mîmes un long moment pour parvenir jusqu'aux trefs qui avaient été dressés à l'arrière du champ de bataille, loin de la plaine d'Auray, et où affluaient maintenant les blessés. Il y avait un va-et-vient incessant, des cris et des hurlements, des bruits effrayants de scies, car les mires devaient couper des membres impossibles à sauver. J'eus un mouvement de recul.
–Je ne veux pas entrer là-dedans, décidai-je.
Gondran fit signe de me poser à terre et je marchai tant bien que mal, soutenu par leurs épaules, jusqu'à la petite tente qu'il avait réussi à isoler et à récupérer je ne sais trop comment. Je l'entendis héler un médecin qui accueillait les blessés apportés sur des brancards, mais celui-ci rétorqua d'une voix bourrue que, si j'étais capable de marcher, il me faudrait patienter car il y avait des cas plus graves.
–Mais je vais vous envoyer un de mes apprentis. Il est dégourdi et verra ce qu'il peut faire. Je ne comprends pas toujours ce qu'il fait...mais il a un don, ricana-t-il.
Gondran ravala sa colère car il comprenait combien les médecins de chaque camp devaient être surchargés, et il escorta le dit-apprenti jusqu'à moi. Je m'étais plongé la tête dans le seau d'eau et m'ébrouai en secouant ma longue crinière lorsqu'il entra. Je vis, du coin de l'oeil, qu'il semblait assez jeune et songeai qu'il n'allait pas pouvoir faire grand chose pour améliorer mon état.
Il posa une sorte de sacoche à terre, me jeta un bref coup d'oeil et s'adressa à Gondran.
–Retirez-lui donc cette fourrure, comment voulez-vous que je l'examine et que je vois ses blessures...
Il releva la tête devant le silence qui accueillit sa déclaration et nous regarda, décontenancé.
–Il faut que je voie vos plaies, messire, insista-t-il en s'approchant. Retirez ce vêtement.
Il faisait sombre heureusement, et seule la lueur des torches, qui avaient été allumées en dehors de la tente, éclairait chichement l'endroit.
Gondran se racla la gorge.
–Vous êtes un jeune médecin, commença-t-il.Vous verrez certaines choses qui vous paraîtront...disons étranges...
Le jeune homme s'approcha de moi et me toucha le bras qui n'avait plus sa cotte de mailles. On m'avait aidé péniblement à la retirer, ainsi que mon justaucorps et, de ma poitrine maintenant libérée, le sang avait commencé à couler de différentes entailles.
Il tiqua un peu, recula, et me regarda plus attentivement. Puis il parut réfléchir, se rapprocha à nouveau et toucha ma peau, enfin ce qui me tenait lieu de peau, l'épaisse toison qui me couvrait de la tête aux pieds.
Je l'entendis jurer tout bas lui aussi, mais, comme il ne s'enfuit pas en hurlant, je décidai qu'il allait peut-être faire l'affaire.
–Ce n'est pas...
–Non, ce n'est pas! déclarai-je alors d'une voix rauque.
–Pouvez-vous rapprocher un flambeau... messire…? demanda-t-il alors.
–Gondran, rétorqua celui-ci imperturbable.
–Gondran, votre...maître... est vilainement blessé, mais comment faire pour voir les plaies? Pourriez-vous...? Messire, puis-je vous parler franchement, reprit-il en s'adressant cette fois à moi.
Je ris sourdement.
–Puisque vous êtes toujours là, jeune homme, c'est que vous n'êtes pas froussard!...Alors qu'avez-vous en tête?
–Vos hommes...ou votre ami, fit-il avec un coup d'oeil vers Gondran qui se tenait près de moi...pourraient-ils...vous raser? Vous comprenez, reprit-il très vite, vos plaies vont s'infecter si vous gardez ce... cette...
Comme il cherchait à éviter le mot qui, selon lui, pouvait me blesser ou me mettre en colère, je terminai pour lui.
–Cette toison, vous pouvez dire ainsi, jeune homme. Je vis avec depuis si longtemps...
Il eut un mince sourire et, à cela, je compris qu'il devait être solide et que j'avais de la chance de ne pas être tombé sur un crétin.
–Alors, allons-y, j'ai apporté de quoi vous soigner mais j'irai chercher...autre chose dans notre infirmerie...encore que nous n'ayons plus beaucoup de charpie, ni de médicaments. Là-bas, on coupe plutôt les membres, ajouta-t-il dans un soupir navré. Au fait je me nomme Thibaut de la Mandeuille.
–Eh bien, Thibaut, j'espère que vous n'aurez pas à tailler dans les miens, rétorquai-je, tandis que Gondran et mes serviteurs aiguisaient leurs rasoirs et commençaient à raccourcir ma toison qui tomba peu à peu à terre en formant une épaisse couche de fourrure. Mon visage sortit de sa gangue de poils, et révéla sans doute mon état de fatigue et d'épuisement car le jeune médecin me fit boire aussitôt le contenu d'une petite fiole qu'il tira de son sac.
–Mon maître ne croit pas à ce remède mais je l'ai expérimenté plusieurs fois, et toujours pour le plus grand bien...
–Qu'y-a-t-il là-dedans? demandai-je en avalant sans protester le liquide verdâtre.
–Des herbes! rétorqua-t-il d'un ton laconique en haussant les épaules.
–Alors, va pour les herbes, dis-je.
Je l'entendis pester tout bas en découvrant les multiples blessures que la cotte avait arrêtées en partie, mais mes cuisses étaient labourées, ainsi que mes bras, et il s'affaira sans parler pendant un bon moment pour dégager les blessures des poils qui restaient, les nettoyer et les bourrer d'un emplâtre, sans doute aussi de sa composition. J'avais de la chance d'être tombé sur un tel homme qui, malgré sa jeunesse, était habile, et devait s'y connaître dans les herbes et les plantes médicinales de nos ancêtres.
–Ma grand-mère est guérisseuse, marmonna-t-il d'un ton neutre en plissant le front avec application. Je crains que vous ne puissiez chevaucher tout de suite, messire Aldren, déclara-t-il.
–On verra, répliquai-je. Je veux pourtant quitter ce maudit endroit au plus vite.
–Hon! grogna-t-il en continuant ses investigations sur mon corps poilu, certes, mais maintenant acceptable. Il n'avait pas posé la question qui devait le tarauder, mais je l'entendais tourner dans sa tête car je devais être le premier humain qu'il rencontrait dans un tel état.
Un cavalier déboula soudain devant les tentes et cria des nouvelles.
–Montfort a gagné, Blois est mort, du Guesclin est prisonnier.
Nous relevâmes tous la tête à cette confirmation de la rumeur qui avait couru. La Bretagne avait un nouveau duc, en la personne de Jean de Montfort, soutenu par les Anglais, et sans doute aussi par Clisson, et je ne sus s'il fallait s'en réjouir. Puis il cria encore quelque chose que je ne compris pas et je fis signe à Gondran d'aller aux nouvelles.
Une fois seuls, Thibaut osa alors poser la question qu'il retenait.
–Etes-vous... toujours ainsi, messire?
–Toujours, dis-je brièvement.
–Les...poils...repoussent même lorsqu'on vous ...rase?
–Oui, grommelai-je, ils repoussent aussi drus quelques jours plus tard.
J'entendis son soupir.
–Je voudrais pouvoir vous aider, commença-t-il d'un ton hésitant.
–Personne ne le peut, jeune homme. Vous verrez bien des maux durant votre existence de médecin, certains que vous pourrez soulager...d'autres...probablement pas, malgré votre bonne volonté.
–Avez-vous un médecin pour vous soigner, une fois rentré chez vous?
–Mannaig, une guérisseuse sur mon domaine, fera l'affaire. Elle me connaît...et elle sait beaucoup de choses.
–Bien, dit-il. Ma grand-mère aussi m'a beaucoup appris...même des façons de soigner qui ne plaisent pas toujours à maistre La Feuillée que j'assiste. Mais pourtant il me laisse souvent faire à ma guise, ajouta-t-il dans une grimace.
–Comme aujourd'hui?
–Oui, comme avec vous, messire. Où se trouve votre domaine? Je pourrais peut-être...venir vérifier vos plaies!
–La presqu'île. Castel Tréhani. Mais les visiteurs évitent ce lieu...
Thibaut parut soudain embarrassé mais Gondran revint à cet instant, l'air abattu.
–Penthièvre a été assassiné, dit-il. Il s'était résolu à se rendre en voyant la bataille perdue et il avait à peine ôté son casque qu'on lui a fracassé le crâne en dépit de toutes les règles de la guerre. L'Anglais Chandos, Clisson et Montfort sont en train de fêter leur victoire à Auray, dit-on.
–La peste soit de ces hommes-là, bougonnai-je, laminé par ces jours de batailles, et par nos marches forcées à travers les marais. Il faut que je dorme, Gondran.
–Messire, restez dans cette tente jusqu'à demain, vous verrez ensuite comment rentrer chez vous, dit Thibaut. Je reviendrai à l'aube refaire vos pansements avant votre départ.
–Et tu me retrouveras transformé à nouveau en ours, grimaçai-je.
–Je dois y aller maintenant. Il y a beaucoup de blessés à soigner. Dormez, si vous le pouvez, messire. Nous nous reverrons.
Il partit rapidement en ayant récupéré son sac et ses fioles, et Gondran m'aida à m'étendre sur la paillasse qu'il avait réussi à dénicher.
–Nous monterons la garde à tour de rôle, messire. Dormez en paix.
Je dormis. En paix, je ne sais pas, mais la potion que Thibaut m'avait fait boire dut faire son effet car je ne fis ni cauchemar, ni insomnie, je n'entendis plus les épées s'entrechoquer, les chevaux hennir de terreur, les combattants hurler de douleur ou de haine. Je dormis enfin.
Durant mon sommeil, Gondran et mes serviteurs avaient organisé notre retour et, après la visite matinale et rapide de Thibaut, nous prîmes la route pour rentrer au castel. Il nous faudrait des jours de voyage dans mon état car, après avoir récupéré nos chevaux qui avaient été mis à l'abri dans un village au-delà d'Auray, je dus monter en croupe avec Gondran, laissant mon cheval libre afin de ne pas le fatiguer. Nous changeâmes ainsi de chevaux après quelques lieues, pour nous arrêter dans une mauvaise auberge afin de nous reposer durant la nuit. Nous dûmes dormir à quatre dans la seule chambre qui restait à louer et je bus à nouveau la potion de Thibaut pour arriver à dormir.
Les routes étaient encombrées de soldats qui essayaient de rentrer chez eux, éclopés, blessés, la tête souvent enveloppée d'un linge car ils avaient combattu sans casque, et les blessures d'épée étaient vilaines. D'aucuns avaient perdu qui un oeil, qui un morceau de nez, parfois une partie de visage, et ils en garderaient des séquelles insoignables à vie. Pour ma part, j'avais choisi de conserver mon casque pour dissimuler ma tête, car les poils repoussaient vite et je voulais éviter de nous faire arrêter ou montrer du doigt.
Le troisième jour enfin, Tréhani fut en vue, et il était grand temps car je titubais après avoir failli tomber de cheval plusieurs fois, si bien que Gondran avait dû m'attacher à lui. Nos chevaux étaient eux aussi exténués d'avoir dû porter un tel poids, et je les remis aux soins du palefrenier avec soulagement, après avoir craint de perdre deux si belles bêtes.
On vint m'accueillir en silence dans l'entrée fraîche de la grande salle, et Mannaig, la guérisseuse qui me soignait depuis mon adolescence, s'empressa de me faire conduire jusque dans ma chambre d'où elle chassa tout le monde excepté Gondran.
Mais il était lui-même si éprouvé par notre périple que je le renvoyais se reposer en lui demandant d'appeler le barbier qui prenait soin de moi chaque jour pour essayer de discipliner cette toison qui m'envahissait et me faisait de plus en plus ressembler à une bête. Eux seuls savaient le calvaire que je devais supporter, eux seuls n'avaient pas peur de mon aspect animal, et il fit le nécessaire pour me laver car j'avais été incapable, durant ces jours de chevauchée, de pouvoir le faire entièrement, faute d'intimité et de cuveau.
–Demain, j'irai me tremper dans la mer, murmurai-je en m'endormant enfin dans mon lit fraîchement refait avec des draps propres et parfumés. Demain!
Car désormais, revenu de cette bataille meurtrière, il y aurait encore un lendemain!
[1]tref: pavillon, tente que l'on dressait près des champs de bataille pour les soldats et les chirurgiens.
Extrait : Le barde de Waroc

Arzel- Armorique, Bro Waroc, vers 540
J’ai longtemps été au service du seigneur Waroc qui régentait l’ancien pagus des Vénètes. Et surtout, surtout, j’ai toujours aimé sa fille Trifine.
Oh ! bien sûr, élève de Senchan, le barde de Waroc, je n’espérais point pouvoir l’épouser un jour. Elle était destinée, de par sa naissance, à quelqu’un de noble, de titré, et de riche, avec des terres, des serviteurs, des esclaves, des clients.
Mais, la nuit, les rêves prennent corps dans l’obscurité généreuse qui vous donne tout ce que vous désirez.
Lorsque j’étais dans la demeure de Waroc, mon cœur était en ébullition, car je savais que Trifine dormait à quelques pas de moi. Mieux logée, certes, que dans la salle que je devais partager avec plusieurs serviteurs, mais je la savais toute proche et cela suffisait à mon bonheur. Elle avait quatorze ans, tout comme moi.
En fait, j’étais heureux ces années-là. J’étais heureux et je ne le savais pas !
Je ne le compris que plus tard, quand ma vie changea et que je fus précipité, bien malgré moi, dans une succession d’événements que je dus affronter pour protéger Trifine.
Senchan, le grand barde du seigneur Waroc, avait bien voulu me prendre sous son aile et m’enseigner son art. Et pourtant j’étais un bâtard, je ne connaissais même pas mon père et, tare suprême, j’étais bègue. Mais dès que je me mettais à chanter et à réciter, l’éloquence me venait, les mots coulaient de ma gorge comme du miel, et les gens, abasourdis, m’écoutaient bouche bée.
Jamais ma mère n’avait voulu me révéler qui était mon père et, les années passant, je me demandais si elle le connaissait elle-même. Voyageur, étranger, ou seigneur qui avait abusé d’elle, je bâtissais mille et une histoires à son sujet et Trifine riait avec moi de mes élucubrations. Quoi qu’il en soit, en sa présence, jamais je ne butais sur mes mots, et c’était pour elle que j’élaborais mes plus beaux chants avant de les réciter en public.
Ce soir-là, insigne honneur, je devais chanter après Senchan, au repas donné par Waroc pour l’un de ses voisins. C’est là que j’appris pour la première fois l’existence de Conomore, le seigneur du Poher, un territoire situé plus au nord de l’Armorique.
J’avais passé la matinée à écrire, à répéter mes chants, à en peaufiner les paroles afin qu’elles soient louangeuses et ne heurtent point les visiteurs, ni leur hôte. Je voulais aussi révéler mon âme et ce que je ressentais sous couvert d’un récit destiné à divertir les invités.
Engourdi, et l’esprit embrouillé, je me décidai à sortir du caer pour aller jusque chez ma mère à qui je rendais visite très souvent. Elle vivait seule à la lisière de la forêt, non loin d’une rivière où elle pêchait, se lavait et nageait comme un poisson.
C’était une femme singulière, une solitaire qui avait toujours refusé d’habiter une manse dans le village où régnait Waroc. Elle était guérisseuse, et banfaith, et les gens la craignaient tout en recherchant sa science des plantes, des herbes, qu’elle mélangeait pour en faire des potions étranges au goût surprenant. Mais nombre d’entre eux guérissaient après l’avoir consultée et sa renommée l’entourait et la protégeait.
En la regardant, lorsque je croyais qu’elle ne m’observait pas, grande, bien charpentée, la peau brunie par ses trajets dans la forêt et ses baignades, je concevais aisément qu’elle plaise aux hommes qui la lorgnaient à la dérobée. Avait-elle cédé à l’un d’eux ou bien avait-elle subi un assaut qu’elle n’avait pu éviter, et dont j’étais la conséquence, elle ne répondait jamais à mes questionnements et haussait les épaules.
Tout en cheminant dans la forêt vers sa manse de torchis et de chaume, je me demandais s’il m’arrivait de côtoyer mon géniteur sans le savoir. Peut-être passions-nous parfois à côté l’un de l’autre, mais je me réjouissais néanmoins d’avoir été accepté dans l’entourage du seigneur Waroc qui pourvoyait à ma nourriture, mon logement et mes besoins.
Je marchais allègrement en répétant les paroles de mon chant, celui de La Navigation de Bran, un long poème récitant que je voulais scander à l’intention de Trifine.
— Je n’aime pas ces repas où me convie mon père, m’avait-elle dit. J’ai toujours peur qu’on vienne me demander. Jusqu’ici il a refusé de m’engager mais viendra un jour où il ne pourra plus refuser...
La tristesse envahissait alors son joli visage, qu’elle cachait sous ses longs cheveux blonds, et j’avais fort à faire pour lui redonner le sourire.
Absorbé par mes pensées et la récitation que j’en faisais à mi-voix, je vis trop tard les jeunes gens qui me barraient le chemin et qui ricanaient.
Rusc et Tren, les élèves de Dychan, le maître d’armes, vivaient eux aussi avec leur famille dans les manses du seigneur Waroc mais, n’étant pas des bâtards, ils me traitaient toujours avec beaucoup de rudesse, irrités de constater que je ne répondais pas à leurs provocations. D’abord parce que je savais que les mots allaient s’embrouiller et me faire bafouiller, qu’alors ils se moqueraient un peu plus de mon infirmité, et ensuite parce que mon mutisme et mon impassibilité apparente, les décontenançaient plus qu’une riposte acerbe.
— Alors, chanteur bâtard, on va voir sa maman ? Tout le monde sait qu’elle t’a eu avec un démon !...
C’était la première fois qu’ils utilisaient cette arme en sachant bien qu’elle allait m’atteindre. Je tiquai en effet et je sentis le rouge de la honte me monter aux joues. En plus de cette difficulté d’élocution, j’avais également une marque violacée au cou, comme une morsure indélébile que je touchai malgré moi en la sentant me brûler tout à coup.
Je restai figé devant eux, paralysé, et certains mots secrets et incompréhensibles que prononçait ma mère lorsqu’elle allumait un feu ou concoctait une potion, me revinrent en mémoire car je les connaissais par cœur. Ils se bousculèrent dans ma tête et, sans même m’en rendre compte, je levai la main vers eux pour les repousser. Il en jaillit une étrange lueur rouge qui les frappa au visage et sembla les déchaîner. Ils se ruèrent alors vers moi qui n’avais rien pour me défendre, je me baissai instinctivement et passai entre eux en tombant sur les genoux et en me protégeant la tête.
J’entendis alors leur grognement de douleur et, en me retournant lentement, je vis ma mère dressée devant eux avec le bâton noueux dont elle ne se séparait jamais et sur lequel leurs têtes avaient heurté. A moitié assommés, ils gisaient à terre et gémissaient lugubrement.
Ma mère avait pris une attitude de farouche guerrière et je ne pus m’empêcher de me demander qui elle était vraiment.
— Sers-toi donc de ton don pour te défendre, Arzel, souffla-t-elle d’une voix mécontente.
— Mais je n’ai... commençai-je en balbutiant.
Elle me foudroya du regard et se mit en marche.
— Allons, j’ai à faire...
Je la suivis sans protester en jetant un dernier coup d’œil aux choses misérables qu’étaient devenus les deux garçons qui n’avaient sans doute rien compris à la scène. En tireraient-ils la leçon ou bien serais-je encore plus malmené ? Pour l’instant il m’importait seulement de rattraper la grande foulée vigoureuse de ma mère, qui se dirigeait vers sa manse.
Elle avançait si vite dans le sentier que je la perdis de vue tout de suite, et pourtant je courais presque, la respiration hachée, de crainte que les deux garçons ne se relèvent et me rejoignent. Mais j’étais seul, et je vis enfin la demeure où elle vivait et où je m’engouffrai presque en tombant.
Ma mère me vit arriver, assise près de son feu creusé au milieu de la pièce, sur le sol de terre battue, et je restai un instant ébahi de la trouver aussi paisible, occupée à ses tâches coutumières alors que, l’instant d’avant elle m’avait tiré d’un mauvais sort. Comment avait-elle pu revenir aussi vite ?
— Mère... vous étiez dans la forêt avec moi il y a juste quelques minutes et vous m’avez...
Je m’arrêtai net sous son regard à la fois surpris et satisfait.
— Qu’ai-je donc fait, mon fils ? demanda-t-elle calmement.
— Eh bien, n’avez-vous pas attaqué les deux garçons qui me tourmentaient ?
— Les deux garçons ? répéta-t-elle après moi. Et que faisaient-ils ?
Perplexe, je m’assis devant elle sur un des billots de bois équarri. Elle semblait n’avoir pas bougé et pourtant ne paraissait guère étonnée.
— Tu as donc enfin réussi à te tirer d’un mauvais pas, tout seul, Arzel ! ronchonna-t-elle. Il était grand temps que tu te serves de ton don.
— De quel don parlez-vous, mère ? Je n’ai...
Je commençai à bégayer comme chaque fois que j’étais embarrassé et confus, et je m’efforçai alors de respirer calmement.
— Arzel, reprit-elle patiemment. Tu as le don, le même que le mien, et tu le sais depuis toujours... en le repoussant. C’est pourquoi tu ne peux pas l’utiliser. Je n’étais pas avec toi dans la forêt, fils, tu t’es fort bien défendu tout seul.
Je secouai la tête, irrité, en essayant de me souvenir de ce qui s’était passé, mais je butais sur quelque chose d’incompréhensible.
— Il te suffit de vouloir, Arzel. De penser à ce que tu veux. Tu as dû lever la main contre ces jeunes crétins qui s’acharnent parce que tu ne te défends jamais, et ils sont tout simplement venus se fracasser contre la force que tu as libérée. Tu as enfin déclenché le don que tu portes en toi depuis ta naissance.
Ma mère n’en avait jamais tant dit. Elle n’était guère loquace et la plupart du temps nous nous comprenions sans nous parler. C’était comme l’entendre dans ma tête penser et agir.
Je restai silencieux, en la considérant autrement que d’ordinaire. C’était une grande femme, rousse et bien bâtie, qui ne craignait pas les travaux difficiles. J’avais toujours vu les regards que les hommes lui jetaient, mais elle passait son chemin, en les ignorant. Aucun ne se hasardait à l’affronter depuis qu’elle en avait rossé un qui lui avait fait des avances trop précises. Un coup d’épaule, un revers de la main, et il s’était retrouvé accroché à une branche d’arbre sans oser appeler à son secours pour ne pas être humilié.
Comment vivait-elle depuis que j’étais l’élève du barde, hébergé par le seigneur Waroc ? Au fur et à mesure des années, je prenais conscience que je ne savais presque rien d’elle, sauf qu’elle avait dû me mettre au monde après son arrivée en Armorique, vers l’âge de quinze ou seize ans. Elle n’avait jamais été une mère possessive, ni très présente, car il lui avait fallu subvenir seule à nos besoins, mais elle avait pris soin de mes jeunes années. Autour de nous, les femmes n’avaient guère le temps de cajoler leur progéniture, souvent accablées d’enfants, de travail et de maux. Elles mouraient jeunes, et les hommes qui leur survivaient prenaient une autre épouse, jusqu’à ce qu’ils meurent à leur tour.
Pourtant, malgré sa solitude, elle ne semblait manquer de rien grâce à son travail de guérisseuse et à la générosité du seigneur Waroc, qu’elle soignait. Il lui faisait porter le nécessaire pour se nourrir chaque semaine, et je lui déposais moi-même ce dont elle avait besoin à chacune de mes visites. Peu de choses en vérité, car je n’étais pas bien riche même si Waroc rétribuait chacune de mes prestations.
Je chantais pour lui et sa famille, pour ses invités, et je voyageais parfois en Armorique à la suite de Senchan, chez des seigneurs voisins.
— Je ne sais pas de quel don vous parlez, murmurai-je enfin, embarrassé. Je ne peux pas m’attarder, mère. Senchan m’a demandé de chanter ce soir, après lui, pour les invités du seigneur Waroc. C’est un honneur pour moi.
Ma mère hocha simplement la tête en remuant la potion qu’elle faisait réchauffer dans un chaudron.
— Qui sont-ils ?
— Je ne sais pas. On ne me l’a pas dit.
— Fais attention à ce que les gens raconteront au repas. Dans les manses, on parle beaucoup du fils du seigneur Deroc. Iona vient de mourir d’assez étrange façon à la chasse. Un accident semble-t-il, mais...
Elle se tut en hochant la tête et en marmonnant tout bas quelque chose que je ne compris pas.
Ma mère soignait tant de gens qu’on lui rapportait toutes les histoires qui circulaient dans les manses le soir à la veillée. Embellies ou déformées, elles faisaient le sel et la joie des pauvres gens qui les racontaient à leur tour, parfois en y ajoutant des détails de leur cru. C’est dire que korrigans, foliards et autres elfes, censés vivre dans les tertres et au creux de nos forêts impénétrables, emplissaient ces contes, pour le plus grand plaisir du peuple d’Armorique.
Je puisais largement dans cette manne féérique pour créer mes propres chants et les histoires qui plaisaient tant à l’entourage de Waroc et que jalousaient, bien sûr, Rusc et Tren, ces deux gamins arrogants et brutaux qui ne cessaient de me chercher querelle parce qu’ils faisaient partie des élèves de Dychan et apprenaient à se battre pour devenir des guerriers.
— Vous ne semblez pas y croire, hasardai-je, car je savais que ma mère ne me dirait que ce qu’elle voudrait.
Elle haussa les épaules.
— Cela doit bien arranger quelqu’un ! marmonna-t-elle en retirant le chaudron du foyer. Tu porteras cette potion au seigneur Waroc. Pour ses jambes, ajouta-t-elle en me tendant un pot en terre rempli d’une pâte verdâtre. Qu’il se frotte avec matin et soir. Et celui-là est pour ton maître Senchan. Pour sa gorge. Je sais qu’il est facilement enroué. File maintenant, sinon le barde va se fâcher après toi.
En effet Dychan m’attendait à la poterne et il fit des signes désespérés en me voyant arriver.
— Hâte-toi, Arzel. Senchan t’a fait demander et tu sais qu’il n’est point patient... il doit se passer quelque chose d’inhabituel.
J’entrai dans la cour en saluant les gardes et me précipitai vers la hutte réservée au barde. Il grommela quelque chose contre l’irrespect que je montrais en m’attardant ainsi, et je restai debout devant lui sans rien dire, sachant qu’aucune excuse ne trouverait grâce à ses yeux.
— Te voilà enfin, Arzel, dit-il en relevant la tête et en grattant sa barbe, signe chez lui de perplexité. Mais que faisais-tu en t’attardant ainsi alors que nous avons ce soir un invité de marque ?
— J’ignore qui le seigneur Waroc a invité, maître. J’ai répété mon chant en me rendant chez ma mère. Elle m’a remis une potion pour votre gorge, et un baume pour les jambes de messire Waroc
— Bien, bien, pose-les ici et viens me réciter le passage que tu as prévu. C’est La Navigation de Bran ?
— Oui, maître. Je ne savais pas qui serait présent ce soir, et cela doit plaire à chacun.
Senchan se leva, grand dans sa tunique grise ourlée d’argent, et il vint se poster devant l’ouverture qui donnait sur des jardins.
— Nous aurons l’honneur de chanter pour le moine Gweltas !
— Gweltas ! soufflai-je, impressionné et déjà livide à l’idée de réciter devant ce personnage auprès duquel tous les seigneurs d’Armorique s’empressaient. On le disait pieux, et on écoutait sa parole religieusement. Pour ma part je n’en savais pas grand-chose, seulement qu’il était venu de l’île de Bretagne, après avoir vécu en Irlande avec plusieurs moines érudits, dans un endroit isolé pour étudier et travailler dans le dénuement le plus complet où il se nourrissait de poissons et d’œufs d’oiseaux de mer. Sa renommée était grande et tous les personnages importants voulaient le saluer, se faire bien voir et lui amener leurs fils.
Waroc lui-même le tenait en haute estime, et le fait qu’il ait réussi à le persuader de venir lui rendre visite ce soir-là montrait que les deux hommes avaient dû nouer des relations amicales. Depuis peu, on disait qu’il s’était retiré en ermite dans une grotte creusée dans un énorme rocher, près de la rivière Blavet , pour dénoncer vices et crimes de tous les grands personnages, qu’ils soient rois, prêtres, seigneurs ou évêques, et qu’il préparait une diatribe virulente à leur endroit.
— Maître, comment pourrai-je chanter devant un tel homme ? On le dit assez... irascible.
— Tu n’as rien à craindre de lui, Arzel. Il n’en a pour l’instant qu’après le clergé séculier, dit pensivement Senchan. Dis ton texte comme tu sais si bien le faire, reste modeste et à ta place, et tout se passera très bien.
Je n’en étais pas si certain et je me retirai, fébrile et anxieux.
Dychan me rejoignit peu après dans la cour, en me regardant d’un air curieux.
— Bon, Arzel, dis-moi un peu. Que s’est-il passé avec ces jeunes fous de Rusc et Tren ? Ils sont vilainement amochés.
J’ouvris de grands yeux, apeuré, en me souvenant de ce que venait de dire ma mère. Je ne pouvais tout de même pas les avoir blessés moi-même !
— Ils disent qu’ils ont rencontré quelqu’un dans le chemin qui les a attaqués. C’est très confus.
— Est-ce qu’ils m’accusent ? demandai-je inquiet.
— Non... Pourquoi ? C’est d’ailleurs étonnant, car d’habitude ils sont toujours prêts à rejeter la faute sur quelqu’un... et sur toi en particulier. Cette fois ils se taisent comme s’ils avaient honte... ou peur... et ils refusent de venir au banquet ce soir.
— Que leur est-il arrivé ? fis-je du ton le plus détaché possible.
— Ils ont le visage boursoufflé, comme s’ils avaient été brûlés. Qu’ont-ils bien pu encore inventer ? rétorqua Dychan en haussant les épaules. Tu vas devoir te décider à venir t’entraîner à l’épée avec moi, Arzel. Il est grand temps.
— Dychan, je ne suis pas destiné à devenir un guerrier comme eux, tu le sais bien, protestai-je. Je veux être un barde, aussi bon que Senchan.
— Tu le seras, mon ami. Tu l’es déjà et il ne t’a pas choisi au hasard. Mais l’un n’empêche pas l’autre, je t’assure. Notre grand Enchanteur n’était-il pas tout à la fois ?
Il faisait allusion à Merlin qui était dans toutes les mémoires, tous les contes, toutes les légendes qui circulaient de manse en manse autour de ce personnage dont on ne savait pas s’il avait réellement existé ou s’il avait été créé par les bardes qui chantaient ses prouesses et celles du roi Arthur.
— Il était devin, guérisseur, druide et savant, il jouait de la harpe comme personne... mais il savait aussi manier l’épée comme un guerrier. Alors, Arzel, tu viendras chaque jour t’exercer avec moi dans un lieu secret, où personne ne nous verra, jusqu’à ce que tu sois assez habile pour te mesurer à mes autres élèves. Je l’ai promis à ta mère ! Et tu viendras loger dans ma manse, ajouta-t-il.
J’ouvris des yeux étonnés en apprenant que Dychan voyait ma mère en secret et qu’aucun d’eux ne m’en avait jamais rien dit. C’était la journée des découvertes. Ils devaient avoir à peu près le même âge. Dychan était le fils d’un compagnon noble de Waroc, arrivé en Armorique en même temps que lui. Son épouse était morte en couches à la naissance de Dychan, et c’est Waroc qui l’avait pris sous sa protection, après le décès de son père.
— Maintenant, hâte-toi, continua-t-il. J’entends des chevaux dans la cour, Waroc a envoyé chercher son invité.
Il y avait en effet grande effervescence autour des manses et des ruelles qui menaient à l’habitation principale du seigneur des lieux.
Lorsque j’arrivai, vêtu de ma meilleure tunique ceinturée d’un lien torsadé, des sandales de cuir aux pieds, et les cheveux disciplinés et humides, avec ma petite harpe de voyage, je vis de loin le seigneur Waroc accueillir Gweltas et deux de ses compagnons qui descendaient de leurs mules. Ils n’avaient évidemment pas les moyens de s’offrir de bons chevaux, car ils vivaient pauvrement dans leur grotte, d’aumônes et de largesses de leurs ouailles. On disait que Gweltas se contentait de peu, habitué à une vie rude et qu’il refusait les richesses que certains lui offraient, car il ne voulait rien devoir et ne pas être acheté.
Dychan, derrière moi, mit sa main sur mon épaule.
— Je dois te quitter pour assurer la sécurité du repas avec mes élèves. Mais je t’entendrai chanter, mon ami, et je suis certain que tu seras très inspiré comme d’habitude. Ne doute pas de ton don !
Les mêmes paroles que celles de ma mère. Je me retournai pour le regarder, indécis, mais il s’éloignait déjà à grands pas. Je me faufilai alors parmi la foule qui se pressait à l’entrée de la salle enfumée par les bougies, où le seigneur Waroc avait donné des consignes pour ne laisser entrer que les personnes qu’il avait désignées.
Il présiderait le repas avec ses deux fils aînés, Canao et Macliau, et avec Trifine, qui me fit un petit signe discret lorsqu’elle me vit entrer. Elle était vêtue comme d’ordinaire, simplement, d’une longue tunique brodée et ceinturée d’une cordelette de soie, d’un voile ramené sur ses yeux et retenu par un petit cercle d’argent, avec des bottines de peau aux pieds, et se tenait un peu en retrait, entourée de quelques femmes. Yuna, sa demi-sœur, était trop jeune pour être admise à la soirée.
Je rejoignis Senchan, qui devait faire le discours de bienvenue aux moines, et je le vis puiser discrètement dans le petit pot de potion pour la gorge remis par ma mère. Sa voix, fragilisée par les nombreuses prestations qu’on lui réclamait, se brisait parfois, rauque d’émotion et de fatigue, et il ne voulait surtout pas faillir ce soir-là.
Gweltas était dirigé vers la place d’honneur réservée à côté de Waroc et je l’examinai discrètement, curieux de rencontrer enfin ce personnage dont on disait tant de bien et que l’on semblait craindre. Il n’était pas particulièrement imposant bien qu’assez grand, plutôt ascétique, grisonnant, et le visage marqué par les privations et la vie rude. Il était déjà âgé et devait approcher de la cinquantaine, et il s’appuyait sur un bâton noueux et blanc pour se déplacer, comme si ses membres le faisaient souffrir.
Je pris ma place habituelle et mangeai sans grand appétit le ragoût de mouton, bouilli avec des légumes-racines, que les serviteurs déposèrent sur les tables dans de grands pots en terre. Ils distribuèrent en même temps les tranchoirs, de larges tranches de pain bis épais et rassis, et je pris soin de ne pas trop me tacher les doigts pour pouvoir accorder ensuite les cordes de ma harpe. Je bus juste un peu de vin pour me donner de l’assurance et me revigorer, car je tremblais intérieurement. Puis je croisai le regard du moine et je fus étourdi, impressionné par leur intensité. Cet homme-là n’était pas n’importe qui, il était d’essence royale, son père ayant été le roi Caw d’Ecosse, d’après ce que venait de me dire Dychan.
Son regard s’attarda sur moi un instant, comme s’il découvrait quelque chose avec étonnement, puis il se fixa ailleurs et je relâchai ma respiration, figé sur place.
Senchan se mit alors à chanter et ce fut un instant magique. Sa voix chaude, profonde, un peu rocailleuse, vous transportait dans un méandre de sensations inexplicables. On vivait avec lui ce voyage imaginaire, avec les personnages dont il contait les aventures, on attendait la suite, on craignait le dénouement, et lorsque sa voix s’éteignit chacun soupira comme s’il se réveillait d’un rêve !
Gweltas l’appela alors, lui parla tout bas un instant, mit sa main sur les siennes et je vis le regard de Senchan s’illuminer comme celui d’un enfant, alors pourtant qu’il était encensé à chacune de ses prestations.
Lorsque ce fut mon tour, les conversations avaient repris, Waroc s’entretenait lui-même avec les moines et avec ses fils, et j’accordai mon cruit [iv] avec appréhension, dans une sorte de brouhaha.
Mes premières paroles furent noyées dans le bruit qui s’éteignit peu à peu, tandis que ma voix montait dans la salle. On s’arrêta de parler, de manger, et même de boire, et je fus le premier surpris du silence profond qui se fit.
C’est un jour de beau temps éternel
Qui répand l’argent sur les terres
Rocher très blanc sur le brillant de la mer
Sur lequel vient la chaleur du soleil
On écoute la musique dans la nuit
Et l’on arrive dans l’île aux multiples couleurs
Pays magique, splendeur sur un beau diadème
D’où brille la nuée blanche
Des arbres avec des fleurs et des fruits
Sur lesquels s’étend le vrai parfum du vin
Des arbres sans ruine et sans défaut
Sur lesquels sont des feuilles de couleur d’or
Beaucoup reconnurent quelques strophes de La Navigation de Bran et je vis le regard du moine s’attarder sur moi pour m’encourager, bienveillant et surpris.
Ma voix, habituellement embarrassée lorsque je parlais, montait sans hésitation, haute, pure, nette, elle décrivait l’Autre Monde et ses merveilles, et la dernière note chantée, le dernier mot évanoui, je restai un peu perdu, tremblant, comme si j’avais moi-même abordé un rivage inconnu.
Waroc me fit porter un présent pour me récompenser, ce qu’il faisait lorsqu’il était satisfait, et je découvris avec plaisir qu’il m’offrait une salière personnelle, un petit sachet de cuir comme ceux des seigneurs. C’était l’usage d’emporter son sel lors des repas, afin d’éviter les poisons qui pouvaient circuler lorsque vous passiez à table. Mais, bien sûr, j’étais trop pauvre pour en posséder une et je me contentais de ne jamais saler les plats. Je l’en remerciai d’un signe de tête en m’inclinant, puis je quittai discrètement la salle pour retrouver l’air frais tant j’étais épuisé.
Dehors je me heurtai à Rusc et Tren, restés à l’entrée de la salle, qui s’écartèrent de moi en me jetant un mauvais regard. Mais ils ne m’approchèrent pas, comme si je leur faisais peur pour la première fois, et j’en fus étonné. Je me promis alors d’obéir à Dychan et de commencer à m’entraîner à l’épée dès le prochain matin
J’ai longtemps été au service du seigneur Waroc qui régentait l’ancien pagus des Vénètes. Et surtout, surtout, j’ai toujours aimé sa fille Trifine.
Oh ! bien sûr, élève de Senchan, le barde de Waroc, je n’espérais point pouvoir l’épouser un jour. Elle était destinée, de par sa naissance, à quelqu’un de noble, de titré, et de riche, avec des terres, des serviteurs, des esclaves, des clients.
Mais, la nuit, les rêves prennent corps dans l’obscurité généreuse qui vous donne tout ce que vous désirez.
Lorsque j’étais dans la demeure de Waroc, mon cœur était en ébullition, car je savais que Trifine dormait à quelques pas de moi. Mieux logée, certes, que dans la salle que je devais partager avec plusieurs serviteurs, mais je la savais toute proche et cela suffisait à mon bonheur. Elle avait quatorze ans, tout comme moi.
En fait, j’étais heureux ces années-là. J’étais heureux et je ne le savais pas !
Je ne le compris que plus tard, quand ma vie changea et que je fus précipité, bien malgré moi, dans une succession d’événements que je dus affronter pour protéger Trifine.
Senchan, le grand barde du seigneur Waroc, avait bien voulu me prendre sous son aile et m’enseigner son art. Et pourtant j’étais un bâtard, je ne connaissais même pas mon père et, tare suprême, j’étais bègue. Mais dès que je me mettais à chanter et à réciter, l’éloquence me venait, les mots coulaient de ma gorge comme du miel, et les gens, abasourdis, m’écoutaient bouche bée.
Jamais ma mère n’avait voulu me révéler qui était mon père et, les années passant, je me demandais si elle le connaissait elle-même. Voyageur, étranger, ou seigneur qui avait abusé d’elle, je bâtissais mille et une histoires à son sujet et Trifine riait avec moi de mes élucubrations. Quoi qu’il en soit, en sa présence, jamais je ne butais sur mes mots, et c’était pour elle que j’élaborais mes plus beaux chants avant de les réciter en public.
Ce soir-là, insigne honneur, je devais chanter après Senchan, au repas donné par Waroc pour l’un de ses voisins. C’est là que j’appris pour la première fois l’existence de Conomore, le seigneur du Poher, un territoire situé plus au nord de l’Armorique.
J’avais passé la matinée à écrire, à répéter mes chants, à en peaufiner les paroles afin qu’elles soient louangeuses et ne heurtent point les visiteurs, ni leur hôte. Je voulais aussi révéler mon âme et ce que je ressentais sous couvert d’un récit destiné à divertir les invités.
Engourdi, et l’esprit embrouillé, je me décidai à sortir du caer pour aller jusque chez ma mère à qui je rendais visite très souvent. Elle vivait seule à la lisière de la forêt, non loin d’une rivière où elle pêchait, se lavait et nageait comme un poisson.
C’était une femme singulière, une solitaire qui avait toujours refusé d’habiter une manse dans le village où régnait Waroc. Elle était guérisseuse, et banfaith, et les gens la craignaient tout en recherchant sa science des plantes, des herbes, qu’elle mélangeait pour en faire des potions étranges au goût surprenant. Mais nombre d’entre eux guérissaient après l’avoir consultée et sa renommée l’entourait et la protégeait.
En la regardant, lorsque je croyais qu’elle ne m’observait pas, grande, bien charpentée, la peau brunie par ses trajets dans la forêt et ses baignades, je concevais aisément qu’elle plaise aux hommes qui la lorgnaient à la dérobée. Avait-elle cédé à l’un d’eux ou bien avait-elle subi un assaut qu’elle n’avait pu éviter, et dont j’étais la conséquence, elle ne répondait jamais à mes questionnements et haussait les épaules.
Tout en cheminant dans la forêt vers sa manse de torchis et de chaume, je me demandais s’il m’arrivait de côtoyer mon géniteur sans le savoir. Peut-être passions-nous parfois à côté l’un de l’autre, mais je me réjouissais néanmoins d’avoir été accepté dans l’entourage du seigneur Waroc qui pourvoyait à ma nourriture, mon logement et mes besoins.
Je marchais allègrement en répétant les paroles de mon chant, celui de La Navigation de Bran, un long poème récitant que je voulais scander à l’intention de Trifine.
— Je n’aime pas ces repas où me convie mon père, m’avait-elle dit. J’ai toujours peur qu’on vienne me demander. Jusqu’ici il a refusé de m’engager mais viendra un jour où il ne pourra plus refuser...
La tristesse envahissait alors son joli visage, qu’elle cachait sous ses longs cheveux blonds, et j’avais fort à faire pour lui redonner le sourire.
Absorbé par mes pensées et la récitation que j’en faisais à mi-voix, je vis trop tard les jeunes gens qui me barraient le chemin et qui ricanaient.
Rusc et Tren, les élèves de Dychan, le maître d’armes, vivaient eux aussi avec leur famille dans les manses du seigneur Waroc mais, n’étant pas des bâtards, ils me traitaient toujours avec beaucoup de rudesse, irrités de constater que je ne répondais pas à leurs provocations. D’abord parce que je savais que les mots allaient s’embrouiller et me faire bafouiller, qu’alors ils se moqueraient un peu plus de mon infirmité, et ensuite parce que mon mutisme et mon impassibilité apparente, les décontenançaient plus qu’une riposte acerbe.
— Alors, chanteur bâtard, on va voir sa maman ? Tout le monde sait qu’elle t’a eu avec un démon !...
C’était la première fois qu’ils utilisaient cette arme en sachant bien qu’elle allait m’atteindre. Je tiquai en effet et je sentis le rouge de la honte me monter aux joues. En plus de cette difficulté d’élocution, j’avais également une marque violacée au cou, comme une morsure indélébile que je touchai malgré moi en la sentant me brûler tout à coup.
Je restai figé devant eux, paralysé, et certains mots secrets et incompréhensibles que prononçait ma mère lorsqu’elle allumait un feu ou concoctait une potion, me revinrent en mémoire car je les connaissais par cœur. Ils se bousculèrent dans ma tête et, sans même m’en rendre compte, je levai la main vers eux pour les repousser. Il en jaillit une étrange lueur rouge qui les frappa au visage et sembla les déchaîner. Ils se ruèrent alors vers moi qui n’avais rien pour me défendre, je me baissai instinctivement et passai entre eux en tombant sur les genoux et en me protégeant la tête.
J’entendis alors leur grognement de douleur et, en me retournant lentement, je vis ma mère dressée devant eux avec le bâton noueux dont elle ne se séparait jamais et sur lequel leurs têtes avaient heurté. A moitié assommés, ils gisaient à terre et gémissaient lugubrement.
Ma mère avait pris une attitude de farouche guerrière et je ne pus m’empêcher de me demander qui elle était vraiment.
— Sers-toi donc de ton don pour te défendre, Arzel, souffla-t-elle d’une voix mécontente.
— Mais je n’ai... commençai-je en balbutiant.
Elle me foudroya du regard et se mit en marche.
— Allons, j’ai à faire...
Je la suivis sans protester en jetant un dernier coup d’œil aux choses misérables qu’étaient devenus les deux garçons qui n’avaient sans doute rien compris à la scène. En tireraient-ils la leçon ou bien serais-je encore plus malmené ? Pour l’instant il m’importait seulement de rattraper la grande foulée vigoureuse de ma mère, qui se dirigeait vers sa manse.
Elle avançait si vite dans le sentier que je la perdis de vue tout de suite, et pourtant je courais presque, la respiration hachée, de crainte que les deux garçons ne se relèvent et me rejoignent. Mais j’étais seul, et je vis enfin la demeure où elle vivait et où je m’engouffrai presque en tombant.
Ma mère me vit arriver, assise près de son feu creusé au milieu de la pièce, sur le sol de terre battue, et je restai un instant ébahi de la trouver aussi paisible, occupée à ses tâches coutumières alors que, l’instant d’avant elle m’avait tiré d’un mauvais sort. Comment avait-elle pu revenir aussi vite ?
— Mère... vous étiez dans la forêt avec moi il y a juste quelques minutes et vous m’avez...
Je m’arrêtai net sous son regard à la fois surpris et satisfait.
— Qu’ai-je donc fait, mon fils ? demanda-t-elle calmement.
— Eh bien, n’avez-vous pas attaqué les deux garçons qui me tourmentaient ?
— Les deux garçons ? répéta-t-elle après moi. Et que faisaient-ils ?
Perplexe, je m’assis devant elle sur un des billots de bois équarri. Elle semblait n’avoir pas bougé et pourtant ne paraissait guère étonnée.
— Tu as donc enfin réussi à te tirer d’un mauvais pas, tout seul, Arzel ! ronchonna-t-elle. Il était grand temps que tu te serves de ton don.
— De quel don parlez-vous, mère ? Je n’ai...
Je commençai à bégayer comme chaque fois que j’étais embarrassé et confus, et je m’efforçai alors de respirer calmement.
— Arzel, reprit-elle patiemment. Tu as le don, le même que le mien, et tu le sais depuis toujours... en le repoussant. C’est pourquoi tu ne peux pas l’utiliser. Je n’étais pas avec toi dans la forêt, fils, tu t’es fort bien défendu tout seul.
Je secouai la tête, irrité, en essayant de me souvenir de ce qui s’était passé, mais je butais sur quelque chose d’incompréhensible.
— Il te suffit de vouloir, Arzel. De penser à ce que tu veux. Tu as dû lever la main contre ces jeunes crétins qui s’acharnent parce que tu ne te défends jamais, et ils sont tout simplement venus se fracasser contre la force que tu as libérée. Tu as enfin déclenché le don que tu portes en toi depuis ta naissance.
Ma mère n’en avait jamais tant dit. Elle n’était guère loquace et la plupart du temps nous nous comprenions sans nous parler. C’était comme l’entendre dans ma tête penser et agir.
Je restai silencieux, en la considérant autrement que d’ordinaire. C’était une grande femme, rousse et bien bâtie, qui ne craignait pas les travaux difficiles. J’avais toujours vu les regards que les hommes lui jetaient, mais elle passait son chemin, en les ignorant. Aucun ne se hasardait à l’affronter depuis qu’elle en avait rossé un qui lui avait fait des avances trop précises. Un coup d’épaule, un revers de la main, et il s’était retrouvé accroché à une branche d’arbre sans oser appeler à son secours pour ne pas être humilié.
Comment vivait-elle depuis que j’étais l’élève du barde, hébergé par le seigneur Waroc ? Au fur et à mesure des années, je prenais conscience que je ne savais presque rien d’elle, sauf qu’elle avait dû me mettre au monde après son arrivée en Armorique, vers l’âge de quinze ou seize ans. Elle n’avait jamais été une mère possessive, ni très présente, car il lui avait fallu subvenir seule à nos besoins, mais elle avait pris soin de mes jeunes années. Autour de nous, les femmes n’avaient guère le temps de cajoler leur progéniture, souvent accablées d’enfants, de travail et de maux. Elles mouraient jeunes, et les hommes qui leur survivaient prenaient une autre épouse, jusqu’à ce qu’ils meurent à leur tour.
Pourtant, malgré sa solitude, elle ne semblait manquer de rien grâce à son travail de guérisseuse et à la générosité du seigneur Waroc, qu’elle soignait. Il lui faisait porter le nécessaire pour se nourrir chaque semaine, et je lui déposais moi-même ce dont elle avait besoin à chacune de mes visites. Peu de choses en vérité, car je n’étais pas bien riche même si Waroc rétribuait chacune de mes prestations.
Je chantais pour lui et sa famille, pour ses invités, et je voyageais parfois en Armorique à la suite de Senchan, chez des seigneurs voisins.
— Je ne sais pas de quel don vous parlez, murmurai-je enfin, embarrassé. Je ne peux pas m’attarder, mère. Senchan m’a demandé de chanter ce soir, après lui, pour les invités du seigneur Waroc. C’est un honneur pour moi.
Ma mère hocha simplement la tête en remuant la potion qu’elle faisait réchauffer dans un chaudron.
— Qui sont-ils ?
— Je ne sais pas. On ne me l’a pas dit.
— Fais attention à ce que les gens raconteront au repas. Dans les manses, on parle beaucoup du fils du seigneur Deroc. Iona vient de mourir d’assez étrange façon à la chasse. Un accident semble-t-il, mais...
Elle se tut en hochant la tête et en marmonnant tout bas quelque chose que je ne compris pas.
Ma mère soignait tant de gens qu’on lui rapportait toutes les histoires qui circulaient dans les manses le soir à la veillée. Embellies ou déformées, elles faisaient le sel et la joie des pauvres gens qui les racontaient à leur tour, parfois en y ajoutant des détails de leur cru. C’est dire que korrigans, foliards et autres elfes, censés vivre dans les tertres et au creux de nos forêts impénétrables, emplissaient ces contes, pour le plus grand plaisir du peuple d’Armorique.
Je puisais largement dans cette manne féérique pour créer mes propres chants et les histoires qui plaisaient tant à l’entourage de Waroc et que jalousaient, bien sûr, Rusc et Tren, ces deux gamins arrogants et brutaux qui ne cessaient de me chercher querelle parce qu’ils faisaient partie des élèves de Dychan et apprenaient à se battre pour devenir des guerriers.
— Vous ne semblez pas y croire, hasardai-je, car je savais que ma mère ne me dirait que ce qu’elle voudrait.
Elle haussa les épaules.
— Cela doit bien arranger quelqu’un ! marmonna-t-elle en retirant le chaudron du foyer. Tu porteras cette potion au seigneur Waroc. Pour ses jambes, ajouta-t-elle en me tendant un pot en terre rempli d’une pâte verdâtre. Qu’il se frotte avec matin et soir. Et celui-là est pour ton maître Senchan. Pour sa gorge. Je sais qu’il est facilement enroué. File maintenant, sinon le barde va se fâcher après toi.
En effet Dychan m’attendait à la poterne et il fit des signes désespérés en me voyant arriver.
— Hâte-toi, Arzel. Senchan t’a fait demander et tu sais qu’il n’est point patient... il doit se passer quelque chose d’inhabituel.
J’entrai dans la cour en saluant les gardes et me précipitai vers la hutte réservée au barde. Il grommela quelque chose contre l’irrespect que je montrais en m’attardant ainsi, et je restai debout devant lui sans rien dire, sachant qu’aucune excuse ne trouverait grâce à ses yeux.
— Te voilà enfin, Arzel, dit-il en relevant la tête et en grattant sa barbe, signe chez lui de perplexité. Mais que faisais-tu en t’attardant ainsi alors que nous avons ce soir un invité de marque ?
— J’ignore qui le seigneur Waroc a invité, maître. J’ai répété mon chant en me rendant chez ma mère. Elle m’a remis une potion pour votre gorge, et un baume pour les jambes de messire Waroc
— Bien, bien, pose-les ici et viens me réciter le passage que tu as prévu. C’est La Navigation de Bran ?
— Oui, maître. Je ne savais pas qui serait présent ce soir, et cela doit plaire à chacun.
Senchan se leva, grand dans sa tunique grise ourlée d’argent, et il vint se poster devant l’ouverture qui donnait sur des jardins.
— Nous aurons l’honneur de chanter pour le moine Gweltas !
— Gweltas ! soufflai-je, impressionné et déjà livide à l’idée de réciter devant ce personnage auprès duquel tous les seigneurs d’Armorique s’empressaient. On le disait pieux, et on écoutait sa parole religieusement. Pour ma part je n’en savais pas grand-chose, seulement qu’il était venu de l’île de Bretagne, après avoir vécu en Irlande avec plusieurs moines érudits, dans un endroit isolé pour étudier et travailler dans le dénuement le plus complet où il se nourrissait de poissons et d’œufs d’oiseaux de mer. Sa renommée était grande et tous les personnages importants voulaient le saluer, se faire bien voir et lui amener leurs fils.
Waroc lui-même le tenait en haute estime, et le fait qu’il ait réussi à le persuader de venir lui rendre visite ce soir-là montrait que les deux hommes avaient dû nouer des relations amicales. Depuis peu, on disait qu’il s’était retiré en ermite dans une grotte creusée dans un énorme rocher, près de la rivière Blavet , pour dénoncer vices et crimes de tous les grands personnages, qu’ils soient rois, prêtres, seigneurs ou évêques, et qu’il préparait une diatribe virulente à leur endroit.
— Maître, comment pourrai-je chanter devant un tel homme ? On le dit assez... irascible.
— Tu n’as rien à craindre de lui, Arzel. Il n’en a pour l’instant qu’après le clergé séculier, dit pensivement Senchan. Dis ton texte comme tu sais si bien le faire, reste modeste et à ta place, et tout se passera très bien.
Je n’en étais pas si certain et je me retirai, fébrile et anxieux.
Dychan me rejoignit peu après dans la cour, en me regardant d’un air curieux.
— Bon, Arzel, dis-moi un peu. Que s’est-il passé avec ces jeunes fous de Rusc et Tren ? Ils sont vilainement amochés.
J’ouvris de grands yeux, apeuré, en me souvenant de ce que venait de dire ma mère. Je ne pouvais tout de même pas les avoir blessés moi-même !
— Ils disent qu’ils ont rencontré quelqu’un dans le chemin qui les a attaqués. C’est très confus.
— Est-ce qu’ils m’accusent ? demandai-je inquiet.
— Non... Pourquoi ? C’est d’ailleurs étonnant, car d’habitude ils sont toujours prêts à rejeter la faute sur quelqu’un... et sur toi en particulier. Cette fois ils se taisent comme s’ils avaient honte... ou peur... et ils refusent de venir au banquet ce soir.
— Que leur est-il arrivé ? fis-je du ton le plus détaché possible.
— Ils ont le visage boursoufflé, comme s’ils avaient été brûlés. Qu’ont-ils bien pu encore inventer ? rétorqua Dychan en haussant les épaules. Tu vas devoir te décider à venir t’entraîner à l’épée avec moi, Arzel. Il est grand temps.
— Dychan, je ne suis pas destiné à devenir un guerrier comme eux, tu le sais bien, protestai-je. Je veux être un barde, aussi bon que Senchan.
— Tu le seras, mon ami. Tu l’es déjà et il ne t’a pas choisi au hasard. Mais l’un n’empêche pas l’autre, je t’assure. Notre grand Enchanteur n’était-il pas tout à la fois ?
Il faisait allusion à Merlin qui était dans toutes les mémoires, tous les contes, toutes les légendes qui circulaient de manse en manse autour de ce personnage dont on ne savait pas s’il avait réellement existé ou s’il avait été créé par les bardes qui chantaient ses prouesses et celles du roi Arthur.
— Il était devin, guérisseur, druide et savant, il jouait de la harpe comme personne... mais il savait aussi manier l’épée comme un guerrier. Alors, Arzel, tu viendras chaque jour t’exercer avec moi dans un lieu secret, où personne ne nous verra, jusqu’à ce que tu sois assez habile pour te mesurer à mes autres élèves. Je l’ai promis à ta mère ! Et tu viendras loger dans ma manse, ajouta-t-il.
J’ouvris des yeux étonnés en apprenant que Dychan voyait ma mère en secret et qu’aucun d’eux ne m’en avait jamais rien dit. C’était la journée des découvertes. Ils devaient avoir à peu près le même âge. Dychan était le fils d’un compagnon noble de Waroc, arrivé en Armorique en même temps que lui. Son épouse était morte en couches à la naissance de Dychan, et c’est Waroc qui l’avait pris sous sa protection, après le décès de son père.
— Maintenant, hâte-toi, continua-t-il. J’entends des chevaux dans la cour, Waroc a envoyé chercher son invité.
Il y avait en effet grande effervescence autour des manses et des ruelles qui menaient à l’habitation principale du seigneur des lieux.
Lorsque j’arrivai, vêtu de ma meilleure tunique ceinturée d’un lien torsadé, des sandales de cuir aux pieds, et les cheveux disciplinés et humides, avec ma petite harpe de voyage, je vis de loin le seigneur Waroc accueillir Gweltas et deux de ses compagnons qui descendaient de leurs mules. Ils n’avaient évidemment pas les moyens de s’offrir de bons chevaux, car ils vivaient pauvrement dans leur grotte, d’aumônes et de largesses de leurs ouailles. On disait que Gweltas se contentait de peu, habitué à une vie rude et qu’il refusait les richesses que certains lui offraient, car il ne voulait rien devoir et ne pas être acheté.
Dychan, derrière moi, mit sa main sur mon épaule.
— Je dois te quitter pour assurer la sécurité du repas avec mes élèves. Mais je t’entendrai chanter, mon ami, et je suis certain que tu seras très inspiré comme d’habitude. Ne doute pas de ton don !
Les mêmes paroles que celles de ma mère. Je me retournai pour le regarder, indécis, mais il s’éloignait déjà à grands pas. Je me faufilai alors parmi la foule qui se pressait à l’entrée de la salle enfumée par les bougies, où le seigneur Waroc avait donné des consignes pour ne laisser entrer que les personnes qu’il avait désignées.
Il présiderait le repas avec ses deux fils aînés, Canao et Macliau, et avec Trifine, qui me fit un petit signe discret lorsqu’elle me vit entrer. Elle était vêtue comme d’ordinaire, simplement, d’une longue tunique brodée et ceinturée d’une cordelette de soie, d’un voile ramené sur ses yeux et retenu par un petit cercle d’argent, avec des bottines de peau aux pieds, et se tenait un peu en retrait, entourée de quelques femmes. Yuna, sa demi-sœur, était trop jeune pour être admise à la soirée.
Je rejoignis Senchan, qui devait faire le discours de bienvenue aux moines, et je le vis puiser discrètement dans le petit pot de potion pour la gorge remis par ma mère. Sa voix, fragilisée par les nombreuses prestations qu’on lui réclamait, se brisait parfois, rauque d’émotion et de fatigue, et il ne voulait surtout pas faillir ce soir-là.
Gweltas était dirigé vers la place d’honneur réservée à côté de Waroc et je l’examinai discrètement, curieux de rencontrer enfin ce personnage dont on disait tant de bien et que l’on semblait craindre. Il n’était pas particulièrement imposant bien qu’assez grand, plutôt ascétique, grisonnant, et le visage marqué par les privations et la vie rude. Il était déjà âgé et devait approcher de la cinquantaine, et il s’appuyait sur un bâton noueux et blanc pour se déplacer, comme si ses membres le faisaient souffrir.
Je pris ma place habituelle et mangeai sans grand appétit le ragoût de mouton, bouilli avec des légumes-racines, que les serviteurs déposèrent sur les tables dans de grands pots en terre. Ils distribuèrent en même temps les tranchoirs, de larges tranches de pain bis épais et rassis, et je pris soin de ne pas trop me tacher les doigts pour pouvoir accorder ensuite les cordes de ma harpe. Je bus juste un peu de vin pour me donner de l’assurance et me revigorer, car je tremblais intérieurement. Puis je croisai le regard du moine et je fus étourdi, impressionné par leur intensité. Cet homme-là n’était pas n’importe qui, il était d’essence royale, son père ayant été le roi Caw d’Ecosse, d’après ce que venait de me dire Dychan.
Son regard s’attarda sur moi un instant, comme s’il découvrait quelque chose avec étonnement, puis il se fixa ailleurs et je relâchai ma respiration, figé sur place.
Senchan se mit alors à chanter et ce fut un instant magique. Sa voix chaude, profonde, un peu rocailleuse, vous transportait dans un méandre de sensations inexplicables. On vivait avec lui ce voyage imaginaire, avec les personnages dont il contait les aventures, on attendait la suite, on craignait le dénouement, et lorsque sa voix s’éteignit chacun soupira comme s’il se réveillait d’un rêve !
Gweltas l’appela alors, lui parla tout bas un instant, mit sa main sur les siennes et je vis le regard de Senchan s’illuminer comme celui d’un enfant, alors pourtant qu’il était encensé à chacune de ses prestations.
Lorsque ce fut mon tour, les conversations avaient repris, Waroc s’entretenait lui-même avec les moines et avec ses fils, et j’accordai mon cruit [iv] avec appréhension, dans une sorte de brouhaha.
Mes premières paroles furent noyées dans le bruit qui s’éteignit peu à peu, tandis que ma voix montait dans la salle. On s’arrêta de parler, de manger, et même de boire, et je fus le premier surpris du silence profond qui se fit.
C’est un jour de beau temps éternel
Qui répand l’argent sur les terres
Rocher très blanc sur le brillant de la mer
Sur lequel vient la chaleur du soleil
On écoute la musique dans la nuit
Et l’on arrive dans l’île aux multiples couleurs
Pays magique, splendeur sur un beau diadème
D’où brille la nuée blanche
Des arbres avec des fleurs et des fruits
Sur lesquels s’étend le vrai parfum du vin
Des arbres sans ruine et sans défaut
Sur lesquels sont des feuilles de couleur d’or
Beaucoup reconnurent quelques strophes de La Navigation de Bran et je vis le regard du moine s’attarder sur moi pour m’encourager, bienveillant et surpris.
Ma voix, habituellement embarrassée lorsque je parlais, montait sans hésitation, haute, pure, nette, elle décrivait l’Autre Monde et ses merveilles, et la dernière note chantée, le dernier mot évanoui, je restai un peu perdu, tremblant, comme si j’avais moi-même abordé un rivage inconnu.
Waroc me fit porter un présent pour me récompenser, ce qu’il faisait lorsqu’il était satisfait, et je découvris avec plaisir qu’il m’offrait une salière personnelle, un petit sachet de cuir comme ceux des seigneurs. C’était l’usage d’emporter son sel lors des repas, afin d’éviter les poisons qui pouvaient circuler lorsque vous passiez à table. Mais, bien sûr, j’étais trop pauvre pour en posséder une et je me contentais de ne jamais saler les plats. Je l’en remerciai d’un signe de tête en m’inclinant, puis je quittai discrètement la salle pour retrouver l’air frais tant j’étais épuisé.
Dehors je me heurtai à Rusc et Tren, restés à l’entrée de la salle, qui s’écartèrent de moi en me jetant un mauvais regard. Mais ils ne m’approchèrent pas, comme si je leur faisais peur pour la première fois, et j’en fus étonné. Je me promis alors d’obéir à Dychan et de commencer à m’entraîner à l’épée dès le prochain matin
Extrait : "Le passeur de Temps"

La femme dort. L’homme mastique un morceau de viande rôtie et froide, un reste de son repas précédent, et il la regarde, perplexe. Il se demande comment la soigner. Il est seul et il n’a rien. Il essaie de se souvenir comment fait Leu, le chaman de leur clan. Il est tenté d’aller le trouver à la faveur de la nuit, mais, s’il rencontre Ron, leur affrontement sera inévitable. Ron l’a évincé de leur village après une lutte pour décider qui des deux serait le prochain chef, et Arth a perdu le combat. Il s’est retiré dans ce coin qui peut lui fournir tout ce dont il a besoin, nourriture et animaux à chasser dans les bois, et il s’est mis à la tâche pour construire ce tumulus. Parfois, quelqu’un du clan vient l’aider en cachette de Ron et lui donner des nouvelles.
Arth secoue la tête et décide qu’il n’ira pas au village de huttes finalement.
Il connaît un peu les herbes et va essayer de trouver ce qu’il faut pour soigner la femme blessée qui tremble et gémit, et il se lève pour la couvrir d’une des peaux suspendues aux poteaux de la hutte.
Il verse un peu d’eau dans une calebasse et commence à lui laver le visage et la tête où la blessure a séché et fait une croûte. Elle s’agite et il pose une main qui se veut rassurante sur son front. Cela a l’air de la calmer et il hoche la tête, satisfait.
Ses cheveux restent poisseux et il ne parvient pas à laver le sang coagulé sans lui en mettre plein le front et mouiller sa tunique. Alors il renonce et se met à piler les plantes qu’il a sous la main. Il n’a plus le temps d’en chercher d’autres dans les bois et verra plus tard à trouver celles qui peuvent l’aider à guérir sa fièvre. Il lui fait boire la mixture à petites gorgées, sans qu’elle ouvre les yeux, et il regarde sa jambe qui lui paraît bizarre. Il la tâte tout le long, de la cuisse au talon. Son cri de gorge étranglé et douloureux lui fait comprendre qu’elle est déboîtée ou cassée.
Il grogne de mécontentement. La femme ne pourra pas marcher et il va devoir s’en occuper, alors qu’il a tant de travail avec le cairn, la pêche, le feu, la préparation des repas, le transport de l’eau douce.
Il tourne en rond dans la hutte en la regardant, puis vient s’accroupir à ses pieds. La remettre sur la plage ou dans les bois jusqu’à ce qu’elle meure ? Il se gratte la tête, incertain, en lui massant le pied dans sa grande main pour le réchauffer. Sa peau douce réveille en lui des sensations presque oubliées. Cela fait bien longtemps qu’il n’y a plus de femme dans sa vie, ni dans sa couche. Il est trop vieux maintenant pour qu’on lui en attribue une. Les hommes jeunes se servent d’abord parmi les filles nubiles pour les former à leur goût. Celles qui restent sont vieilles et hors d’usage et ne s’occupent plus que des travaux domestiques. Et puis elles meurent.
Arth ajoute des bûches dans le feu pour la nuit, afin qu’il ne s’éteigne pas, pour les protéger des loups et autres bêtes de la forêt qui s’aventurent près de la hutte. Il va s’allonger près de la femme pour lui tenir chaud et s’endort en ronflant.
Awa se réveille au milieu de la nuit, la peur au ventre, et elle ne peut s’empêcher de crier. Arth se dresse d’un bond, alerté, son bâton à la main, puis il comprend que c’est sa présence, lové contre elle, qui l’a effrayée. Il fait alors un signe de paix, s’écarte un peu pour la tranquilliser et va ranimer les braises encore chaudes avant d’aller se soulager dehors contre un arbre. Awa essaie de se lever, elle a besoin elle aussi de vider sa vessie, mais la douleur se déchaîne, la laissant au bord de l’évanouissement. Elle se laisse retomber sans force en pleurant de souffrance.
Arth l’entend haleter et réfléchit longuement. Puis il va chercher des morceaux de bois qu’il s’applique à tailler avec la plus petite de ses haches. Il aime tailler et sculpter, et il revient vers elle, satisfait de son travail.
— Réparer la jambe, dit-il brièvement pour la rassurer car il sait bien qu’il va lui faire mal.
Elle comprend ce qu’il veut faire pour sa jambe blessée pendant sa fuite. Elle s’est traînée comme elle a pu jusqu’à cette plage pour laver ses plaies dans l’eau salée et empêcher l’infection. Mais elle n’a eu assez de forces pour l’atteindre et s’est écroulée sur le sable à quelques pas de l’eau, derrière un rocher.
Son poursuivant a dû renoncer à la chercher à la tombée du jour, car il était trop dangereux d’errer seul dans les bois. Et puis, il avait eu ce qu’il voulait, il avait réussi à prendre cette femelle qui osait ne pas vouloir de lui.
Awa se demande comment elle est arrivée dans la hutte de cet homme qui semble l’avoir soignée, et elle ne peut que s’en remettre à lui quelle que soit son exigence. Il lui indique par signes ce qu’il va faire en lui montrant les morceaux de bois et les lanières.
Elle le laisse palper sa chair meurtrie, chercher quelque chose, puis il tire brutalement d’un seul coup, sans l’avertir, avec un petit rire satisfait. Elle hurle, mais il se contente de secouer la tête.
— Bon, dit-il. Bon. Jambe remise. Pas cassée !
Il place alors les deux attelles pour la tenir raide avec les liens de roseaux et lui fait signe de ne pas bouger. Il ne parle guère, quelques raclements de gorge, des murmures presque inintelligibles. Elle s’applique à respirer profondément pour attendre que la douleur s’apaise, et le regarde sous ses paupières demi closes, des larmes dans les yeux. Il n’a pas l’air méchant et elle devine, aux débris qu’elle aperçoit dans et autour de la hutte, qu’il doit être en train de construire un tumulus. Mais pourquoi est-il chargé seul de ce travail ? Son clan l’y a t-il obligé pour expier quelque faute ?
Awa, épuisée, boit docilement la potion verdâtre et amère qu’il lui tend, puis se rendort.
Alwena soupire, tressaille. Les images vont et viennent sans ordre dans sa tête. Un rayon de soleil jaune orangé éclaire le menhir et son visage. Sans sortir de son songe, elle s’allonge sur le dos, la tête appuyée sur la base du menhir, parmi les fleurs de printemps.
Il se met à pleuvoir dans la nuit. La femme dont il ne sait pas le nom grelotte et vient se recroqueviller, puis finalement se lover contre Arth, comme un petit animal cherche la chaleur de sa mère.
Arth vit seul depuis si longtemps que le contact avec ce corps féminin plein et pulpeux l’effraye presque, tant il lève en lui brutalement, avec ces odeurs douces et sensuelles, des émotions oubliées. Pas vraiment oubliées, non, plutôt enterrées au plus profond de lui. Il est devenu un vieux loup solitaire, comme celui qu’il entend hurler dans les bois certaines nuits. Ce mâle hurle-t-il sa faim, sa peine, ou bien son cri puissant traverse-t-il seulement l’espace pour porter sa présence chez ses congénères et chez les humains qui le craignent et le chassent ?
En perdant le combat contre Ron, Arth a perdu son clan en même temps. Il n’a rien dit, il est seulement entré dans sa hutte prendre ses possessions, quelques peaux et tuniques tissées, son arc et sa hache, ses outils de taille, sa calebasse et des ustensiles en bois et en poterie. Attachés à un bâton jeté sur son épaule, ses maigres biens s’en sont allés avec lui, libérant ainsi sa hutte qu’on se disputait déjà.
Les hommes de Ron l’ont laissé partir sans le saluer. Ses anciens partisans, eux, l’ont suivi un bout de chemin, et lorsqu’il leur a fait signe de ne pas aller plus loin pour ne pas mécontenter leur nouveau chef, ils ont obéi et se sont arrêtés pour le regarder disparaître de leur vie.
Il s’est construit cette hutte en quelques jours en abattant de jeunes arbres avec sa hache, puis il a tressé des roseaux pour la couvrir, en s’enfonçant dans les marais et au bord de l’étang où ils poussent en abondance. L’étang lui fournit aussi des poissons d’eau douce et des grenouilles, la mer, des coquillages, des huîtres sauvages, et les ruisseaux, de l’eau pour boire.
Arth resserre ses bras autour de la femme qui cesse peu à peu de trembler. Elle lui semble encore assez jeune, et son visage, quoique marqué par la souffrance et les meurtrissures, plutôt agréable à regarder, la peau est brune, elle a d’épais sourcils, une bouche charnue, et ses mâchoires carrées indiquent qu’elle doit être forte et courageuse.
Il sort de son songe lénifiant en entendant la pluie redoubler. L’humidité gagne et il lui faut se lever pour allumer un autre feu à l’intérieur s’ils ne veulent pas avoir les membres engourdis tous les deux au petit matin.
Il répugne à quitter la chaleur de la couche mais, s’il attend trop, les braises vont s’éteindre et ce sera une longue corvée que de refaire un feu. Il repousse la tête de la femme sur les fourrures et se dirige vers le coin qu’il a creusé dans le sol, pour jeter les braises encore brûlantes sur le bois préparé. Le feu prend vite et Arth le nourrit abondamment avant de revenir s’allonger.
Il rêve de nourriture chaude et grillée et sourit un peu car il sait que la femme va maintenant guérir. Mais que va-t-elle faire, et lui que va-t-il pouvoir en faire ?
La nuit s’étire, il dort et se réveille souvent en guettant l’aube, avec gratitude pour ce bien-être qu’il n’a plus ressenti depuis longtemps.
Lorsqu’elle se réveille à son tour, Awa constate qu’elle est seule et que son étrange sauveur est sans doute parti à ses occupations habituelles. Elle grimace en bougeant, ankylosée par l’humidité, puis exerce avec précaution sa jambe délivrée des planchettes de bois. La douleur irradie encore jusqu’au mollet et au pied, mais elle est maintenant supportable et elle se lève pour faire le tour de la hutte, sans trop appuyer sur l’endroit fragile. Il n’y a pas grand-chose, quelques peaux suspendues, des ustensiles pour l’eau et la nourriture, le feu dans une petite fosse creusée dans le sol. Il n’y a plus rien à manger et elle sent la faim lui tenailler le ventre.
Elle sort en claudiquant pour se soulager derrière un buisson, à quelques pas de la hutte, puis elle enlève son vêtement pour le mettre à l’abri et offrir son corps nu à la pluie afin de se débarrasser des miasmes de fièvre, de sueur et de sang, et laver sa chevelure. Elle rentre alors se recouvrir par crainte de se trouver ainsi surprise, car elle se souvient avec un frisson de peur et de dégoût de l’assaut qu’elle a dû subir dans le bois. Ses entrailles en sont encore douloureuses, sa chair meurtrie, et de longues écorchures rougeâtres zèbrent ses cuisses et ses fesses, là où il l’a battue pour la faire céder. Sans plus de compagnon pour la protéger, elle a déjà dû supporter des étreintes forcées, car les hommes de son clan s’emparent brutalement des femmes lorsqu’elles sont à leur portée. Celui qu’on voulait lui imposer l’avait prise en chasse et, une fois rattrapée près d’un étang dans lequel il l’avait poussée, elle avait compris qu’il la tuerait si elle résistait trop. Lorsqu’il avait eu ce qu’il voulait, sans le laisser reprendre ses forces, et bien que blessée, elle avait réussi à s’enfuir après une course haletante jusqu’à cette plage où elle s’était évanouie.
Arth rentre au milieu de la journée. La femme est couchée en boule, dos tourné, et il remarque tout de suite qu’elle a dû pleurer, mais aussi qu’elle a pu se lever. Ses soins ont réussi et il grommelle, satisfait de lui.
Il a rapporté de quoi manger, des coquillages et un lièvre attrapé dans un de ses collets posés dans les bois. Il commence à le dépouiller hors de la hutte et Awa se relève pour venir près lui, alors qu’il l’embroche sur de longues piques de bois.
— Awa va cuire le lièvre. Son travail, dit-elle en tendant la main.
Arth fait un signe de tête et lui tend le gibier qu’elle va adroitement installer sur le feu. Il la regarde faire un moment avec un mince sourire. C’est le rôle des femmes, elle saura s’en charger.
Il revient plus tard quand l’odeur lui fait comprendre qu’il a très faim et il s’assoit sur le sol à côté d’elle qui surveille la cuisson en l’attendant. Il sort son tranchoir pour tailler des morceaux brûlants et lui en tend un qu’elle porte avec précaution à sa bouche blessée, pour ne pas se brûler.
Ils se regardent alors pour la première fois en face et, le ventre enfin plein, ils se sourient timidement.
Awa a perçu brusquement l’intérêt que lui manifeste Arth depuis quelques nuits. Elle sait maintenant son nom. Il n’a rien tenté encore pour l’approcher physiquement, mais elle ressent sa tension lorsqu’il est couché près d’elle.
Elle s’éloigne alors le plus possible, raidit son corps, tendue comme un arc défensif, et il devine cette hostilité qu’elle dégage malgré elle.
Elle a peur. Elle a mal. Tout son ventre forcé, violenté, meurtri, la fait souffrir et l’oblige à marcher encore courbée. Les coups reçus ont laissé de grandes marques qui virent au jaune et violet, et elle les regarde avec dégoût et fureur. L’un de ses yeux, gonflé aussi, lui ferme à moitié la paupière et brouille sa vue.
Elle s’acquitte pourtant des tâches que lui a confié Arth, surveiller le feu, vider les poissons, cuire la nourriture. Pour l’instant elle ne peut guère se déplacer qu’autour de la hutte et elle sent bien qu’Arth ne veut pas qu’elle s’éloigne, sans doute pour qu’on ne découvre pas sa présence. Personne n’est venu encore le voir, mais il doit bien avoir des visites de son clan de temps en temps, et elle ne sait pas comment elle sera accueillie, ni s’il devra se séparer d’elle et la renvoyer.
Arth se baigne tous les soirs dans la baie, avant de se coucher près d’elle, et elle attend avec impatience le moment de pouvoir en faire autant. Il respire fort à son côté, un rayon de lune qui pénètre par l’ouverture de la hutte lui fait deviner son profil un peu sévère, et elle lui tourne le dos pour ne pas le voir et l’inciter à la toucher.
Il va lui falloir sans doute repartir, car il ne la gardera pas près de lui, mais où pourra-t-elle aller, maintenant qu’elle a fui son propre clan ? Si elle y revient ce sera pour être la compagne de l’homme qui l’a violentée, et sa vie deviendra un enfer. Chercher un autre clan ailleurs ? Qui voudra d’elle ? Les femmes la chasseront en la considérant comme une rivale, et les hommes, déjà pourvus d’une compagne, s’en serviront peut-être une où deux fois avant de la reléguer dans un coin ou de la donner encore à quelqu’un qu’elle ne pourra pas choisir.
Awa se met à pleurer malgré elle, désespérée de ne voir aucune issue à cette vie qui a été sauvée par l’homme qui dort à son côté, et elle sent la main de Arth sur son épaule. Une main juste apaisante et calme, qui ne demande rien.
— Awa ne doit pas pleurer. Arth est là, dit-il seulement.
Surprise, elle s’apaise, ses sanglots transformés en longs soupirs saccadés, puis elle s’endort enfin sous la protection de ce bras lourd et rassurant.
Alwena gémit, assaillie d’images dans lesquelles elle est immergée, et c’est le vol d’un oiseau et son cri strident qui traverse l’air qui la fait sortir de ce songe. Elle se traîne un peu sur le sol pour s’écarter du menhir et sortir de son emprise. Mais le rêve s’incruste et ne la lâche pas, apportant d’autres images en rafales épuisantes.
Arth n’aurait jamais cru cela ! Awa fait face au loup.
Le vieux solitaire, qu’il entend hurler certains soirs, s’est approché bien plus près de la hutte que d’ordinaire où il reste dissimulé dans les fourrés du bois. Awa et lui se regardent sans bouger, paisiblement. Les yeux verts et brillants du loup fixés sur la femme qui ne semble pas effrayée.
Arth, indécis, se demande ce qu’il doit faire. Révéler sa présence, aller chercher son arc pour tirer sur la bête ? Mais le loup sera parti avant qu’il puisse faire un pas.
Et c’est Awa qui bouge la première et va vers l’animal. A tout petits pas, pour ne pas le perturber. Elle module un son de gorge doux et chantant pour le mettre en confiance et il semble l’écouter, la comprendre, l’accepter même. Elle est près de lui maintenant, et Arth se retient de lui crier d’être prudente et de reculer. Mais elle s’agenouille comme pour saluer l’animal dont les oreilles et la queue bougent imperceptiblement. Il émet un son à son tour, qu’Arth est incapable de traduire, puis enfin tourne le dos sans hâte et s’efface sous les arbres et dans les buissons, si bien qu’il croit avoir tout imaginé.
Awa est toujours immobile, genou en terre, et il trépigne d’impatience et presque de colère. Que fait-elle donc avec cet animal ? Ne sait-elle pas que c’est un prédateur dangereux que l’on chasse et dont on porte la peau ? Mais bien sûr qu’elle le sait ! Lorsqu’elle revient vers lui et le découvre, elle esquisse une grimace mi-satisfaite, mi-repentante devant son air sévère, et lui sourit.
— Awa ne doit pas faire ça, dit-il en la tirant par le bras plus brusquement qu’il ne l’aurait voulu.
— Mais Awa connaît le vieux loup, proteste-t-elle. Il ne lui fera pas de mal. Loup n’attaque pas les humains.
Arth renifle en s’apercevant de son inquiétude, alors qu’il aurait dû se désintéresser du sort de cette femelle qui vient encombrer sa vie, et qu’il abrite maintenant sous son toit en dépit de toute prudence.
— Arth est fâché ? demande-t-elle en le suivant.
Il ne sait que répondre et s’éloigne à grands pas vers la grève pour essayer de trouver à manger pour le soir. Awa sait qu’il ira ensuite se tremper dans les vagues et nager. Il sait faire cela très bien, elle l’épie souvent et admire son corps puissant et balafré de nombreuses cicatrices franchir habilement les rouleaux d’écume. Elle prend peur parfois lorsqu’il passe sous les vagues et disparaît. L’eau est si froide qu’il en ressort la peau bleuie en s’ébrouant et en tapant ses flancs pour se réchauffer. Il remonte alors en courant sur le sable, vers sa hutte et le feu qu’elle a entretenu, et elle fait mine de n’avoir rien vu de sa baignade pour ne pas pénétrer son espace privé.
Il dépose le panier de feuillage rempli d’arapèdes à ses pieds en guise de paix, et elle lui sourit calmement.
— Awa peut marcher maintenant et pêcher.
— Awa peut venir dans l’eau avec Arth, dit-il avec un sourire en coin. Il sait donc qu’elle le regarde et elle baisse la tête, empourprée tout à coup de confusion.
Il l’invite à venir avec lui et elle ouvre des yeux effarés. Aucun mâle ne fait cela. D’ailleurs, aucun homme ne lui a porté autant d’attention. Arth décide et ordonne, bien sûr, mais elle sait qu’il écoute aussi ce qu’elle dit, et prend en compte sa façon d’être et de faire, et ce qu’elle souhaite.
Il n’a pas cherché à la forcer, ne l’a pas non plus violentée, alors pourtant qu’elle dort près de lui depuis bien des jours, et qu’il lui serait facile de la prendre à son gré. On dirait qu’il attend quelque chose, mais Awa peine à comprendre cet homme étrange.
Tout à l’heure elle a cru qu’il avait eu peur pour elle, avec le loup si proche, mais ce n’était peut-être que de la colère de la voir agir ainsi sans discernement en se mettant en danger, et lui avec !
Ils mangent en silence dans la paix du soir. L’horizon est devenu jaune avec de grandes traînées violettes et grises, la nuit va bientôt envahir le paysage et la mer disparaître pour ne devenir qu’un immense trou noir et clapotant. Le bruit habituel du ressac va rythmer leur nuit et leurs rêves.
Arth s’attarde près du feu rougeoyant et Awa va se soulager une dernière fois derrière le buisson avant d’aller se coucher.
Lorsqu’elle revient et passe auprès du foyer devant lequel Arth est toujours assis, il tend soudain la main pour toucher sa jambe.
— Le mal est parti ? demande t-il.
Elle ne s’écarte pas et laisse les doigts de l’homme sur sa peau. Étrangement, son toucher éveille en elle une sensation inconnue. Pas de danger, pas de crainte non plus. C’est presque une caresse qui va et vient sur sa cuisse comme une invite, et il lève enfin les yeux vers elle qui se penche un peu. Ils se voient à peine dans la lueur du feu.
— Arth sait bien soigner. La jambe d’Awa est guérie. Arth veut-il que la femme s’en aille ? murmure-t-elle d’une voix sourde où perce un soupçon d’angoisse.
La main s’est crispée soudain et Arth tressaille. Il ne lui est pas venu à l’idée qu’elle désire partir. Pour aller où ? Il sait bien que ce serait mieux, mais cela lui semble soudain difficile de la laisser quitter sa vie.
— Non, dit-il fermement. Arth ne veut pas. Il veut qu’elle reste avec lui.
Il la tire alors un peu vers lui jusqu’à ce que son visage soit à la hauteur du sien, car il n’a pas bougé de sa position assise pour ne pas lui faire peur, et elle se laisse docilement tomber près de lui. Il glisse alors sa main sous sa tunique et prend l’un de ses seins qu’il enferme dans sa paume avec un soupir rauque qui montre son agitation intérieure.
Awa se sent remuée jusqu’aux tréfonds de son corps. Jamais encore elle n’a couché avec un homme de son plein gré. Jamais elle n’en a désiré un ardemment, charnellement. Toujours elle a été prise, forcée, humiliée, brutalisée, même par son premier compagnon qui pourtant tenait à elle. C’est l’habitude des hommes d’être brutaux, pressés, exigeants, et de considérer les femmes comme une chose qui doit obéir à leur désir.
Celui-là, Arth, paraît si différent. Peut-être est-ce dû à l’âge et à sa solitude. Taciturne, peu bavard, il n’est jamais violent avec elle et semble plutôt chercher quelque chose que peut-être il ne comprend pas encore bien lui-même et qu’elle peine elle aussi à déchiffrer.
— Awa veut-elle de Arth ?
Awa arrondit les yeux d’incrédulité. Voilà qu’il lui demande son avis pour se jeter sur elle ! Elle ressent alors une douce chaleur au creux de l’aine, un frémissement dans le corps et l’attente de quelque chose de nouveau tout à coup. Un vague sentiment qu’elle ne connaît pas et ne peut pas nommer. Gratitude, douceur, tendresse ? Oui, elle veut bien de l’homme. Elle s’aperçoit en effet qu’elle veut qu’Arth couche son corps sur le sien, et la pénètre comme il le fait maintenant, doucement, lentement, en la regardant dans la pénombre, et en enserrant sa tête entre ses grandes mains brunies par le soleil.
Cet homme-là n’est pas ordinaire, et elle ressent pourtant cette grande faim qui l’habite. Son sexe est dressé et inlassable, et elle le laisse faire sans se défendre, tandis que peu à peu monte de son ventre une faim semblable à la sienne, un plaisir inattendu qui la fait frissonner et s’agripper à lui pour lui mordre l’épaule à l’instant où elle s’abandonne à son rythme et cesse d’avoir peur.
Elle se love alors contre lui pour traverser la nuit, et dormir enfin en paix et en sécurité dans les bras qu’Arth a refermés sur elle.
Extrait "Les larmes du magicien"

"J’ai trop mangé de cawl ce soir", songea Athaëlle dans un demi-sommeil, en se retournant pesamment dans le lit. Elle aimait ce ragoût gallois à base d’agneau et de légumes, poireaux, carottes, oignon et chou, parsemé de thym et de romarin. Le cuisinier du castel ajoutait des boulettes faites de farine et de beurre malaxé avec du romarin et de la levure, et c’était aussi le plat préféré de Tadeuz qu’il lui avait fait découvrir en l’initiant à la vie galloise.
Elle se rendormit un instant, puis l’impression étrange de flotter sur l’eau qui clapotait la réveilla à nouveau.
« Le bateau va couler » pensa-t-elle absurdement dans son rêve. Elle tâtonna machinalement les draps, les découvrit humides, et le bas de sa chinse de nuit trempé. Elle toucha son ventre, où l’enfant qu’elle attendait n’allait plus tarder à se préparer à sortir, puis comprit d’un seul coup qu’elle venait de perdre les eaux. « Ce n’est pas encore le moment » dit-elle tout haut.
En dépit des coutumes, ce qui étonnait chacun dans le village et au castel, elle n’était pas entrée en confinement comme le faisaient les femmes nobles qui se retiraient quelques semaines, seules, avant la naissance de leur bébé. Et Tadeuz, également contre l’usage qui voulait que les époux se séparent la nuit de leur femme enceinte, continuait à dormir avec elle.
Tous les deux, ils avaient traversé des épreuves peu communes. Tous les deux avaient souffert, lui en perdant sa première épouse enceinte, assassinée par son frère aîné, elle en abandonnant son premier bébé à sa sœur, et en tentant de se noyer pour échapper à la honte de sa famille. C’est ainsi qu’ils avaient été amenés à vivre sous une autre identité en Bretagne, endossé des rôles différents de leurs origines, lui, comme palefrenier alors qu’il était le puiné du seigneur de Karreg-an-tan, elle, comme guérisseuse, alors qu’elle était une fille du comte de Bazvalan et qu’on la croyait noyée ! Leurs vies s’étaient soudées étroitement, avant même qu’ils ne s’épousent. Et leur union, après toutes ces années passées loin des leurs, avait été le prolongement évident de ce qui les liait.
Athaëlle essaya de se lever sans réveiller Tadeuz, et elle eut l’impression de distinguer une silhouette imprécise et éthérée se découper devant le fenestron illuminé par la lune. L’instant d’après il n’y avait plus rien, et elle secoua la tête impatiemment pour se réveiller. Les contractures commencèrent alors, brutalement, et elle ne put s’empêcher de gémir en se tenant le ventre, ce qui réveilla Tadeuz, tout de suite en alerte. Il alluma une chandelle placée sur le coffre de son côté du lit, et comprit sans peine ce qui arrivait en voyage son visage crispé.
Il sauta à bas du lit, le contourna, et vint l’aider à se redresser sur les oreillers qu’il entassa sous sa tête.
–Le bébé arrive en avance ?
Athaëlle fit un signe de tête, respira plus vite, puis souffla bruyamment.
–Je vais faire chercher la sage-femme au village…
–Pas…le temps ! articula-t-elle en se concentrant sur une nouvelle douleur qui la ploya en deux.
–Alors je vais réveiller les servantes et t’aider moi-même ! décida-t-il sans hésiter. Ce ne sera pas la première fois, rit-il sourdement
Athaëlle eut un sourire crispé tandis qu’il sortait de la chambre pour alerter Bryne et donner l’ordre de réveiller un cavalier pour aller chercher la sage-femme et prévenir Pryderi.
Elle savait qu’il était tout à fait capable de l’assister aussi bien qu’une ventrière, car ils avaient ensemble mis au monde bien des bébés lorsqu’elle était guérisseuse. Cette fois c’était le leur qui allait naître, et il n’aurait jamais voulu être éloigné d’elle à cet instant-là, quelles que soient les coutumes. Lorsqu’il revint, il vit que le travail d’enfantement s’accélérait plus vite que prévu, et il se prépara à l’accoucher lui-même.
Il attrapa le drap qu’elle avait préparé sur un coffre depuis quelques jours déjà, l’étendit sous elle, puis il se lava les mains dans la cuvette d’eau froide posée sur une petite table dans le fond de la pièce, coupa ses ongles bien ras comme elle le lui avait appris, et revint dégager les draps et la courtepointe sous les jambes d’Athaëlle. Il avait déjà mis des enfants au monde avec Athaëlle en Bretagne, et savait précisément ce qu’il fallait faire mais la jeune servante qui entra, en bonnet de nuit et habillée en hâte, le regarda, effarée, car elle n’avait jamais vu un homme s’occuper ainsi de son épouse en gésine.
–Entretiens le feu, ordonna-t-il brièvement. Ta maîtresse ne doit pas prendre froid. Puis tu iras chercher des seaux d’eau chaude dans les cuisines.
Personne ne discutait jamais un ordre du magicien, bien qu’il ne soit pas difficile à satisfaire, mais sa réputation effrayait les gens prompts à craindre des pouvoirs qu’ils ne comprenaient pas.
La jeune fille était heureusement débrouillarde, c’est pour cela qu’il l’avait choisie pour servir Athaëlle qui l’avait peu à peu formée à ses pratiques, et elle s’activa en silence, tandis que Tadeuz lançait mentalement un appel à Pryderi et à Lug.
Ils étaient seuls tous les deux dans la chambre, Bryne sortie en hâte pour descendre jusqu’aux cuisines, quand Tadeuz, avec cette prescience qui le caractérisait, perçut une présence inhabituelle et devina très vite la menace qu’elle représentait.
La voix de l’être de brouillard qui venait de se matérialiser dans la pièce retentit sourdement dans sa tête. J’ai besoin de cet enfant, magicien. Donne le moi, ou je prendrai ta vie »
Tadeuz fit rapidement le signe magique pour repousser la forme qu’il devinait derrière lui, et elle trembla et se déplaça pour éviter d’être pulvérisée par son pouvoir. Il ne pouvait pas lui consacrer toute son attention, toute sa force, s’il voulait aider Athaëlle à mettre leur enfant au monde. Il fit alors barrage entre son épouse sans défense et la colonne menaçante qui de temps à autre prenait forme puis s’évaporait. Il comprit que l’être, vampire ou succube, avait choisi ce moment pour essayer de s’emparer du corps du bébé afin d’héberger cette puissance erratique qu’il voulait fixer dans une forme visible et humaine, et il projeta tout son pouvoir pour la neutraliser. Il perçut un râle de souffrance, un souffle rauque et invisible qui figea sur place la jeune servante lorsqu’elle revint dans la pièce avec un seau d’eau chaude qu’elle posa à terre.
Athaëlle cria sourdement en haletant de plus en plus vite, le visage déformé par l’intensité de l’effort qu’elle fournissait pour pousser l’enfant hors de son ventre. Un petit crâne trempé d’humeurs apparut alors que Tadeuz tira doucement vers lui, et il sentit alors une morsure brutale sur son épaule, comme si on tentait de le dévorer. Les deux mains en coupe pour recevoir le bébé, il hurla à son tour sous la douleur qui irradiait sa chair comme un fer brûlant. Des dents acérées s’étaient enfoncées dans son épaule et son cou, puis une bouche invisible commença à aspirer le sang à son cou .Une larme jaillit de ses yeux en feu et tomba sur la main potelée de son fils qui se recroquevilla, bien serrée, comme l’y enfermer et la retenir.
Il banda alors ses forces pour prononcer les mots du Don. « Je te donne le Pouvoir », murmura-t-il en luttant désespérément contre l’être qui cherchait à l’envahir. Puis, comme en un rêve, il entendit la porte se rouvrir et les voix de Pryderi et de Lug qui rugissaient pour le libérer, avec toute leur puissance conjuguée de magiciens.
Sur le seuil, figés devant le spectacle qu’ils étaient seuls à pouvoir visionner, Pryderi et Lug virent Tadeuz impuissant à se défendre tandis qu’il tirait le bébé du ventre d’Athaëlle. Il était enveloppé d’un halo de brouillard humide dans lequel ils devinaient une forme vague qui oscillait au gré des efforts qu’elle faisait pour émerger de ce cocon éthéré. Une amorce de tête était déjà apparue, plutôt une mâchoire acérée qui mordait férocement l’épaule et le cou du magicien pour s’irriguer de sa vie et de son sang, tel un succube échappé d’outre-tombe. Le cri du magicien les pétrifia mais, dans l’instant, ils réagirent en lançant leurs pouvoirs contre l’horrible vision qui ressemblait plus ou moins à une chauve-souris, vampire suceur de sang.
Lug se précipita pour s’interposer entre la forme floue et Tadeuz, levant en même temps sa main où brillait un diamant qui coupa aussitôt le contact que l’être maléfique essayait d’imposer. L’effrayante créature ainsi attaquée oscilla, trembla, et leur jeta un regard de pure haine dont ils se débarrassèrent avec une incantation silencieuse vers ses yeux de cadavre qu’ils crevèrent. Elle lâcha enfin prise et commença à disparaître lentement, consumée de l’intérieur, pour s’effondrer peu à peu en un tas de fine poussière argentée, une suie impalpable que Lug s’empressa de ramasser avec la balayette du foyer dans lequel il la jeta. Le feu crépita avec un craquement sinistre et un hurlement démoniaque, sous les yeux ébahis de la jeune servante qui n’avait rien vu d’autre que leur irruption tempétueuse et incongrue à l’instant de l’accouchement de sa maîtresse.
–Bien, mon fils, murmura Pryderi. Tu as fait de grands progrès…
Tadeuz restait prostré à terre, tandis que Pryderi se hâtait vers Athaëlle dont les contractions avait repris, ce qui indiquait la naissance d’un second enfant. Lug écarta le maître magicien dans un coin reculé de la chambre et le recouvrit chaudement d’une couverture du lit.
Pryderi déposa enfin près d’Athaëlle le petit corps jumeau qui criait maintenant qu’on l’avait sorti du ventre de sa mère, et il jeta un regard vers Lug qui maintenait Tadeuz contre lui. Son fils lui fit une grimace désolée en montrant la plaie sanguinolente qu’il essayait d’éponger.
Pryderi écarta alors la jeune servante pour lui cacher son maître, en lui donnant l’ordre de redescendre chercher de l’eau chaude, des draps propres et de quoi vêtir les bébés, et il soupira de soulagement en voyant enfin entrer la sage-femme.
–Je vous les confie, fit-il en désignant les petits corps nus qui s’agitaient, pleins d’humeurs et de sang. Ce sont des jumeaux, un garçon et une fille. Occupez-vous de dame Athaëlle, j’ai coupé le cordon, expliqua-t-il d’une voix brève. Et faites laver et couvrir les enfants…
La sage-femme qui connaissait le magicien, hocha seulement la tête, et Pryderi, rassuré, alla se pencher sur Tadeuz toujours inerte au sol.
–Comment va-t-il ?
–Il est vilainement blessé et son bras ne répond plus, expliqua Lug qui avait tâté son corps avec précaution.
Pryderi sortit alors son coutelas pour découper le vêtement de nuit que portait encore Tadeuz, déchiqueté à l’épaule, et grommela en constatant l’étendue de la plaie. La chair avait été labourée comme avec les griffes d’une bête monstrueuse qui avait commencé à le dévorer, on voyait presque l’os, et il comprit que les pouvoirs du maître magicien allaient être en partie neutralisés à cause de cette profonde blessure par laquelle le succube avait essayé de pénétrer son esprit.
–Va-t-il perdre son bras et sa main ? demanda Lug en grimaçant sous l’horreur de la plaie.
Pryderi se mordit les lèvres et soupira, désarmé.
–Son inconscience ne me dit rien qui vaille. L’être, quel qu’il soit, a bel et bien cherché à le tuer…
–Ou bien à ravager son esprit pour le contrôler ensuite, émit Lug pensif.
–Oui, c’est possible, admit Pryderi préoccupé, en se demandant si le défunt sorcier qui habitait le corps de Keith dans sa geôle sous le castel, avait réuni assez de forces pour oser s’attaquer à Tadeuz et s’emparer de ses pouvoirs.
–On va le transporter dans la chambre à côté pour l’examiner et le soigner. Ne disons rien pour l’instant à Athaëlle. Plus tard, lorsqu’elle sera remise de l’accouchement, elle sera peut-être capable de le sortir de là…
–Mais comment allons-nous lui expliquer ce qui s’est passé ? Elle n’est pas magicienne ! marmonna Lug. ?
–Je sais. Mais elle vit depuis assez longtemps avec Tadeuz pour comprendre ce qui ferait peur à la plupart des gens !…
Elle se rendormit un instant, puis l’impression étrange de flotter sur l’eau qui clapotait la réveilla à nouveau.
« Le bateau va couler » pensa-t-elle absurdement dans son rêve. Elle tâtonna machinalement les draps, les découvrit humides, et le bas de sa chinse de nuit trempé. Elle toucha son ventre, où l’enfant qu’elle attendait n’allait plus tarder à se préparer à sortir, puis comprit d’un seul coup qu’elle venait de perdre les eaux. « Ce n’est pas encore le moment » dit-elle tout haut.
En dépit des coutumes, ce qui étonnait chacun dans le village et au castel, elle n’était pas entrée en confinement comme le faisaient les femmes nobles qui se retiraient quelques semaines, seules, avant la naissance de leur bébé. Et Tadeuz, également contre l’usage qui voulait que les époux se séparent la nuit de leur femme enceinte, continuait à dormir avec elle.
Tous les deux, ils avaient traversé des épreuves peu communes. Tous les deux avaient souffert, lui en perdant sa première épouse enceinte, assassinée par son frère aîné, elle en abandonnant son premier bébé à sa sœur, et en tentant de se noyer pour échapper à la honte de sa famille. C’est ainsi qu’ils avaient été amenés à vivre sous une autre identité en Bretagne, endossé des rôles différents de leurs origines, lui, comme palefrenier alors qu’il était le puiné du seigneur de Karreg-an-tan, elle, comme guérisseuse, alors qu’elle était une fille du comte de Bazvalan et qu’on la croyait noyée ! Leurs vies s’étaient soudées étroitement, avant même qu’ils ne s’épousent. Et leur union, après toutes ces années passées loin des leurs, avait été le prolongement évident de ce qui les liait.
Athaëlle essaya de se lever sans réveiller Tadeuz, et elle eut l’impression de distinguer une silhouette imprécise et éthérée se découper devant le fenestron illuminé par la lune. L’instant d’après il n’y avait plus rien, et elle secoua la tête impatiemment pour se réveiller. Les contractures commencèrent alors, brutalement, et elle ne put s’empêcher de gémir en se tenant le ventre, ce qui réveilla Tadeuz, tout de suite en alerte. Il alluma une chandelle placée sur le coffre de son côté du lit, et comprit sans peine ce qui arrivait en voyage son visage crispé.
Il sauta à bas du lit, le contourna, et vint l’aider à se redresser sur les oreillers qu’il entassa sous sa tête.
–Le bébé arrive en avance ?
Athaëlle fit un signe de tête, respira plus vite, puis souffla bruyamment.
–Je vais faire chercher la sage-femme au village…
–Pas…le temps ! articula-t-elle en se concentrant sur une nouvelle douleur qui la ploya en deux.
–Alors je vais réveiller les servantes et t’aider moi-même ! décida-t-il sans hésiter. Ce ne sera pas la première fois, rit-il sourdement
Athaëlle eut un sourire crispé tandis qu’il sortait de la chambre pour alerter Bryne et donner l’ordre de réveiller un cavalier pour aller chercher la sage-femme et prévenir Pryderi.
Elle savait qu’il était tout à fait capable de l’assister aussi bien qu’une ventrière, car ils avaient ensemble mis au monde bien des bébés lorsqu’elle était guérisseuse. Cette fois c’était le leur qui allait naître, et il n’aurait jamais voulu être éloigné d’elle à cet instant-là, quelles que soient les coutumes. Lorsqu’il revint, il vit que le travail d’enfantement s’accélérait plus vite que prévu, et il se prépara à l’accoucher lui-même.
Il attrapa le drap qu’elle avait préparé sur un coffre depuis quelques jours déjà, l’étendit sous elle, puis il se lava les mains dans la cuvette d’eau froide posée sur une petite table dans le fond de la pièce, coupa ses ongles bien ras comme elle le lui avait appris, et revint dégager les draps et la courtepointe sous les jambes d’Athaëlle. Il avait déjà mis des enfants au monde avec Athaëlle en Bretagne, et savait précisément ce qu’il fallait faire mais la jeune servante qui entra, en bonnet de nuit et habillée en hâte, le regarda, effarée, car elle n’avait jamais vu un homme s’occuper ainsi de son épouse en gésine.
–Entretiens le feu, ordonna-t-il brièvement. Ta maîtresse ne doit pas prendre froid. Puis tu iras chercher des seaux d’eau chaude dans les cuisines.
Personne ne discutait jamais un ordre du magicien, bien qu’il ne soit pas difficile à satisfaire, mais sa réputation effrayait les gens prompts à craindre des pouvoirs qu’ils ne comprenaient pas.
La jeune fille était heureusement débrouillarde, c’est pour cela qu’il l’avait choisie pour servir Athaëlle qui l’avait peu à peu formée à ses pratiques, et elle s’activa en silence, tandis que Tadeuz lançait mentalement un appel à Pryderi et à Lug.
Ils étaient seuls tous les deux dans la chambre, Bryne sortie en hâte pour descendre jusqu’aux cuisines, quand Tadeuz, avec cette prescience qui le caractérisait, perçut une présence inhabituelle et devina très vite la menace qu’elle représentait.
La voix de l’être de brouillard qui venait de se matérialiser dans la pièce retentit sourdement dans sa tête. J’ai besoin de cet enfant, magicien. Donne le moi, ou je prendrai ta vie »
Tadeuz fit rapidement le signe magique pour repousser la forme qu’il devinait derrière lui, et elle trembla et se déplaça pour éviter d’être pulvérisée par son pouvoir. Il ne pouvait pas lui consacrer toute son attention, toute sa force, s’il voulait aider Athaëlle à mettre leur enfant au monde. Il fit alors barrage entre son épouse sans défense et la colonne menaçante qui de temps à autre prenait forme puis s’évaporait. Il comprit que l’être, vampire ou succube, avait choisi ce moment pour essayer de s’emparer du corps du bébé afin d’héberger cette puissance erratique qu’il voulait fixer dans une forme visible et humaine, et il projeta tout son pouvoir pour la neutraliser. Il perçut un râle de souffrance, un souffle rauque et invisible qui figea sur place la jeune servante lorsqu’elle revint dans la pièce avec un seau d’eau chaude qu’elle posa à terre.
Athaëlle cria sourdement en haletant de plus en plus vite, le visage déformé par l’intensité de l’effort qu’elle fournissait pour pousser l’enfant hors de son ventre. Un petit crâne trempé d’humeurs apparut alors que Tadeuz tira doucement vers lui, et il sentit alors une morsure brutale sur son épaule, comme si on tentait de le dévorer. Les deux mains en coupe pour recevoir le bébé, il hurla à son tour sous la douleur qui irradiait sa chair comme un fer brûlant. Des dents acérées s’étaient enfoncées dans son épaule et son cou, puis une bouche invisible commença à aspirer le sang à son cou .Une larme jaillit de ses yeux en feu et tomba sur la main potelée de son fils qui se recroquevilla, bien serrée, comme l’y enfermer et la retenir.
Il banda alors ses forces pour prononcer les mots du Don. « Je te donne le Pouvoir », murmura-t-il en luttant désespérément contre l’être qui cherchait à l’envahir. Puis, comme en un rêve, il entendit la porte se rouvrir et les voix de Pryderi et de Lug qui rugissaient pour le libérer, avec toute leur puissance conjuguée de magiciens.
Sur le seuil, figés devant le spectacle qu’ils étaient seuls à pouvoir visionner, Pryderi et Lug virent Tadeuz impuissant à se défendre tandis qu’il tirait le bébé du ventre d’Athaëlle. Il était enveloppé d’un halo de brouillard humide dans lequel ils devinaient une forme vague qui oscillait au gré des efforts qu’elle faisait pour émerger de ce cocon éthéré. Une amorce de tête était déjà apparue, plutôt une mâchoire acérée qui mordait férocement l’épaule et le cou du magicien pour s’irriguer de sa vie et de son sang, tel un succube échappé d’outre-tombe. Le cri du magicien les pétrifia mais, dans l’instant, ils réagirent en lançant leurs pouvoirs contre l’horrible vision qui ressemblait plus ou moins à une chauve-souris, vampire suceur de sang.
Lug se précipita pour s’interposer entre la forme floue et Tadeuz, levant en même temps sa main où brillait un diamant qui coupa aussitôt le contact que l’être maléfique essayait d’imposer. L’effrayante créature ainsi attaquée oscilla, trembla, et leur jeta un regard de pure haine dont ils se débarrassèrent avec une incantation silencieuse vers ses yeux de cadavre qu’ils crevèrent. Elle lâcha enfin prise et commença à disparaître lentement, consumée de l’intérieur, pour s’effondrer peu à peu en un tas de fine poussière argentée, une suie impalpable que Lug s’empressa de ramasser avec la balayette du foyer dans lequel il la jeta. Le feu crépita avec un craquement sinistre et un hurlement démoniaque, sous les yeux ébahis de la jeune servante qui n’avait rien vu d’autre que leur irruption tempétueuse et incongrue à l’instant de l’accouchement de sa maîtresse.
–Bien, mon fils, murmura Pryderi. Tu as fait de grands progrès…
Tadeuz restait prostré à terre, tandis que Pryderi se hâtait vers Athaëlle dont les contractions avait repris, ce qui indiquait la naissance d’un second enfant. Lug écarta le maître magicien dans un coin reculé de la chambre et le recouvrit chaudement d’une couverture du lit.
Pryderi déposa enfin près d’Athaëlle le petit corps jumeau qui criait maintenant qu’on l’avait sorti du ventre de sa mère, et il jeta un regard vers Lug qui maintenait Tadeuz contre lui. Son fils lui fit une grimace désolée en montrant la plaie sanguinolente qu’il essayait d’éponger.
Pryderi écarta alors la jeune servante pour lui cacher son maître, en lui donnant l’ordre de redescendre chercher de l’eau chaude, des draps propres et de quoi vêtir les bébés, et il soupira de soulagement en voyant enfin entrer la sage-femme.
–Je vous les confie, fit-il en désignant les petits corps nus qui s’agitaient, pleins d’humeurs et de sang. Ce sont des jumeaux, un garçon et une fille. Occupez-vous de dame Athaëlle, j’ai coupé le cordon, expliqua-t-il d’une voix brève. Et faites laver et couvrir les enfants…
La sage-femme qui connaissait le magicien, hocha seulement la tête, et Pryderi, rassuré, alla se pencher sur Tadeuz toujours inerte au sol.
–Comment va-t-il ?
–Il est vilainement blessé et son bras ne répond plus, expliqua Lug qui avait tâté son corps avec précaution.
Pryderi sortit alors son coutelas pour découper le vêtement de nuit que portait encore Tadeuz, déchiqueté à l’épaule, et grommela en constatant l’étendue de la plaie. La chair avait été labourée comme avec les griffes d’une bête monstrueuse qui avait commencé à le dévorer, on voyait presque l’os, et il comprit que les pouvoirs du maître magicien allaient être en partie neutralisés à cause de cette profonde blessure par laquelle le succube avait essayé de pénétrer son esprit.
–Va-t-il perdre son bras et sa main ? demanda Lug en grimaçant sous l’horreur de la plaie.
Pryderi se mordit les lèvres et soupira, désarmé.
–Son inconscience ne me dit rien qui vaille. L’être, quel qu’il soit, a bel et bien cherché à le tuer…
–Ou bien à ravager son esprit pour le contrôler ensuite, émit Lug pensif.
–Oui, c’est possible, admit Pryderi préoccupé, en se demandant si le défunt sorcier qui habitait le corps de Keith dans sa geôle sous le castel, avait réuni assez de forces pour oser s’attaquer à Tadeuz et s’emparer de ses pouvoirs.
–On va le transporter dans la chambre à côté pour l’examiner et le soigner. Ne disons rien pour l’instant à Athaëlle. Plus tard, lorsqu’elle sera remise de l’accouchement, elle sera peut-être capable de le sortir de là…
–Mais comment allons-nous lui expliquer ce qui s’est passé ? Elle n’est pas magicienne ! marmonna Lug. ?
–Je sais. Mais elle vit depuis assez longtemps avec Tadeuz pour comprendre ce qui ferait peur à la plupart des gens !…
Extrait : "La coupe des Sortilèges", 2014
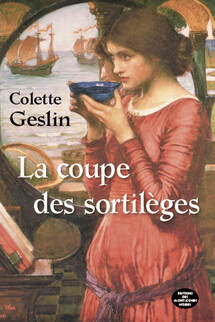
Ce jour funeste de la chasse, Athaëlle venait d’arriver à la forteresse avec Pryderi, lorsque Tadeuz et Clyde avaient déboulé dans la cour, l’un poursuivant l’autre, l’un attaquant l’autre, la fureur meurtrière exsudant de tout leur corps, leurs visages déformés par une colère gigantesque qui les rendaient soudain monstrueux.
Pryderi l’avait poussée derrière lui pour la protéger, et Athaëlle avait alors remarqué les habitants du lieu massés le long des murs et des écuries, hors de portée des deux hommes déchaînés.
–Reste là, avait-il ordonné, en se rapprochant lui-même pour rejoindre Cormac, le père des deux hommes.
Tadeuz avait délaissé son épée, et il affrontait Clyde avec une arme invisible qui semblait terroriser les gens, témoins d’un combat qu’ils n’auraient jamais dû voir. Combat d’un magicien déchaîné contre un grand guerrier en fureur, dépoitraillé et les vêtements déchirés. Clyde défendait âprement sa vie. Tadeuz l’attaquait sans relâche et lui portait des coups monstrueux que personne ne voyait venir, et qui auraient déjà tué des hommes moins forts que lui.
–Avec quoi se bat-il ? Pourquoi n’a-t-il pas d’épée ? demandait-on.
Les murmures couraient devant l’étrange comportement de Tadeuz, et chacun sursautait, apeuré, lorsque claquait le bruit, d’autant plus terrifiant qu’on ne savait pas ce qui le provoquait.
Près d’Athaëlle, une servante effrayée lui apprit la mort d’Énira, violée et étranglée par son beau-frère !
A quelques pas d’elles, qui se reculaient chaque fois que la danse mortelle des deux frères se rapprochait, Tadeuz paraissait grandir d’instant en instant, il s’envolait dans les airs comme un oiseau de proie, sautait par-dessus l’épée de Clyde qui ne l’atteignait jamais. Il ne disait rien, ne criait pas, on ne l’entendait même pas respirer. Dieu-guerrier des Tuatha dé Dânann[1], échappé du monde souterrain pour venir se venger, il épouvantait tout le monde. Sa longue chevelure brune tourbillonnait autour de sa tête comme des ailes, son vêtement s’enroulait le long de son corps en volutes gracieuses et décomposées. Il encerclait peu à peu son frère d’un arsenal de gestes étranges, si compliqués dans leur enchaînement que c’en était fascinant, malgré le relent de mort qui planait autour d’eux, enfermés dans une aura sombre. Clyde s’épuisait dans cette toile d’araignée, il se battait en grognant comme un ours, mais Tadeuz continuait à l’affronter impitoyablement, tel le dieu Ogme, maître de la guerre.
Cormac, le seigneur de Camarthen, effondré, savait que le combat de ses deux aînés ne pouvait avoir qu’une issue mortelle, et que Tadeuz ne ferait pas grâce.
Là-haut, les plus vieilles femmes préparaient Énira, on entendait leur chant funèbre et désespéré, et le cœur de Tadeuz saignait.
Tout en plaignant l’homme qui venait de perdre l’amour de sa vie, Athaëlle le fixait, fascinée, et succombait à l’attraction du magicien. Tadeuz, qui jusque-là s’était exercé en secret, démontrait cette fois au grand jour ses capacités immenses et la puissance qu’il avait développée au cours de son entraînement avec Pryderi. Clyde, lui, avait négligé par paresse et désintérêt cet enseignement de la magie, pour se consacrer seulement à l’épée, arme de guerrier, plus à sa portée.
–Pryderi, arrête-le, je t’en prie, pria le vieux Cormac décomposé.
Athaëlle entendit alors la réponse désolée de son maître.
–Je ne peux pas, mon frère. Ma puissance n’est plus assez forte contre la sienne. Il me pulvériserait. La sanction est méritée, Clyde doit payer pour son forfait, lui dit Pryderi, l’œil rivé sur le combat des deux frères.
–Mais Tadeuz se sert de ses pouvoirs de magicien ! Sa punition sera terrible pour cela, se lamenta Cormac. Je ne veux pas perdre mes deux fils !
–Tadeuz sait qu’il sera puni, soupira Pryderi. Mais je ne puis rien pour l’arrêter maintenant. Il est ailleurs…
Les coups de Tadeuz s’accéléraient, il levait seulement les mains, paumes en avant, regardait Clyde tressauter, empalé par un arc lumineux, ployé sous le châtiment invisible qui s’abattait et laminait inexorablement ses forces. Les yeux du magicien flamboyaient. Puis il commença à changer sous le regard stupéfait de l’assistance qui crut voir de grandes ailes noires, un bec acéré, des serres crochues, un corps de dragon, une crête écarlate, un leurre animal qui grandissait, enflait, et, dans un cri perçant qui vrilla les oreilles, la bête fondit sur Clyde paralysé. Le corps du guerrier, ballotté dans l’air, oscilla, trembla et tournoya, puis s’affaissa aux pieds de Tadeuz qui le regarda mourir.
Alors le jeune homme se détourna, fendit la foule qui s’écarta, tant il crépitait comme un orage, et il s’enfonça dans les bois où il disparut.
Athaëlle se mit à courir derrière lui, et le retrouva dans la rivière où il avait plongé pour se débarrasser de la magie qui l’avait submergé. Il nageait furieusement. Ou plutôt il se battait dans l’eau contre lui-même, et de profonds remous accompagnaient son parcours tumultueux. Lorsqu’il aperçut Athaëlle sur la berge, il s’arrêta, se forçant à respirer plus calmement, puis remonta, ruisselant, pour s’asseoir sur l’herbe.
–J’ai réellement tué mon frère ? demanda-t-il enfin après un long silence.
Elle inclina la tête, sans oser répondre.
–Alors, fit-il d’une voix sourde, si les dieux l’ont permis, il méritait ce châtiment. Il a pris mon épouse. J’ai pris sa vie. Je sais que je vais être banni, ajouta-t-il avec un regard lointain.
–Banni ? fit-elle sans comprendre ce qu’il voulait dire.
–J’ai utilisé la magie pour le détruire. Cela est interdit, expliqua-t-il d’une voix atone. Le Conseil des Anciens va devoir rendre sa sentence…et me chasser du clan !
–Tadeuz, s’écria Athaëlle catastrophée. Ils ne peuvent pas faire ça. Tu es le seul capable de remplacer ton père.
–Il y a Keith, mon jeune frère.
–Mais Keith est bien trop jeune, rétorqua Athaëlle. Et il est trop fragile.
–Mon père n’est pas encore mort…
–Certes. Mais Pryderi dit que sa fin est proche. Il ne vivra plus longtemps après votre combat. Où irais-tu ? reprit-elle après un instant de silence.
Tadeuz haussa les épaules, indifférent.
–Partout. Nulle part. Ailleurs.
–Ailleurs n’est pas un endroit pour un magicien tel que toi, s’obstina-t-elle.
–Je ne veux plus me servir de la magie, comprends-tu ? cria-t-il en colère. Laisse-moi maintenant et va t-en !
Il se releva et partit à grandes enjambées vers le port.
[1] Les Tuatha dé Dânann : gens de la déesse Dana, dieux de l’Irlande. Lug, (dieu de tous les arts), Dagda, (dieu de la science et des éléments), Diancecht (dieu médecin), Ogme (maître de la guerre), Nuada au bras d’argent, Oengus, (fils de Dagda), Brigit, (fille de Dagda, déesse des poètes et des forgerons), Etain (reine d’Irlande, mère de tous les dieux).
Pryderi l’avait poussée derrière lui pour la protéger, et Athaëlle avait alors remarqué les habitants du lieu massés le long des murs et des écuries, hors de portée des deux hommes déchaînés.
–Reste là, avait-il ordonné, en se rapprochant lui-même pour rejoindre Cormac, le père des deux hommes.
Tadeuz avait délaissé son épée, et il affrontait Clyde avec une arme invisible qui semblait terroriser les gens, témoins d’un combat qu’ils n’auraient jamais dû voir. Combat d’un magicien déchaîné contre un grand guerrier en fureur, dépoitraillé et les vêtements déchirés. Clyde défendait âprement sa vie. Tadeuz l’attaquait sans relâche et lui portait des coups monstrueux que personne ne voyait venir, et qui auraient déjà tué des hommes moins forts que lui.
–Avec quoi se bat-il ? Pourquoi n’a-t-il pas d’épée ? demandait-on.
Les murmures couraient devant l’étrange comportement de Tadeuz, et chacun sursautait, apeuré, lorsque claquait le bruit, d’autant plus terrifiant qu’on ne savait pas ce qui le provoquait.
Près d’Athaëlle, une servante effrayée lui apprit la mort d’Énira, violée et étranglée par son beau-frère !
A quelques pas d’elles, qui se reculaient chaque fois que la danse mortelle des deux frères se rapprochait, Tadeuz paraissait grandir d’instant en instant, il s’envolait dans les airs comme un oiseau de proie, sautait par-dessus l’épée de Clyde qui ne l’atteignait jamais. Il ne disait rien, ne criait pas, on ne l’entendait même pas respirer. Dieu-guerrier des Tuatha dé Dânann[1], échappé du monde souterrain pour venir se venger, il épouvantait tout le monde. Sa longue chevelure brune tourbillonnait autour de sa tête comme des ailes, son vêtement s’enroulait le long de son corps en volutes gracieuses et décomposées. Il encerclait peu à peu son frère d’un arsenal de gestes étranges, si compliqués dans leur enchaînement que c’en était fascinant, malgré le relent de mort qui planait autour d’eux, enfermés dans une aura sombre. Clyde s’épuisait dans cette toile d’araignée, il se battait en grognant comme un ours, mais Tadeuz continuait à l’affronter impitoyablement, tel le dieu Ogme, maître de la guerre.
Cormac, le seigneur de Camarthen, effondré, savait que le combat de ses deux aînés ne pouvait avoir qu’une issue mortelle, et que Tadeuz ne ferait pas grâce.
Là-haut, les plus vieilles femmes préparaient Énira, on entendait leur chant funèbre et désespéré, et le cœur de Tadeuz saignait.
Tout en plaignant l’homme qui venait de perdre l’amour de sa vie, Athaëlle le fixait, fascinée, et succombait à l’attraction du magicien. Tadeuz, qui jusque-là s’était exercé en secret, démontrait cette fois au grand jour ses capacités immenses et la puissance qu’il avait développée au cours de son entraînement avec Pryderi. Clyde, lui, avait négligé par paresse et désintérêt cet enseignement de la magie, pour se consacrer seulement à l’épée, arme de guerrier, plus à sa portée.
–Pryderi, arrête-le, je t’en prie, pria le vieux Cormac décomposé.
Athaëlle entendit alors la réponse désolée de son maître.
–Je ne peux pas, mon frère. Ma puissance n’est plus assez forte contre la sienne. Il me pulvériserait. La sanction est méritée, Clyde doit payer pour son forfait, lui dit Pryderi, l’œil rivé sur le combat des deux frères.
–Mais Tadeuz se sert de ses pouvoirs de magicien ! Sa punition sera terrible pour cela, se lamenta Cormac. Je ne veux pas perdre mes deux fils !
–Tadeuz sait qu’il sera puni, soupira Pryderi. Mais je ne puis rien pour l’arrêter maintenant. Il est ailleurs…
Les coups de Tadeuz s’accéléraient, il levait seulement les mains, paumes en avant, regardait Clyde tressauter, empalé par un arc lumineux, ployé sous le châtiment invisible qui s’abattait et laminait inexorablement ses forces. Les yeux du magicien flamboyaient. Puis il commença à changer sous le regard stupéfait de l’assistance qui crut voir de grandes ailes noires, un bec acéré, des serres crochues, un corps de dragon, une crête écarlate, un leurre animal qui grandissait, enflait, et, dans un cri perçant qui vrilla les oreilles, la bête fondit sur Clyde paralysé. Le corps du guerrier, ballotté dans l’air, oscilla, trembla et tournoya, puis s’affaissa aux pieds de Tadeuz qui le regarda mourir.
Alors le jeune homme se détourna, fendit la foule qui s’écarta, tant il crépitait comme un orage, et il s’enfonça dans les bois où il disparut.
Athaëlle se mit à courir derrière lui, et le retrouva dans la rivière où il avait plongé pour se débarrasser de la magie qui l’avait submergé. Il nageait furieusement. Ou plutôt il se battait dans l’eau contre lui-même, et de profonds remous accompagnaient son parcours tumultueux. Lorsqu’il aperçut Athaëlle sur la berge, il s’arrêta, se forçant à respirer plus calmement, puis remonta, ruisselant, pour s’asseoir sur l’herbe.
–J’ai réellement tué mon frère ? demanda-t-il enfin après un long silence.
Elle inclina la tête, sans oser répondre.
–Alors, fit-il d’une voix sourde, si les dieux l’ont permis, il méritait ce châtiment. Il a pris mon épouse. J’ai pris sa vie. Je sais que je vais être banni, ajouta-t-il avec un regard lointain.
–Banni ? fit-elle sans comprendre ce qu’il voulait dire.
–J’ai utilisé la magie pour le détruire. Cela est interdit, expliqua-t-il d’une voix atone. Le Conseil des Anciens va devoir rendre sa sentence…et me chasser du clan !
–Tadeuz, s’écria Athaëlle catastrophée. Ils ne peuvent pas faire ça. Tu es le seul capable de remplacer ton père.
–Il y a Keith, mon jeune frère.
–Mais Keith est bien trop jeune, rétorqua Athaëlle. Et il est trop fragile.
–Mon père n’est pas encore mort…
–Certes. Mais Pryderi dit que sa fin est proche. Il ne vivra plus longtemps après votre combat. Où irais-tu ? reprit-elle après un instant de silence.
Tadeuz haussa les épaules, indifférent.
–Partout. Nulle part. Ailleurs.
–Ailleurs n’est pas un endroit pour un magicien tel que toi, s’obstina-t-elle.
–Je ne veux plus me servir de la magie, comprends-tu ? cria-t-il en colère. Laisse-moi maintenant et va t-en !
Il se releva et partit à grandes enjambées vers le port.
[1] Les Tuatha dé Dânann : gens de la déesse Dana, dieux de l’Irlande. Lug, (dieu de tous les arts), Dagda, (dieu de la science et des éléments), Diancecht (dieu médecin), Ogme (maître de la guerre), Nuada au bras d’argent, Oengus, (fils de Dagda), Brigit, (fille de Dagda, déesse des poètes et des forgerons), Etain (reine d’Irlande, mère de tous les dieux).
Les habitants du village, et ceux du village voisin de Wintoc, venus dire adieu au chaman assassiné, étaient repartis après la cérémonie, pressés par le froid qui s’intensifiait. Malgré cela Marz, après s’être assuré de la sécurité de Nuha et de Korzenn, qu’il confia à Dyf et à Vindo, s’attarda dans le tombeau qui abritait Leu désormais.
– Je te rejoindrai plus tard, avait-il assuré à Nuha, en lui caressant la joue. Je veux rester encore un moment avec l’esprit de mon grand-père.
L’endroit était calme, élevé sur une petite colline par les tribus qui les avaient précédés sur ces terres. Le tumulus était somptueux et impressionnant et, pour le bâtir, les ouvriers avaient utilisé des pierres énormes, assemblées avec art et grand soin. Il avait servi de sépulture à un autre chaman pour qui l’on avait décoré de gravures la plupart des pierres de granit qui formaient le long couloir menant à la petite chambre mortuaire. Les parois, le sol, et le sommet du dolmen étaient tous constitués de grandes dalles qui s’ajustaient si parfaitement qu’elles montraient le grand savoir-faire des tailleurs de pierres. Une rigole de sable calait les montants, tandis que le dallage était posé sur une grosse épaisseur de pierraille pour égaliser le niveau et stabiliser la structure. Orienté au sud-est, ce long couloir remontait légèrement vers la chambre qui donnait sur l’horizon, la mer et la plaine, à hauteur de la tête du dormeur éternel pour qu’il puisse admirer encore, dans son sommeil, l’endroit où son corps avait vécu sur la terre.
Une fois seul, Marz parcourut lentement le dolmen, passant sa main sur les pierres sculptées en se promettant d’envoyer les meilleurs graveurs pour terminer la décoration sur les parois encore lisses et brutes.
Puis il sortit dans le vent et le froid pour attendre.
Les prêtres et les chamans des autres villages, partis avec les habitants, et le lieu sacré rendu à sa solitude, tel une vigie devant la plaine, il savait que son visiteur allait venir. Il s’adossa à l’entrée du tombeau, stoïque malgré le vent et les embruns.
Il arriva enfin, porté par ses ailes immenses déployées pour jouer avec l’air.
Il était gigantesque et aussi merveilleux que la première fois où ils s’étaient rencontrés. Marz admira l’aisance avec laquelle il planait, tournait en silence dans le ciel, pour venir se poser juste devant lui, en étendant ses rémiges beiges, ourlées de noir. Sur sa tête ronde et veloutée, les dessins rappelaient les spirales gravées sur les parois du couloir. Au-dessus de son bec acéré ses yeux jaunes le fixèrent, tandis que le vent agitait doucement ses plumes. Il resta là, les pattes ancrées dans le sol, emplissant l’espace de sa puissance et de son envergure.
– Esprit de Leu, murmura Marz. Je dois maintenant me séparer de toi, et te laisser à ton silence éternel. Je dois aussi quitter ce double qui m’habite depuis que j’ai parcouru un autre monde, pour le renvoyer d’où il vient.
Le grand hibou se rapprocha alors légèrement, et l’une de ses ailes vint toucher le front de Marz qui baissa la tête pour le saluer. L’effleurement laissa pourtant une trace, semblable à la chevelure des crosses dessinées sur le granit des parois du dolmen.
Marz chancela et ferma les yeux sous la marque qui hachurait ainsi sa peau.
– Va, cria-t-il alors. Va. Je te libère. Reprends ta vie.
Le grand hibou des bois, esprit des divinités et des peuples invisibles, battit des ailes et s’envola dans un puissant brassement d’air, qui le propulsa au-dessus de la plaine, en direction de la forêt.
– Je te libère, murmura encore Marz, pour l’ombre qui l’avait accompagné depuis son enfermement dans le tombeau de ses ancêtres, tandis qu’une larme coulait sur ses joues. Adieu.
Il tourna enfin le dos au tumulus qui gardait l’âme des morts, et se mit en marche vers le pays des vivants.
Au pied de la colline, le loup l’attendait en compagnie du cheval blanc, et ils l’escortèrent jusqu’à l’entrée du campement provisoire que Dyf avait fait monter pour les ouvriers qui resteraient sur place durant l’hiver afin de préparer le nouveau village.
Marz se retourna pour un dernier salut au chaman dont le corps reposait dans le dolmen isolé, là-haut sur la colline, dans l’espace immatériel entre ciel et terre. Le grand hibou planait au-dessus de lui et, dans ses ailes étendues qui cherchaient les courants du vent, il vit la promesse que la force de son grand-père veillerait à jamais sur lui et sur son peuple.
– Je te rejoindrai plus tard, avait-il assuré à Nuha, en lui caressant la joue. Je veux rester encore un moment avec l’esprit de mon grand-père.
L’endroit était calme, élevé sur une petite colline par les tribus qui les avaient précédés sur ces terres. Le tumulus était somptueux et impressionnant et, pour le bâtir, les ouvriers avaient utilisé des pierres énormes, assemblées avec art et grand soin. Il avait servi de sépulture à un autre chaman pour qui l’on avait décoré de gravures la plupart des pierres de granit qui formaient le long couloir menant à la petite chambre mortuaire. Les parois, le sol, et le sommet du dolmen étaient tous constitués de grandes dalles qui s’ajustaient si parfaitement qu’elles montraient le grand savoir-faire des tailleurs de pierres. Une rigole de sable calait les montants, tandis que le dallage était posé sur une grosse épaisseur de pierraille pour égaliser le niveau et stabiliser la structure. Orienté au sud-est, ce long couloir remontait légèrement vers la chambre qui donnait sur l’horizon, la mer et la plaine, à hauteur de la tête du dormeur éternel pour qu’il puisse admirer encore, dans son sommeil, l’endroit où son corps avait vécu sur la terre.
Une fois seul, Marz parcourut lentement le dolmen, passant sa main sur les pierres sculptées en se promettant d’envoyer les meilleurs graveurs pour terminer la décoration sur les parois encore lisses et brutes.
Puis il sortit dans le vent et le froid pour attendre.
Les prêtres et les chamans des autres villages, partis avec les habitants, et le lieu sacré rendu à sa solitude, tel une vigie devant la plaine, il savait que son visiteur allait venir. Il s’adossa à l’entrée du tombeau, stoïque malgré le vent et les embruns.
Il arriva enfin, porté par ses ailes immenses déployées pour jouer avec l’air.
Il était gigantesque et aussi merveilleux que la première fois où ils s’étaient rencontrés. Marz admira l’aisance avec laquelle il planait, tournait en silence dans le ciel, pour venir se poser juste devant lui, en étendant ses rémiges beiges, ourlées de noir. Sur sa tête ronde et veloutée, les dessins rappelaient les spirales gravées sur les parois du couloir. Au-dessus de son bec acéré ses yeux jaunes le fixèrent, tandis que le vent agitait doucement ses plumes. Il resta là, les pattes ancrées dans le sol, emplissant l’espace de sa puissance et de son envergure.
– Esprit de Leu, murmura Marz. Je dois maintenant me séparer de toi, et te laisser à ton silence éternel. Je dois aussi quitter ce double qui m’habite depuis que j’ai parcouru un autre monde, pour le renvoyer d’où il vient.
Le grand hibou se rapprocha alors légèrement, et l’une de ses ailes vint toucher le front de Marz qui baissa la tête pour le saluer. L’effleurement laissa pourtant une trace, semblable à la chevelure des crosses dessinées sur le granit des parois du dolmen.
Marz chancela et ferma les yeux sous la marque qui hachurait ainsi sa peau.
– Va, cria-t-il alors. Va. Je te libère. Reprends ta vie.
Le grand hibou des bois, esprit des divinités et des peuples invisibles, battit des ailes et s’envola dans un puissant brassement d’air, qui le propulsa au-dessus de la plaine, en direction de la forêt.
– Je te libère, murmura encore Marz, pour l’ombre qui l’avait accompagné depuis son enfermement dans le tombeau de ses ancêtres, tandis qu’une larme coulait sur ses joues. Adieu.
Il tourna enfin le dos au tumulus qui gardait l’âme des morts, et se mit en marche vers le pays des vivants.
Au pied de la colline, le loup l’attendait en compagnie du cheval blanc, et ils l’escortèrent jusqu’à l’entrée du campement provisoire que Dyf avait fait monter pour les ouvriers qui resteraient sur place durant l’hiver afin de préparer le nouveau village.
Marz se retourna pour un dernier salut au chaman dont le corps reposait dans le dolmen isolé, là-haut sur la colline, dans l’espace immatériel entre ciel et terre. Le grand hibou planait au-dessus de lui et, dans ses ailes étendues qui cherchaient les courants du vent, il vit la promesse que la force de son grand-père veillerait à jamais sur lui et sur son peuple.
Extrait "Les amants du menhir" 2011

Le vibreur résonna dans la voiture et Artus ajusta l’oreillette qui lui permettait de prendre les appels sans enfreindre la loi, pour rester connecté en permanence avec l’entreprise de son père.
A sa mort, il avait dû faire un choix difficile, la garder ou la vendre. Lui, était sculpteur, pas paysagiste, mais un récent problème cardiaque qui l’avait alerté et inquiété l’année précédente, lui avait fait prendre une décision rapide, le jour même de l’enterrement. Quitter Paris, fermer son atelier, et s’installer à Vannes. Son père avait une bonne équipe qu’il pouvait conserver avec l’aide de son cousin Loïc devenu chef jardinier, et il était lui-même assez artiste et concerné par l’environnement pour s’ajouter l’étiquette de paysagiste. Il serait ainsi au grand air une partie de ses journées, sans pour autant être obligé d’abandonner la sculpture.
En vraie parisienne, son épouse avait refusé tout net de s’installer à Vannes, avec une moue dégoûtée.
— Je veux bien y passer quelques jours en été, avait-elle concédé. Mais comment peux-tu songer à t’enterrer dans cette ville de province l’hiver ? Toute l’année à Vannes ? Tu n’y songes pas sérieusement, Artus ! Et ton atelier, tes élèves, tes commandes ?
Si, bien sûr qu’il y songeait. C’était son pays. Son enfance. La terre bretonne avec son histoire, ses légendes, son air marin, ses vents et ses tempêtes, mais aussi ses couchers de soleil somptueux, ses paysages sauvages et ses marées, son iode, sa cuisine de la mer. Artus n’avait écouté que ce désir impérieux qui s’était levé en lui comme un vent de liberté. Ne portait-il pas d’ailleurs le nom du plus grand des guerriers bretons ? Artus ! Le légendaire roi Arthur en personne !
— Eh bien, certains de mes élèves proposent déjà de venir à Vannes pour des stages, je travaillerai aussi bien là-bas, et je ferai des aller et retour lorsque tu auras besoin de moi à la Galerie. Paris et Vannes ne sont pas si éloignés après tout ! avait-il concédé.
Ses liens avec Amélie s’étaient distendus avec le temps et l’âge. Comme pour beaucoup de couples sans doute, se disait-il. Ils ne couchaient plus guère ensemble, et ce n’était que des gestes d’habitude dont il ressortait frustré et inquiet de ne pas ressentir plus de désir. Il avait soudain besoin d’autre chose, de passion, d’invention, d’un peu de folie pour exister et continuer à créer. Ils avaient fini par faire chambre à part et Amélie semblait s’en trouver bien, d’autant que son indifférence n’encourageait plus Artus à la rejoindre. Vivre à l’année en Bretagne n’avait pas changé grand chose à leurs relations après tout !
Il sortit de ses songes pour prendre l’appel qui bourdonnait. Il émanait de la nièce d’un vieil ami de son père, Yves Quéméné, qui venait de mourir lui aussi, en lui laissant le domaine de Kernoë. Il s’apprêtait à dire qu’élaguer des arbres n’entrait guère dans ses attributions lorsque quelque chose dans sa voix le retint, sans pouvoir expliquer la sensation qui le traversait.
— Je suis sur la route du golfe, s’entendit-il répondre. Je peux faire un crochet tout de suite par Saint-Gildas, si vous voulez…
Elle parut surprise mais rétorqua qu’elle n’avait rien de particulier ce soir-là et qu’elle l’attendrait.
Il entra dans Kernoë un quart d’heure plus tard, un peu avant la tombée du jour.
Alwena ouvrit la porte en entendant la voiture et le laissa se garer.
L’homme était grand, avec des épaules de nageur, un visage plein, et une bouche sensuelle qui lui rappela celles des statues romaines. Une émotion étrange passa entre eux lorsqu’ils se firent face, fugitive comme un éclair silencieux dans le ciel.
— Artus de Bazvalan, dit-il en lui tendant une main large, tiède et ferme.
Lorsque leurs doigts se touchèrent il y eut un instant de flottement durant lequel ils se regardèrent, intrigués tout à coup.
« Comme si je le connaissais, songea Alwena. Pourtant, je suis bien certaine de ne l’avoir jamais rencontré ! »
« Comme si je l’avais côtoyée autrefois, s’étonna Artus troublé. Mais elle est plus jeune que moi et nous ne nous sommes sans doute jamais croisés. »
— Vous êtes Alwena ? Votre oncle parlait souvent de vous à mon père qui me racontait sa vie ici lorsque je venais le rejoindre. Est-ce pour cela qu’il me semble vous connaître ?
— Peut-être, sourit Alwena. Il y a parfois des gens que l’on croit avoir rencontré ailleurs…Peut-être dans une autre vie ?
— Une autre vie ? C’est étrange que vous disiez cela. J’ai aussi la sensation d’avoir vécu autre chose, dans un monde différent, surtout lorsque je sculpte la pierre. Mes doigts semblent retrouver des gestes anciens et diriger eux-mêmes mon travail d’une façon à laquelle je n’avais pas songé de prime abord. Comme si des souvenirs très lointains remontaient à la surface, m’emplissaient d’images, et me suggéraient des formes, des idées….que je ne comprends pas toujours !
— Une mémoire du Temps ? murmura Alwena.
Artus sentit son cœur battre différemment. La vie s’éclairait soudain d’une petite lueur au bout d’un passage sombre. Il ne savait pas pourquoi, mais une sorte de quiétude venait de s’installer en lui, juste par le fait d’une rencontre, de quelques mots, d’un sourire, de la chaleur d’une voix.
— Que puis-je faire pour vous aider ? demanda-t-il pour reprendre pied dans la réalité.
— Je suis confuse, car j’ai réalisé en vous appelant que ce n’était pas votre travail que d’élaguer des arbres, dit Alwena embarrassée. Rozenn m’a dit que vous aviez repris l’entreprise de votre père. Pourtant ce n’est pas votre métier !
— En effet, je suis sculpteur, sourit Artus. Mais j’ai quitté Paris à sa mort pour m’occuper de « Bazvalan Paysages » et de ses clients, il y a quelques mois. D’abord pour ne pas mettre les employés au chômage, mais aussi parce que j’avais besoin de changer de façon de vivre. Je sais à présent que c’était une bonne décision, assura-t-il en se tournant vers l’horizon et le golfe qui s’effaçait peu à peu dans le soir. Lorsqu’un accident de santé vous rappelle à l’ordre, et vous fait comprendre que vous n’avez qu’une seule vie, que vous n’êtes pas éternel, vous savez que vous devez réfléchir à l’essence même de votre existence et vivre autrement ! Je suis très heureux ici, ajouta-t-il, sans dire qu’il avait pour cela fait l’impasse sur sa vie de couple. Effectivement, votre maison a besoin de soleil et d’espace, constata-t-il en regardant attentivement la façade. Il faudrait couper quelques arbres, en élaguer d’autres, et surtout nettoyer le bois. Est-ce ce que vous désirez, Alwena ?
Il l’avait appelée d’emblée par son prénom et elle ne s’offusqua pas de cette familiarité alors qu’ils ne se connaissaient pas l’instant d’auparavant, réconfortée plutôt par cette aisance chaleureuse qui s’était installée entre eux.
— Visitons le parc pour avoir une idée d’ensemble. Je reviendrai plus tard, en plein jour, proposa-t-il en souriant.
Ils marchèrent côte à côte le long de la pelouse bordée de massifs de rhododendrons, d’hortensias, et de buis qui attendaient d’être taillés.
— De quoi est mort votre oncle ?
— Je ne sais trop. Lorsque je l’ai vu le mois dernier il semblait en bonne santé malgré son âge. Rozenn dit qu’il était bien la veille mais elle l’a trouvé mort le lendemain matin dans son lit. Sans doute une crise cardiaque. Elle pense aussi qu’il était contrarié les derniers temps à cause d’un promoteur qui le harcelait pour acheter Kernoë.
— Votre oncle voulait vendre ? s’étonna Artus.
— Sûrement pas, rétorqua Alwena avec vivacité. D’après Rozenn, il n’arrivait pas à se débarrasser de cet homme.
— Il faut reconnaître que l’endroit est superbe et qu’il doit exciter la convoitise des constructeurs, admit Artus en s’arrêtant. Ils veulent mettre des immeubles partout, quitte à détruire le littoral si on les laisse faire.
Ils étaient parvenus dans le petit bois au bout du parc, un endroit touffu et si chargé de végétation qu’on n’y pouvait pénétrer aisément. Pourtant, un menhir surgissait de sa gangue de verdure, encerclé à sa base par une épaisse couche de mousses et de lichens, liserons, lierre et autres plantes vivaces.
— Oh ! s’exclama Artus frappé par l’étrangeté du lieu et l’atmosphère qui s’en dégageait. Je ne savais pas qu’il y avait un menhir ici…
— La région en est pleine. Carnac n’est pas loin.
— C’est vrai, à l’origine il y en avait des milliers qui s’étendaient sur des kilomètres. Il en reste encore beaucoup. Autrefois on pouvait se promener librement autour d’eux, murmura Artus en se rapprochant du menhir.
— Mais les dégradations des humains et du temps ont nécessité de les protéger. Je les ai photographiés souvent.
— Vous êtes photographe ? Avez-vous donc décidé de vous installer à Kernoë ?
— J’ai demandé en effet à être rattachée au Centre Archéologique de Vannes. Ma mutation est en cours. Et l’on vient de me commander des photos d’oiseaux des marais pour un ouvrage.
Artus sourit en constatant la similitude de leur parcours et de leur réflexion sur la vie.
— Ce menhir m’a toujours fascinée, expliqua Alwena. Je ne sais pas pourquoi. Ainsi que le tumulus, où je venais jouer lorsque j’étais enfant. L’accès en est bouché aujourd’hui...mais je ne me souviens plus depuis quand.
Ils avancèrent en même temps la main pour toucher la pierre, et lorsque leurs paumes s’imprimèrent ensemble sur la surface rugueuse, une petite secousse les saisit comme si un éclair avait traversé leurs corps. Un brouillard fugitif s’insinua dans leurs têtes tandis qu’un roulement de tonnerre grondait dans le ciel pourtant sans orage. Ils se regardèrent, surpris par la sensation indéfinissable et le nuage violet sombre qui stagnait maintenant au-dessus d’eux tel une corolle mouvante. Artus tira sur une des lianes qui encerclaient le menhir pour l’arracher à l’emprise qui le grignotait, et le tonnerre résonna à nouveau sourdement, comme un avertissement, tandis que de grosses gouttes s’abattaient sur la pierre levée.
— Étrange, murmura Artus. On dirait qu’il y a une force magnétique à cet endroit.
Alwena frissonna et Artus, d’un geste instinctif, l’entoura de son bras.
— Venez vite. Il va pleuvoir.
Ils revinrent en courant vers la demeure, sous la pluie qui déferlait sur le parc.
— Entrez vous sécher, proposa Alwena. Vous ne pouvez pas repartir ainsi…
Artus lui emboîta le pas et ils se mirent à rire en secouant leurs vêtements mouillés alors que rien n’avait présagé un orage.
— C’est souvent ainsi au début du printemps, dit Artus. Les marées apportent un changement dans le temps. C’est une des raisons pour laquelle ma femme déteste la Bretagne et a décidé de rester à Paris.
— Ah ! fit Alwena. Cela risque d’être compliqué pour vous !
— Pas du tout, assura Artus. Je dois dire que j’apprécie terriblement ma vie ici et je ne vois pas le temps passer. L’ancienne clientèle de mon père m’a fait confiance, et cela ne m’empêche nullement de garder mon activité de sculpteur. Tout cela m’a enrichi au contraire. Êtes-vous mariée, Alwena ? interrogea-t-il.
— J’ai eu un compagnon…autrefois. Un acteur. Mais cela me semble lointain ! dit-elle brièvement
Artus comprit qu’elle désirait éviter le sujet et lui rendit la serviette avec laquelle il s’était épongé les cheveux et le visage.
— Cette ancienne demeure a une âme et l’on s’y sent bien. Jouez-vous aussi de la harpe ? s’étonna-t-il en s’approchant du bel instrument qui trônait dans un coin du salon.
— Non. C’était celle de ma mère, qui était harpiste.
— Je vais vous laisser, Alwena. Je reviendrai plus tard pour mieux visiter le parc.
— Si vous n’êtes pas attendu…voulez-vous rester dîner ? proposa Alwena, surprise elle-même de sa soudaine audace. Rozenn a préparé une cotriade… pour plusieurs personnes, je le crains. Et son gâteau aux poires est un vrai délice !
Artus se mit à rire, sans rien lui dire du régime sévère auquel il était astreint depuis son alerte cardiaque, bien décidé à y faire une entorse ce soir-là.
— Voilà une soirée inattendue et bien plus agréable que ce qui était à mon programme. Cette cuisine est chaleureuse et ce repas tout ce que j’aime !
— Votre femme n’apprécie pas non plus la cuisine bretonne ? rit Alwena en servant le poisson et son bouillon.
— Son monde est trop sophistiqué pour se contenter de choses simples, murmura Artus.
« Tout doit être toujours sous contrôle, songea-t-il, en regardant Alwena se déplacer dans la cuisine. Chacun des gestes d’Amélie semble étudié, chaque mot pesé, chaque soupir feint ».
Avec le recul et cette vie quasi monastique qui était devenue la sienne, il se rendait compte qu’il n’éprouvait plus guère d’intérêt pour son environnement parisien, ses amis et ses sorties, et qu’il s’était réfugié ces dernières années dans son travail de création pour fuir ce qui l’ennuyait de plus en plus.
— Je vous ferai parvenir une proposition… et un devis raisonnable, dit-il après avoir dégusté le moelleux aux poires, avec force compliments pour la cuisine de Rozenn.
Il se dirigea vers la porte, en portant la main d’Alwena à ses lèvres, puis s’arrêta en l’ouvrant sur la nuit fraîche.
— Avez-vous déjà eu cette impression bizarre… et rassurante à la fois ? Je veux dire que je suis certain de ne jamais vous avoir rencontrée, et pourtant…
— C’est comme si nous nous connaissions de longue date, n’est-ce pas ? Comme si nous avions déjà…
— Vécu ensemble ? acheva-t-il avec un regard en coin.
— Je ne sais pas, fit Alwena embarrassée. En tout cas, c’est troublant. Tout comme cette sensation inconnue qui m’a saisie lorsque nous avons touché le menhir. Je vais rassembler dès demain tout ce que je peux trouver sur les mégalithes de la région. D’après mon oncle, mon père était très documenté sur la question.
Sur le seuil de la porte, Artus faillit la prendre contre lui, comme s’il l’avait déjà fait auparavant, puis il renonça. « Que suis-je en train d’imaginer ? »
Alwena prit une douche, puis se coucha avec un ouvrage sur les mégalithes, trouvé dans la bibliothèque, pour finir la soirée. Mais les seules lignes qui défilaient sous ses yeux disaient toutes la même chose. « Si nous nous étions côtoyés dans une autre vie, est-ce que je m’en souviendrais ? »
Lorsqu’elle se décida à fermer les volets, le menhir, éclairé par un rayon de lune directement à son sommet, brillait dans la nuit.
A sa mort, il avait dû faire un choix difficile, la garder ou la vendre. Lui, était sculpteur, pas paysagiste, mais un récent problème cardiaque qui l’avait alerté et inquiété l’année précédente, lui avait fait prendre une décision rapide, le jour même de l’enterrement. Quitter Paris, fermer son atelier, et s’installer à Vannes. Son père avait une bonne équipe qu’il pouvait conserver avec l’aide de son cousin Loïc devenu chef jardinier, et il était lui-même assez artiste et concerné par l’environnement pour s’ajouter l’étiquette de paysagiste. Il serait ainsi au grand air une partie de ses journées, sans pour autant être obligé d’abandonner la sculpture.
En vraie parisienne, son épouse avait refusé tout net de s’installer à Vannes, avec une moue dégoûtée.
— Je veux bien y passer quelques jours en été, avait-elle concédé. Mais comment peux-tu songer à t’enterrer dans cette ville de province l’hiver ? Toute l’année à Vannes ? Tu n’y songes pas sérieusement, Artus ! Et ton atelier, tes élèves, tes commandes ?
Si, bien sûr qu’il y songeait. C’était son pays. Son enfance. La terre bretonne avec son histoire, ses légendes, son air marin, ses vents et ses tempêtes, mais aussi ses couchers de soleil somptueux, ses paysages sauvages et ses marées, son iode, sa cuisine de la mer. Artus n’avait écouté que ce désir impérieux qui s’était levé en lui comme un vent de liberté. Ne portait-il pas d’ailleurs le nom du plus grand des guerriers bretons ? Artus ! Le légendaire roi Arthur en personne !
— Eh bien, certains de mes élèves proposent déjà de venir à Vannes pour des stages, je travaillerai aussi bien là-bas, et je ferai des aller et retour lorsque tu auras besoin de moi à la Galerie. Paris et Vannes ne sont pas si éloignés après tout ! avait-il concédé.
Ses liens avec Amélie s’étaient distendus avec le temps et l’âge. Comme pour beaucoup de couples sans doute, se disait-il. Ils ne couchaient plus guère ensemble, et ce n’était que des gestes d’habitude dont il ressortait frustré et inquiet de ne pas ressentir plus de désir. Il avait soudain besoin d’autre chose, de passion, d’invention, d’un peu de folie pour exister et continuer à créer. Ils avaient fini par faire chambre à part et Amélie semblait s’en trouver bien, d’autant que son indifférence n’encourageait plus Artus à la rejoindre. Vivre à l’année en Bretagne n’avait pas changé grand chose à leurs relations après tout !
Il sortit de ses songes pour prendre l’appel qui bourdonnait. Il émanait de la nièce d’un vieil ami de son père, Yves Quéméné, qui venait de mourir lui aussi, en lui laissant le domaine de Kernoë. Il s’apprêtait à dire qu’élaguer des arbres n’entrait guère dans ses attributions lorsque quelque chose dans sa voix le retint, sans pouvoir expliquer la sensation qui le traversait.
— Je suis sur la route du golfe, s’entendit-il répondre. Je peux faire un crochet tout de suite par Saint-Gildas, si vous voulez…
Elle parut surprise mais rétorqua qu’elle n’avait rien de particulier ce soir-là et qu’elle l’attendrait.
Il entra dans Kernoë un quart d’heure plus tard, un peu avant la tombée du jour.
Alwena ouvrit la porte en entendant la voiture et le laissa se garer.
L’homme était grand, avec des épaules de nageur, un visage plein, et une bouche sensuelle qui lui rappela celles des statues romaines. Une émotion étrange passa entre eux lorsqu’ils se firent face, fugitive comme un éclair silencieux dans le ciel.
— Artus de Bazvalan, dit-il en lui tendant une main large, tiède et ferme.
Lorsque leurs doigts se touchèrent il y eut un instant de flottement durant lequel ils se regardèrent, intrigués tout à coup.
« Comme si je le connaissais, songea Alwena. Pourtant, je suis bien certaine de ne l’avoir jamais rencontré ! »
« Comme si je l’avais côtoyée autrefois, s’étonna Artus troublé. Mais elle est plus jeune que moi et nous ne nous sommes sans doute jamais croisés. »
— Vous êtes Alwena ? Votre oncle parlait souvent de vous à mon père qui me racontait sa vie ici lorsque je venais le rejoindre. Est-ce pour cela qu’il me semble vous connaître ?
— Peut-être, sourit Alwena. Il y a parfois des gens que l’on croit avoir rencontré ailleurs…Peut-être dans une autre vie ?
— Une autre vie ? C’est étrange que vous disiez cela. J’ai aussi la sensation d’avoir vécu autre chose, dans un monde différent, surtout lorsque je sculpte la pierre. Mes doigts semblent retrouver des gestes anciens et diriger eux-mêmes mon travail d’une façon à laquelle je n’avais pas songé de prime abord. Comme si des souvenirs très lointains remontaient à la surface, m’emplissaient d’images, et me suggéraient des formes, des idées….que je ne comprends pas toujours !
— Une mémoire du Temps ? murmura Alwena.
Artus sentit son cœur battre différemment. La vie s’éclairait soudain d’une petite lueur au bout d’un passage sombre. Il ne savait pas pourquoi, mais une sorte de quiétude venait de s’installer en lui, juste par le fait d’une rencontre, de quelques mots, d’un sourire, de la chaleur d’une voix.
— Que puis-je faire pour vous aider ? demanda-t-il pour reprendre pied dans la réalité.
— Je suis confuse, car j’ai réalisé en vous appelant que ce n’était pas votre travail que d’élaguer des arbres, dit Alwena embarrassée. Rozenn m’a dit que vous aviez repris l’entreprise de votre père. Pourtant ce n’est pas votre métier !
— En effet, je suis sculpteur, sourit Artus. Mais j’ai quitté Paris à sa mort pour m’occuper de « Bazvalan Paysages » et de ses clients, il y a quelques mois. D’abord pour ne pas mettre les employés au chômage, mais aussi parce que j’avais besoin de changer de façon de vivre. Je sais à présent que c’était une bonne décision, assura-t-il en se tournant vers l’horizon et le golfe qui s’effaçait peu à peu dans le soir. Lorsqu’un accident de santé vous rappelle à l’ordre, et vous fait comprendre que vous n’avez qu’une seule vie, que vous n’êtes pas éternel, vous savez que vous devez réfléchir à l’essence même de votre existence et vivre autrement ! Je suis très heureux ici, ajouta-t-il, sans dire qu’il avait pour cela fait l’impasse sur sa vie de couple. Effectivement, votre maison a besoin de soleil et d’espace, constata-t-il en regardant attentivement la façade. Il faudrait couper quelques arbres, en élaguer d’autres, et surtout nettoyer le bois. Est-ce ce que vous désirez, Alwena ?
Il l’avait appelée d’emblée par son prénom et elle ne s’offusqua pas de cette familiarité alors qu’ils ne se connaissaient pas l’instant d’auparavant, réconfortée plutôt par cette aisance chaleureuse qui s’était installée entre eux.
— Visitons le parc pour avoir une idée d’ensemble. Je reviendrai plus tard, en plein jour, proposa-t-il en souriant.
Ils marchèrent côte à côte le long de la pelouse bordée de massifs de rhododendrons, d’hortensias, et de buis qui attendaient d’être taillés.
— De quoi est mort votre oncle ?
— Je ne sais trop. Lorsque je l’ai vu le mois dernier il semblait en bonne santé malgré son âge. Rozenn dit qu’il était bien la veille mais elle l’a trouvé mort le lendemain matin dans son lit. Sans doute une crise cardiaque. Elle pense aussi qu’il était contrarié les derniers temps à cause d’un promoteur qui le harcelait pour acheter Kernoë.
— Votre oncle voulait vendre ? s’étonna Artus.
— Sûrement pas, rétorqua Alwena avec vivacité. D’après Rozenn, il n’arrivait pas à se débarrasser de cet homme.
— Il faut reconnaître que l’endroit est superbe et qu’il doit exciter la convoitise des constructeurs, admit Artus en s’arrêtant. Ils veulent mettre des immeubles partout, quitte à détruire le littoral si on les laisse faire.
Ils étaient parvenus dans le petit bois au bout du parc, un endroit touffu et si chargé de végétation qu’on n’y pouvait pénétrer aisément. Pourtant, un menhir surgissait de sa gangue de verdure, encerclé à sa base par une épaisse couche de mousses et de lichens, liserons, lierre et autres plantes vivaces.
— Oh ! s’exclama Artus frappé par l’étrangeté du lieu et l’atmosphère qui s’en dégageait. Je ne savais pas qu’il y avait un menhir ici…
— La région en est pleine. Carnac n’est pas loin.
— C’est vrai, à l’origine il y en avait des milliers qui s’étendaient sur des kilomètres. Il en reste encore beaucoup. Autrefois on pouvait se promener librement autour d’eux, murmura Artus en se rapprochant du menhir.
— Mais les dégradations des humains et du temps ont nécessité de les protéger. Je les ai photographiés souvent.
— Vous êtes photographe ? Avez-vous donc décidé de vous installer à Kernoë ?
— J’ai demandé en effet à être rattachée au Centre Archéologique de Vannes. Ma mutation est en cours. Et l’on vient de me commander des photos d’oiseaux des marais pour un ouvrage.
Artus sourit en constatant la similitude de leur parcours et de leur réflexion sur la vie.
— Ce menhir m’a toujours fascinée, expliqua Alwena. Je ne sais pas pourquoi. Ainsi que le tumulus, où je venais jouer lorsque j’étais enfant. L’accès en est bouché aujourd’hui...mais je ne me souviens plus depuis quand.
Ils avancèrent en même temps la main pour toucher la pierre, et lorsque leurs paumes s’imprimèrent ensemble sur la surface rugueuse, une petite secousse les saisit comme si un éclair avait traversé leurs corps. Un brouillard fugitif s’insinua dans leurs têtes tandis qu’un roulement de tonnerre grondait dans le ciel pourtant sans orage. Ils se regardèrent, surpris par la sensation indéfinissable et le nuage violet sombre qui stagnait maintenant au-dessus d’eux tel une corolle mouvante. Artus tira sur une des lianes qui encerclaient le menhir pour l’arracher à l’emprise qui le grignotait, et le tonnerre résonna à nouveau sourdement, comme un avertissement, tandis que de grosses gouttes s’abattaient sur la pierre levée.
— Étrange, murmura Artus. On dirait qu’il y a une force magnétique à cet endroit.
Alwena frissonna et Artus, d’un geste instinctif, l’entoura de son bras.
— Venez vite. Il va pleuvoir.
Ils revinrent en courant vers la demeure, sous la pluie qui déferlait sur le parc.
— Entrez vous sécher, proposa Alwena. Vous ne pouvez pas repartir ainsi…
Artus lui emboîta le pas et ils se mirent à rire en secouant leurs vêtements mouillés alors que rien n’avait présagé un orage.
— C’est souvent ainsi au début du printemps, dit Artus. Les marées apportent un changement dans le temps. C’est une des raisons pour laquelle ma femme déteste la Bretagne et a décidé de rester à Paris.
— Ah ! fit Alwena. Cela risque d’être compliqué pour vous !
— Pas du tout, assura Artus. Je dois dire que j’apprécie terriblement ma vie ici et je ne vois pas le temps passer. L’ancienne clientèle de mon père m’a fait confiance, et cela ne m’empêche nullement de garder mon activité de sculpteur. Tout cela m’a enrichi au contraire. Êtes-vous mariée, Alwena ? interrogea-t-il.
— J’ai eu un compagnon…autrefois. Un acteur. Mais cela me semble lointain ! dit-elle brièvement
Artus comprit qu’elle désirait éviter le sujet et lui rendit la serviette avec laquelle il s’était épongé les cheveux et le visage.
— Cette ancienne demeure a une âme et l’on s’y sent bien. Jouez-vous aussi de la harpe ? s’étonna-t-il en s’approchant du bel instrument qui trônait dans un coin du salon.
— Non. C’était celle de ma mère, qui était harpiste.
— Je vais vous laisser, Alwena. Je reviendrai plus tard pour mieux visiter le parc.
— Si vous n’êtes pas attendu…voulez-vous rester dîner ? proposa Alwena, surprise elle-même de sa soudaine audace. Rozenn a préparé une cotriade… pour plusieurs personnes, je le crains. Et son gâteau aux poires est un vrai délice !
Artus se mit à rire, sans rien lui dire du régime sévère auquel il était astreint depuis son alerte cardiaque, bien décidé à y faire une entorse ce soir-là.
— Voilà une soirée inattendue et bien plus agréable que ce qui était à mon programme. Cette cuisine est chaleureuse et ce repas tout ce que j’aime !
— Votre femme n’apprécie pas non plus la cuisine bretonne ? rit Alwena en servant le poisson et son bouillon.
— Son monde est trop sophistiqué pour se contenter de choses simples, murmura Artus.
« Tout doit être toujours sous contrôle, songea-t-il, en regardant Alwena se déplacer dans la cuisine. Chacun des gestes d’Amélie semble étudié, chaque mot pesé, chaque soupir feint ».
Avec le recul et cette vie quasi monastique qui était devenue la sienne, il se rendait compte qu’il n’éprouvait plus guère d’intérêt pour son environnement parisien, ses amis et ses sorties, et qu’il s’était réfugié ces dernières années dans son travail de création pour fuir ce qui l’ennuyait de plus en plus.
— Je vous ferai parvenir une proposition… et un devis raisonnable, dit-il après avoir dégusté le moelleux aux poires, avec force compliments pour la cuisine de Rozenn.
Il se dirigea vers la porte, en portant la main d’Alwena à ses lèvres, puis s’arrêta en l’ouvrant sur la nuit fraîche.
— Avez-vous déjà eu cette impression bizarre… et rassurante à la fois ? Je veux dire que je suis certain de ne jamais vous avoir rencontrée, et pourtant…
— C’est comme si nous nous connaissions de longue date, n’est-ce pas ? Comme si nous avions déjà…
— Vécu ensemble ? acheva-t-il avec un regard en coin.
— Je ne sais pas, fit Alwena embarrassée. En tout cas, c’est troublant. Tout comme cette sensation inconnue qui m’a saisie lorsque nous avons touché le menhir. Je vais rassembler dès demain tout ce que je peux trouver sur les mégalithes de la région. D’après mon oncle, mon père était très documenté sur la question.
Sur le seuil de la porte, Artus faillit la prendre contre lui, comme s’il l’avait déjà fait auparavant, puis il renonça. « Que suis-je en train d’imaginer ? »
Alwena prit une douche, puis se coucha avec un ouvrage sur les mégalithes, trouvé dans la bibliothèque, pour finir la soirée. Mais les seules lignes qui défilaient sous ses yeux disaient toutes la même chose. « Si nous nous étions côtoyés dans une autre vie, est-ce que je m’en souviendrais ? »
Lorsqu’elle se décida à fermer les volets, le menhir, éclairé par un rayon de lune directement à son sommet, brillait dans la nuit.
Extrait : "Sang d'hermine", 2010
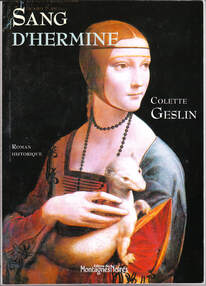
Une mariée de huit ans
Bretagne, Donjon de Montafilant, juillet 1444
L’enfant chantonnait en remontant le sentier vers le castel de Montafilant, des fleurs plein les bras. Ses sabots claquaient sur la terre fraîche, le bas de sa longue tunique rouge humide car elle s’était approchée de l’étang, et ses cheveux châtain doré, échappés de son bonnet de dentelles, étalés sur son dos comme un mantelet.
Elle allait en sautillant, bien en avant d’Erell sa nourrice qui ne pouvait suivre son train d’enfant, quand elle entendit le galop. Le cavalier déboucha du tournant à une allure trop rapide pour s’arrêter. Elle comprit tout de suite que la voie était trop étroite pour elle et le cheval et se jeta instinctivement dans les buissons au moment même où il passa en la frôlant. Elle sentit son souffle rauque sur sa nuque, quelque chose brûla ses bras nus, peut-être l’écume de l’étalon mené vivement par un cavalier nerveux, et elle tomba avec un cri de douleur.
L’homme et sa monture s’éloignèrent à grand fracas, le pas du cheval résonnant encore sourdement sur le sol comme un tambour, et Soisig resta allongée sans bouger, étourdie et sonnée. Erell, en arrière dans le sentier, n’avait rien dû voir de la scène. L’enfant essaya de respirer calmement, étendue dans l’herbe et sur les branches cassées, puis elle remua doucement les jambes pour savoir si tout allait bien.
Deux bras l’entourèrent alors, la touchant sur tout le corps, tâtant sa tête, ses épaules, son torse. Elle gémit lorsque l’homme frôla son genou et vit que le cavalier inconnu la tenait contre lui et la fixait d’un regard anxieux.
– Enfant…tu n’as rien ?
Il sentait bon. Une odeur inconnue, mélangée à celle du cheval qu’il venait de quitter et qui errait tranquillement sur le sentier en mâchonnant les arbustes. L’homme était jeune, vêtu d’un habit de velours brun de qualité, un chaperon rouge sur la tête, et lorsqu’il la releva elle remarqua ses bottes d’un beau cuir, et le bijou précieux qu’il portait au doigt.
Et puis Erell fut là dans un grand envol de jupons, et cria de peur.
– Damoiselle Soisig ! Qu’est-il arrivé ?
Elle repoussa sans ménagement le cavalier inconnu. « Que lui avez-vous fait ? », dit-elle d’un ton bourru.
– Mais, rien, marmonna l’homme. Je dois dire cependant que j’allais un peu trop vite avec Guilledin. L’enfant est tombée sur le bas côté…
– Elle a dû s’y jeter pour vous éviter, oui-da ! gronda Erell mécontente. Messire, on ne galope pas à cette vitesse dans un sentier si étroit. Vous auriez pu tuer damoiselle Soisig!...
– Je vais bien, Erell, chuchota Soisig en se mettant debout avec une grimace car son genou la faisait souffrir.
– Damoiselle Soisig ? fit alors le cavalier avec un air de surprise, comme s’il réalisait seulement qui elle pouvait être. Êtes-vous de Montafilant ?
Soisig osa le regarder au visage et le trouva beau. Il avait des traits fins, une peau douce, il était bien rasé et son phrasé avait un léger accent qu’elle ne sut définir.
« Anglais ? » se demanda-t-elle.
Puis son regard tomba sur la couverture brodée aux armes ducales qui couvrait le dos du cheval, et elle constata qu’Erell l’avait aussi remarquée et qu’elle paraissait de plus en plus mécontente.
– Si vous le permettez, damoiselle, je vais vous raccompagner. Le genou semble vous faire mal, ajouta-t-il en tendant la main pour lui toucher doucement la jambe.
Soisig lorgna vers le superbe cheval bai accouru au sifflement de son maître, et qui lui poussait le dos de sa belle tête fine et racée.
– Guilledin1 vous portera pour se faire pardonner son galop intempestif, rit-il. Puis-je vous déposer maintenant sur son dos ?
Soisig se mit à rire de bon cœur.
– Erell, regarde ce magnifique cheval. Ce n’est pas sa faute. C’est moi qui suis tombée. Rentrons au castel.
Le cavalier sourit, la prit dans ses bras pour l’installer sur l’étalon puis, s’aidant d’une pierre comme marchepied, il s’enleva derrière elle et la tint bien serrée contre lui.
Soisig se dit qu’elle aimait décidément son odeur. La plupart des hommes sentaient le cheval, le fumier, la saleté et la sueur. Lui, non. C’était agréable d’être ainsi lovée contre son épaule, dans les replis du grand manteau qu’il avait ramené contre elle.
Le castel de Montafilant apparut bientôt.
– Est-ce là que vous habitez, damoiselle ?
– Oui, messire. Avec ma mère, dame Catherine…
La réponse parut plaire à l’inconnu pour une raison que l’enfant ne devina pas.
– Oui. Je crois savoir qui est la dame de Montafilant. Erell est-elle votre gouvernante ?
– Ma nourrice, messire. Désirez-vous entrer au castel ?
– Non, damoiselle. Puis-je vous laisser ici ?
– Bien sûr, messire. Tout va bien à présent, dit-elle bravement, en essayant de ne pas trop appuyer sur sa jambe encore douloureuse.
– Alors je viendrai plus tard prendre de vos nouvelles.
Soisig sentit ses joues devenir rouges sous le regard qu’il lui lança et qu’elle ne sut comment interpréter. Elle n’avait que huit ans et le jeune homme devait être quelque noble d’une grande famille, peut-être même apparenté au duc de Bretagne puisque la couverture du cheval en portait les armes.
Il la posa à terre près d’Erell qui lui prit rapidement la main, et il les regarda s’éloigner vers l’entrée et le pont-levis du castel, l’enfant boitant légèrement, puis il tourna bride et repartit vers la côte.
– Sais-tu qui il est, Erell ? demanda Soisig avant d’entrer, en se retournant.
– Ma foi, non, damoiselle, marmonna la femme d’un ton incertain. Venez vite vous changer maintenant. Et vous soigner. Je crains que dame Catherine ne soit guère contente après nous.
*
– Gilles, tu es sûr de ce que tu veux faire ? demanda Tangui contrarié.
– Absolument, mon frère. Je ne cesse d’y songer depuis que je suis rentré d’Angleterre et que j’ai appris la mort de son père et de son oncle. Cette enfant-là est la plus riche héritière du duché et c’est elle qui me donnera la puissance face à mon frère qui est maintenant le duc de Bretagne. Et moi, que suis-je, dis-moi ? On m’a pourvu d’un bien maigre apanage, avec celui du seigneur de Rais lorsqu’il a été exécuté il y a quatre ans. Brr ! Quel cadeau ! D’ailleurs le roi Charles, dont il dépend, semble vouloir me le reprendre, et mon oncle Richemont ne fait rien pour me défendre !
– Il faut dire aussi que ton mémoire remis au roi Henri d’Angleterre n’est pas des plus habiles, ni rassurant pour le duc. N’offres-tu pas tout bonnement de servir le roi anglais, au détriment du duché de Bretagne ?
– Eh bien ? Henri est notre parent, et François n’avait qu’à me donner un apanage conséquent et à m’entretenir mieux qu’il ne le fait, dû à mon rang ! Françoise de Dinan est juste ce qu’il me faut pour devenir quelqu’un qui compte en Bretagne !
– Mais ce n’est qu’une enfant ! protesta Tangui.
– Ce n’est peut-être encore qu’une enfant, il n’empêche qu’elle a déjà été promise au fils de ma défunte sœur Isabelle et de Gui de Laval. Ne crois-tu pas que je fais un bien meilleur parti ? rétorqua Gilles en bombant le torse et en tournant sur lui-même d’un air dansant.
– Peut-être, peut-être, répliqua Tangui sans vouloir se laisser dérider tout à fait. Mais qu’en dira le duc ?
– François ne pourra qu’approuver, car il sera ainsi débarrassé du souci de me voir sans véritable douaire. Et puis n’a-t-il pas à se faire pardonner d’avoir épousé Isabelle d’Écosse, il y a deux années, alors qu’elle m’était destinée ? ajouta-t-il, non sans mauvaise foi, comme tout ce qui touchait à son frère aîné.
– C’est toi qui as refusé, Gilles. Sois honnête, rétorqua Tangui sévèrement.
– Bon, bon, bougonna Gilles. Quant à Pierre, il est bellement marié à Françoise d’Amboise. Moi je n’ai pour l’heure, ni épouse, ni apanage, à part la rente accordée par notre défunt père et les propriétés du pays de Rais. Mais avec la fortune de Françoise de Dinan, tout cela va changer !
– Oui, oui, mais il faudra pour cela rompre les engagements avec le comte de Laval pour son fils, et ni lui, ni le grand-père Rohan de la petite Soisig ne l’entendront ainsi. Ils seront furieux.
Gilles haussa les épaules sans vouloir s’arrêter à l’argumentation de son demi-frère, bâtard et premier enfant de leur père, feu le duc Jean V.
– C’est bien pour ça que je veux agir tout de suite. François en sera quitte pour leur offrir un dédommagement qui les calmera. Rohan n’est point si fortuné après tout que cela ne puisse apaiser son ire. Quand au comte de Laval, mon cher beau-frère, ironisa Gilles, il trouvera bien un autre parti aussi prestigieux pour son fils qui n’a guère que neuf ans et qui peut bien attendre pour se marier. Moi, non ! s’esclaffa-t-il.
– Et dame Catherine ? Y as-tu songé ? reprit Tangui à bout d’argument.
– Bien sûr que j’y songe. Elle m’apprécie, je crois. Enfin elle a toujours montré beaucoup de bonté à mon égard et ce depuis ma jeunesse. Que sa fille devienne la belle-sœur du duc François ne pourra que la flatter, tu ne penses pas ?
– En as-tu parlé à notre oncle Richemont ? objecta encore Tangui.
Gilles se mordit les lèvres, car Tangui avait raison sur ce point. Leur oncle était un personnage puissant et redouté, qui le protégeait depuis l’enfance certes, le défendait face à ses frères aînés, mais qui devait être ménagé et il ne serait peut-être pas très satisfait d’être ainsi mis devant le fait accompli.
– Pas encore, pas encore, reconnut-il. Mais je suis certain qu’il n’ira pas contre ce projet. Tu m’assommes avec tes craintes, Tangui !
– Ce ne sera plus un projet demain …mais une réalité, si je te suis bien. Et qui aurait bien failli rater si tu avais tué l’enfant tantôt sur ce sentier, grommela Tangui en tapant l’épaule de son demi-frère. Comment est-elle ?
– Françoise de Dinan ? Bah ! Elle a huit ans, Tangui, et n’est ni belle, ni laide, à ce que j’ai pu voir. Mais elle peut devenir une beauté plus tard. Nous verrons bien. De toute façon peu importe ! C’est la plus riche héritière de Bretagne depuis la mort de son père, et surtout depuis celle du maréchal de Dinan, son oncle, qui l’a instituée sa seule héritière. Te rends-tu compte, cette fillette possède plus de châteaux, de terres et de baronnies que moi, qui suis fils et frère de ducs. Je ne saurais même pas compter ses possessions.
– Dinan, Montafilant, La Roche-Suhart, qui est une ruine, La Hardouinaie, Beaumanoir, Le Bodister, énuméra Tangui qui connaissait bien le duché.
– Et surtout Le Guildo ! Ce castel est une merveille, Tangui. C’est là que je veux habiter désormais. J’adore cet endroit, s’enthousiasma Gilles. Au bord de l’eau, face aux côtes anglaises, tout près de Saint-Brieuc, et de Saint Malo par la mer. Nous pourrons naviguer, chasser, nous amuser.
– Ne t’emballe pas si vite, Gilles.
– Mais si, mais si, rétorqua Gilles qui ne voulait pas laisser souffler sur son rêve. Et puis il y a aussi d’autres propriétés au sud, l’importante baronnie de Châteaubriant, celle de Vioreau, et la châtellenie des Huguetières à l’est du lac de Grandlieu. Elle a hérité d’une partie des biens du connétable Olivier de Clisson, et de la famille de Beaumanoir, en plus de celle des Dinan. C’est un parti magnifique, Tangui, juste à ma mesure.
– Huit ans, mon frère. Tu ne vas tout de même pas coucher avec une petite fille, il te faut plus que ça, je le sais trop bien…
– Oui, eh bien, nous avons suffisamment de femmes autour de nous pour attendre et calmer ma faim…et la tienne, s’esclaffa Gilles de très bonne humeur depuis qu’il voyait son but approcher. J’aurai ainsi une épouse, sans avoir les inconvénients du mariage !
– Tu es immoral, Gilles!
– Absolument. J’en conviens.
– Te absolvo, ricana Tangui.
– Merci, grand frère. Nous allons avoir de bons jours ensemble maintenant. Fini l’esclavage de mon cher aîné, fini ses remontrances, ses remarques, ses leçons et ses grands airs de duc. Il n’a cessé de m’humilier durant notre enfance. Et depuis la mort de nos parents, c’est bien pire. Cette fois, je vais être riche, et il devra compter avec moi !
– Cette rivalité avec François te perdra, Gilles. Vous vous heurtez dès que vous êtes face à face. N’oublie pas qu’il est maintenant le duc et qu’il voit d’un très mauvais œil ton amitié avec le roi anglais. Henri te verse une rente de deux mille nobles2, presque aussi conséquente que les six mille livres allouées par ton père, et cela ne lui plaît pas du tout.
Gilles haussa les épaules.
– Eh bien, il faudra qu’il s’en accommode. Ou alors qu’il me dote plus richement lui-même. Allez, viens. Demain matin nous nous présenterons chez la dame de Dinan-Montafilant et il faudra être persuasif. Mais je crois qu’elle acceptera ma proposition car je lui ai déjà envoyé un émissaire pour tâter le terrain en lui promettant une compensation financière. Pour l’heure, allons au monastère. Il y a bien un moine qui acceptera de nous marier sans délai. Il faut que tout soit consommé très vite. Il y a trop de prétendants aux trousses de cette jeune personne, mon frère !
Bretagne, Donjon de Montafilant, juillet 1444
L’enfant chantonnait en remontant le sentier vers le castel de Montafilant, des fleurs plein les bras. Ses sabots claquaient sur la terre fraîche, le bas de sa longue tunique rouge humide car elle s’était approchée de l’étang, et ses cheveux châtain doré, échappés de son bonnet de dentelles, étalés sur son dos comme un mantelet.
Elle allait en sautillant, bien en avant d’Erell sa nourrice qui ne pouvait suivre son train d’enfant, quand elle entendit le galop. Le cavalier déboucha du tournant à une allure trop rapide pour s’arrêter. Elle comprit tout de suite que la voie était trop étroite pour elle et le cheval et se jeta instinctivement dans les buissons au moment même où il passa en la frôlant. Elle sentit son souffle rauque sur sa nuque, quelque chose brûla ses bras nus, peut-être l’écume de l’étalon mené vivement par un cavalier nerveux, et elle tomba avec un cri de douleur.
L’homme et sa monture s’éloignèrent à grand fracas, le pas du cheval résonnant encore sourdement sur le sol comme un tambour, et Soisig resta allongée sans bouger, étourdie et sonnée. Erell, en arrière dans le sentier, n’avait rien dû voir de la scène. L’enfant essaya de respirer calmement, étendue dans l’herbe et sur les branches cassées, puis elle remua doucement les jambes pour savoir si tout allait bien.
Deux bras l’entourèrent alors, la touchant sur tout le corps, tâtant sa tête, ses épaules, son torse. Elle gémit lorsque l’homme frôla son genou et vit que le cavalier inconnu la tenait contre lui et la fixait d’un regard anxieux.
– Enfant…tu n’as rien ?
Il sentait bon. Une odeur inconnue, mélangée à celle du cheval qu’il venait de quitter et qui errait tranquillement sur le sentier en mâchonnant les arbustes. L’homme était jeune, vêtu d’un habit de velours brun de qualité, un chaperon rouge sur la tête, et lorsqu’il la releva elle remarqua ses bottes d’un beau cuir, et le bijou précieux qu’il portait au doigt.
Et puis Erell fut là dans un grand envol de jupons, et cria de peur.
– Damoiselle Soisig ! Qu’est-il arrivé ?
Elle repoussa sans ménagement le cavalier inconnu. « Que lui avez-vous fait ? », dit-elle d’un ton bourru.
– Mais, rien, marmonna l’homme. Je dois dire cependant que j’allais un peu trop vite avec Guilledin. L’enfant est tombée sur le bas côté…
– Elle a dû s’y jeter pour vous éviter, oui-da ! gronda Erell mécontente. Messire, on ne galope pas à cette vitesse dans un sentier si étroit. Vous auriez pu tuer damoiselle Soisig!...
– Je vais bien, Erell, chuchota Soisig en se mettant debout avec une grimace car son genou la faisait souffrir.
– Damoiselle Soisig ? fit alors le cavalier avec un air de surprise, comme s’il réalisait seulement qui elle pouvait être. Êtes-vous de Montafilant ?
Soisig osa le regarder au visage et le trouva beau. Il avait des traits fins, une peau douce, il était bien rasé et son phrasé avait un léger accent qu’elle ne sut définir.
« Anglais ? » se demanda-t-elle.
Puis son regard tomba sur la couverture brodée aux armes ducales qui couvrait le dos du cheval, et elle constata qu’Erell l’avait aussi remarquée et qu’elle paraissait de plus en plus mécontente.
– Si vous le permettez, damoiselle, je vais vous raccompagner. Le genou semble vous faire mal, ajouta-t-il en tendant la main pour lui toucher doucement la jambe.
Soisig lorgna vers le superbe cheval bai accouru au sifflement de son maître, et qui lui poussait le dos de sa belle tête fine et racée.
– Guilledin1 vous portera pour se faire pardonner son galop intempestif, rit-il. Puis-je vous déposer maintenant sur son dos ?
Soisig se mit à rire de bon cœur.
– Erell, regarde ce magnifique cheval. Ce n’est pas sa faute. C’est moi qui suis tombée. Rentrons au castel.
Le cavalier sourit, la prit dans ses bras pour l’installer sur l’étalon puis, s’aidant d’une pierre comme marchepied, il s’enleva derrière elle et la tint bien serrée contre lui.
Soisig se dit qu’elle aimait décidément son odeur. La plupart des hommes sentaient le cheval, le fumier, la saleté et la sueur. Lui, non. C’était agréable d’être ainsi lovée contre son épaule, dans les replis du grand manteau qu’il avait ramené contre elle.
Le castel de Montafilant apparut bientôt.
– Est-ce là que vous habitez, damoiselle ?
– Oui, messire. Avec ma mère, dame Catherine…
La réponse parut plaire à l’inconnu pour une raison que l’enfant ne devina pas.
– Oui. Je crois savoir qui est la dame de Montafilant. Erell est-elle votre gouvernante ?
– Ma nourrice, messire. Désirez-vous entrer au castel ?
– Non, damoiselle. Puis-je vous laisser ici ?
– Bien sûr, messire. Tout va bien à présent, dit-elle bravement, en essayant de ne pas trop appuyer sur sa jambe encore douloureuse.
– Alors je viendrai plus tard prendre de vos nouvelles.
Soisig sentit ses joues devenir rouges sous le regard qu’il lui lança et qu’elle ne sut comment interpréter. Elle n’avait que huit ans et le jeune homme devait être quelque noble d’une grande famille, peut-être même apparenté au duc de Bretagne puisque la couverture du cheval en portait les armes.
Il la posa à terre près d’Erell qui lui prit rapidement la main, et il les regarda s’éloigner vers l’entrée et le pont-levis du castel, l’enfant boitant légèrement, puis il tourna bride et repartit vers la côte.
– Sais-tu qui il est, Erell ? demanda Soisig avant d’entrer, en se retournant.
– Ma foi, non, damoiselle, marmonna la femme d’un ton incertain. Venez vite vous changer maintenant. Et vous soigner. Je crains que dame Catherine ne soit guère contente après nous.
*
– Gilles, tu es sûr de ce que tu veux faire ? demanda Tangui contrarié.
– Absolument, mon frère. Je ne cesse d’y songer depuis que je suis rentré d’Angleterre et que j’ai appris la mort de son père et de son oncle. Cette enfant-là est la plus riche héritière du duché et c’est elle qui me donnera la puissance face à mon frère qui est maintenant le duc de Bretagne. Et moi, que suis-je, dis-moi ? On m’a pourvu d’un bien maigre apanage, avec celui du seigneur de Rais lorsqu’il a été exécuté il y a quatre ans. Brr ! Quel cadeau ! D’ailleurs le roi Charles, dont il dépend, semble vouloir me le reprendre, et mon oncle Richemont ne fait rien pour me défendre !
– Il faut dire aussi que ton mémoire remis au roi Henri d’Angleterre n’est pas des plus habiles, ni rassurant pour le duc. N’offres-tu pas tout bonnement de servir le roi anglais, au détriment du duché de Bretagne ?
– Eh bien ? Henri est notre parent, et François n’avait qu’à me donner un apanage conséquent et à m’entretenir mieux qu’il ne le fait, dû à mon rang ! Françoise de Dinan est juste ce qu’il me faut pour devenir quelqu’un qui compte en Bretagne !
– Mais ce n’est qu’une enfant ! protesta Tangui.
– Ce n’est peut-être encore qu’une enfant, il n’empêche qu’elle a déjà été promise au fils de ma défunte sœur Isabelle et de Gui de Laval. Ne crois-tu pas que je fais un bien meilleur parti ? rétorqua Gilles en bombant le torse et en tournant sur lui-même d’un air dansant.
– Peut-être, peut-être, répliqua Tangui sans vouloir se laisser dérider tout à fait. Mais qu’en dira le duc ?
– François ne pourra qu’approuver, car il sera ainsi débarrassé du souci de me voir sans véritable douaire. Et puis n’a-t-il pas à se faire pardonner d’avoir épousé Isabelle d’Écosse, il y a deux années, alors qu’elle m’était destinée ? ajouta-t-il, non sans mauvaise foi, comme tout ce qui touchait à son frère aîné.
– C’est toi qui as refusé, Gilles. Sois honnête, rétorqua Tangui sévèrement.
– Bon, bon, bougonna Gilles. Quant à Pierre, il est bellement marié à Françoise d’Amboise. Moi je n’ai pour l’heure, ni épouse, ni apanage, à part la rente accordée par notre défunt père et les propriétés du pays de Rais. Mais avec la fortune de Françoise de Dinan, tout cela va changer !
– Oui, oui, mais il faudra pour cela rompre les engagements avec le comte de Laval pour son fils, et ni lui, ni le grand-père Rohan de la petite Soisig ne l’entendront ainsi. Ils seront furieux.
Gilles haussa les épaules sans vouloir s’arrêter à l’argumentation de son demi-frère, bâtard et premier enfant de leur père, feu le duc Jean V.
– C’est bien pour ça que je veux agir tout de suite. François en sera quitte pour leur offrir un dédommagement qui les calmera. Rohan n’est point si fortuné après tout que cela ne puisse apaiser son ire. Quand au comte de Laval, mon cher beau-frère, ironisa Gilles, il trouvera bien un autre parti aussi prestigieux pour son fils qui n’a guère que neuf ans et qui peut bien attendre pour se marier. Moi, non ! s’esclaffa-t-il.
– Et dame Catherine ? Y as-tu songé ? reprit Tangui à bout d’argument.
– Bien sûr que j’y songe. Elle m’apprécie, je crois. Enfin elle a toujours montré beaucoup de bonté à mon égard et ce depuis ma jeunesse. Que sa fille devienne la belle-sœur du duc François ne pourra que la flatter, tu ne penses pas ?
– En as-tu parlé à notre oncle Richemont ? objecta encore Tangui.
Gilles se mordit les lèvres, car Tangui avait raison sur ce point. Leur oncle était un personnage puissant et redouté, qui le protégeait depuis l’enfance certes, le défendait face à ses frères aînés, mais qui devait être ménagé et il ne serait peut-être pas très satisfait d’être ainsi mis devant le fait accompli.
– Pas encore, pas encore, reconnut-il. Mais je suis certain qu’il n’ira pas contre ce projet. Tu m’assommes avec tes craintes, Tangui !
– Ce ne sera plus un projet demain …mais une réalité, si je te suis bien. Et qui aurait bien failli rater si tu avais tué l’enfant tantôt sur ce sentier, grommela Tangui en tapant l’épaule de son demi-frère. Comment est-elle ?
– Françoise de Dinan ? Bah ! Elle a huit ans, Tangui, et n’est ni belle, ni laide, à ce que j’ai pu voir. Mais elle peut devenir une beauté plus tard. Nous verrons bien. De toute façon peu importe ! C’est la plus riche héritière de Bretagne depuis la mort de son père, et surtout depuis celle du maréchal de Dinan, son oncle, qui l’a instituée sa seule héritière. Te rends-tu compte, cette fillette possède plus de châteaux, de terres et de baronnies que moi, qui suis fils et frère de ducs. Je ne saurais même pas compter ses possessions.
– Dinan, Montafilant, La Roche-Suhart, qui est une ruine, La Hardouinaie, Beaumanoir, Le Bodister, énuméra Tangui qui connaissait bien le duché.
– Et surtout Le Guildo ! Ce castel est une merveille, Tangui. C’est là que je veux habiter désormais. J’adore cet endroit, s’enthousiasma Gilles. Au bord de l’eau, face aux côtes anglaises, tout près de Saint-Brieuc, et de Saint Malo par la mer. Nous pourrons naviguer, chasser, nous amuser.
– Ne t’emballe pas si vite, Gilles.
– Mais si, mais si, rétorqua Gilles qui ne voulait pas laisser souffler sur son rêve. Et puis il y a aussi d’autres propriétés au sud, l’importante baronnie de Châteaubriant, celle de Vioreau, et la châtellenie des Huguetières à l’est du lac de Grandlieu. Elle a hérité d’une partie des biens du connétable Olivier de Clisson, et de la famille de Beaumanoir, en plus de celle des Dinan. C’est un parti magnifique, Tangui, juste à ma mesure.
– Huit ans, mon frère. Tu ne vas tout de même pas coucher avec une petite fille, il te faut plus que ça, je le sais trop bien…
– Oui, eh bien, nous avons suffisamment de femmes autour de nous pour attendre et calmer ma faim…et la tienne, s’esclaffa Gilles de très bonne humeur depuis qu’il voyait son but approcher. J’aurai ainsi une épouse, sans avoir les inconvénients du mariage !
– Tu es immoral, Gilles!
– Absolument. J’en conviens.
– Te absolvo, ricana Tangui.
– Merci, grand frère. Nous allons avoir de bons jours ensemble maintenant. Fini l’esclavage de mon cher aîné, fini ses remontrances, ses remarques, ses leçons et ses grands airs de duc. Il n’a cessé de m’humilier durant notre enfance. Et depuis la mort de nos parents, c’est bien pire. Cette fois, je vais être riche, et il devra compter avec moi !
– Cette rivalité avec François te perdra, Gilles. Vous vous heurtez dès que vous êtes face à face. N’oublie pas qu’il est maintenant le duc et qu’il voit d’un très mauvais œil ton amitié avec le roi anglais. Henri te verse une rente de deux mille nobles2, presque aussi conséquente que les six mille livres allouées par ton père, et cela ne lui plaît pas du tout.
Gilles haussa les épaules.
– Eh bien, il faudra qu’il s’en accommode. Ou alors qu’il me dote plus richement lui-même. Allez, viens. Demain matin nous nous présenterons chez la dame de Dinan-Montafilant et il faudra être persuasif. Mais je crois qu’elle acceptera ma proposition car je lui ai déjà envoyé un émissaire pour tâter le terrain en lui promettant une compensation financière. Pour l’heure, allons au monastère. Il y a bien un moine qui acceptera de nous marier sans délai. Il faut que tout soit consommé très vite. Il y a trop de prétendants aux trousses de cette jeune personne, mon frère !
© copyright Colette Geslin
retour début page Extraits
retour début page Extraits
Extrait :"La nuit de Clisson", 2009

Montfort hurla et se réveilla sous les coups frappés à sa porte.
– Monseigneur ! Une ambassade de seigneurs vous attend.
– Quoi ? Que me veulent-ils ? ronchonna-t-il enfin d’une voix enrouée et mal assurée.
Puis il se rappela ce qu’il avait ordonné la veille au capitaine de l’Hermine. Le meurtre avait dû venir aux oreilles de seigneurs de Vannes et des alentours, et on venait lui demander des comptes.
Il verdit, son estomac se souleva et il vomit à même le sol, à gros hoquets douloureux. Il attendit un long moment que le spasme s’apaise et se releva sur les genoux avec difficulté, le visage juste à hauteur du crucifix suspendu au mur près de son lit.
« Dieu tout Puissant ! Qu’ai-je fait ? »
– Je ne veux voir personne aujourd’hui ! Qu’on aille quérir d’urgence Jehan de Bazvalan, articula-t-il la bouche pâteuse.
– Il vous attend aussi, dans la salle des gardes, monseigneur.
– Alors, appelle mon valet pour m’habiller. Et fais entrer Bazvalan ensuite.
Bazvalan vit tout de suite que le duc n’avait pas dormi, ou bien peu. De larges cernes bleuâtres sous les yeux le cerclaient comme un hibou, une mauvaise teinte verdâtre de peau le rendait soudain hideux, son regard était égaré, incertain, il ne parvenait pas à se fixer, tout comme sa parole embarrassée. Il suait de peur et de remords, et le capitaine, sans pouvoir s’en empêcher, s’en réjouit intérieurement. Après avoir tenté de faire de lui un assassin, le duc pouvait souffrir mille morts, cela lui était bien égal dans l’instant.
Une âcre odeur de vomi stagnait dans la chambre, et Bazvalan, plissant du nez, ne s’approcha pas mais resta près de la porte. Le duc avait dû être malade en s’apercevant, une fois sa colère passée, des conséquences dramatiques que son ordre allait générer. Il ouvrit la bouche pour le rassurer, puis s’arrêta derechef, une idée folle en tête. Pourquoi ne pas continuer à le faire souffrir jusqu’à ce qu’il se repente sincèrement ? N’avait-il pas voulu charger sa conscience d’un acte irréparable, lui mettre un boulet insupportable aux pieds, et ruiner sa vie en l’empêchant lui-même de dormir à jamais avec ce sang sur les mains ?
Alors il choisit de le laisser encore toute une journée expier son intention de crime. Ce ne serait pas trop cher payer tous les tracas à venir, dont il se doutait bien qu’ils étaient loin d’être résolus.
– Alors, capitaine…qu’avez-vous…fait ? murmura enfin Montfort.
– Ce que vous m’avez ordonné hier, monseigneur ! répliqua-t-il fermement.
– Ce que…Tout ce que j’ai ordonné, voulez-vous dire ? souffla le duc, les yeux hors de la tête.
– Tout ! assura encore Bazvalan sans frémir.
– Las ! Las ! Pourquoi donc ne vous ai-je point écouté ? Vous, Laval, Rohan…et même Beaumanoir que j’ai salement blessé. Mais il m’avait cherché, ajouta-t-il non sans mauvaise foi. Pourquoi n’ai-je pu oublier cette haine qui me ronge ? Me voici damné maintenant, continua-t-il en arpentant la pièce et en marmonnant tout bas. Damné, Bazvalan ! Il n’y aura plus de repos pour moi…et ma tombe sera aussi hantée que celle de Clisson ! Partez, capitaine, votre vue m’horrifie ! Sortez, vous dis-je !
Bazvalan se recula, salua sans que le duc puisse voir l’expression de son visage, et il s’en alla à la recherche de Guy de Laval et d’Alain de Rohan. Il n’eut pas à aller bien loin ! Alors qu’il reprenait son cheval dans la cour, une épée lui fut plantée dans les reins, une autre sous la gorge.
– Votre vie contre celle de Clisson, Bazvalan.
– Mes seigneurs, je vous en prie, fit Jehan d’une voix hachée. Le connétable…n’est pas mort !
Il vit les yeux furieux de Rohan tout près des siens.
– Te moques-tu de nous maintenant, capitaine ?
– Je vous assure que messire de Clisson est parfaitement en sécurité sous ma garde. Le duc, lui, est par contre plein de remords, et il gémit à fendre l’âme, car je lui ai laissé croire que j’ai bien rempli ma mission.
La pression des épées se relâcha quelque peu.
– Ne restons pas ici, messires. Il n’est pas bon que l’on nous voit ensemble aujourd’hui. Suivez-moi plutôt jusqu’à l’Hermine, et je vous ferai rencontrer le connétable.
Bazvalan avait transféré Clisson dans une des pièces meublées du château où il avait maintenant un vrai lit, une table et des sièges confortables, et Alain put s’entretenir brièvement avec son beau-père tandis que Laval faisait le guet.
– Laisse-le mijoter dans ses remords toute la journée, décida Olivier. Et va le harceler dès que Bazvalan lui aura révélé que je ne suis pas mort. Je sais comment fonctionne Montfort, Alain. Je le connais depuis qu’il est enfant et il n’a cessé de me jouer des tours pendables. Il va se lamenter, se flageller, en appeler à Dieu et à tous ses saints ! Puis lorsque Bazvalan lui dira que je suis en vie, sa conscience va être soulagée…pour un temps ! Mais ensuite, ne crois pas qu’il va me relâcher pour autant ! Je suis persuadé que c’est à moi qu’il va en vouloir de sa lâcheté, comme toujours. Il va se décharger de sa culpabilité et me faire payer très cher ma liberté, crois-moi. En attendant, occupez-vous de Robert. Faites-le soigner, je vous en prie. Je ne me pardonnerai pas si sa plaie devait s’envenimer !
– Sois rassuré, Olivier. Bazvalan a fait venir son médecin. Robert s’en sortira avec une grande balafre, et demain j’achèterai sa liberté au duc, lorsqu’il voudra bien m’écouter… avant de m’occuper de la tienne !
– Puisse Dieu nous aider ! avait soupiré Clisson. Mais je dois la vie à Jehan de Bazvalan et ma dette envers lui ne s’éteindra qu’avec moi.
*
Montfort passa la pire journée de sa vie. Il avait fait fermer les portes de la Motte, éloigné seigneurs et courtisans, annulé toutes ses audiences, pour errer dans les corridors en marmonnant tout bas des injures ou des regrets, des menaces ou des plaintes. Il ne pouvait se résoudre à prendre un parti. Rester, avouer et affronter l’ire des seigneurs bretons ? Convoquer l’armée pour faire face à celle que le roi Charles n’allait pas manquer d’envoyer pour venger la mort de Clisson ? Ou s’enfuir en Angleterre par le premier navire ?
Il supputait jusqu’au délire toutes les implications qui allaient en découler lorsque la Bretagne tout entière et le royaume de Charles allaient apprendre dans quelles conditions il avait fait arrêter et tuer le connétable. Clisson était un grand seigneur, qui avait ses entrées partout, et il avait tant d’intérêts dans toutes les provinces, tant de négoces et de possessions, tant de débiteurs et jusqu’au Pape lui-même, que l’horreur de son assassinat allait retentir sur lui et sur la Bretagne et les écraser.
Il voulait voir Jeanne, il appelait le secours de son épouse de tous ses vœux, mais il ne pouvait pas lui parler de ce qu’il avait ordonné. Elle le regarderait alors avec horreur et s’en écarterait à jamais. Il tenta pourtant par deux fois d’aller la rejoindre, puis il fit demi-tour au bout du corridor en constatant qu’il était gardé par les gens qui l’avaient accompagnée de sa Navarre natale et qui ne la quittaient guère.
« Juana », gémit-il, en lui donnant ce nom qu’il prononçait avec délices lorsqu’il lui faisait l’amour. Il avait une résonnance si exotique, si chaude et si sensuelle, que cela le faisait défaillir à cet instant-même où il se tordait de douleurs intérieures que rien ne venait apaiser. Il en voulait maintenant à Bazvalan d’avoir obéi si promptement à son ordre, et à Olivier de l’avoir mis dans une telle situation, en oubliant avec cette parfaite mauvaise foi qui le caractérisait souvent, qu’il était seul à l’origine de ce drame.
Vers le soir il n’en pouvait plus de se morfondre dans les affres de l’angoisse et il sursauta lorsqu’on lui annonça que le capitaine de Bazvalan demandait à le voir.
« Veut-il encore m’accabler de mauvaises nouvelles ? ».
Lorsqu’il entra dans le cabinet de travail où le duc tournait en rond, incapable de fixer son esprit sur les affaires qui attendaient sa signature et sa décision, Bazvalan vit que la punition avait fait son effet et que ses ravages étaient à la hauteur de ses espérances.
– Monseigneur, est-ce la mort du connétable de Clisson qui vous afflige tant ?
– Bazvalan, vous ne savez pas combien je regrette cet ordre qui m’a tourmenté toute la nuit et tout le jour. Et pourtant je le hais tellement que je devrais être délivré !
– Il y a un remède à votre angoisse, monseigneur !
– Je n’en vois point à la mort !
– Il n’y en a point en effet. Mais le connétable n’est pas mort. Il m’a été impossible d’exécuter un tel ordre donné sous le coup de votre colère. Messire de Clisson est toujours au château de l’Hermine. Bien vivant.
Le duc ouvrit des yeux ahuris, puis la joie succéda à la peur et il sentit tous ses muscles se relâcher sous le coup du soulagement qui venait mettre un terme à ses frayeurs.
– Capitaine ! Vous êtes un honnête homme, sur ma foi. Venez céans que je vous récompense.
Il sortit de la pièce en courant, appela son trésorier et lui ordonna de compter sur le champ dix mille florins d’or au capitaine de Bazvalan qui en profita pour pousser son avantage et lui demander de recevoir Guy de Laval afin de discuter de la libération de Clisson.
– Monseigneur ! Une ambassade de seigneurs vous attend.
– Quoi ? Que me veulent-ils ? ronchonna-t-il enfin d’une voix enrouée et mal assurée.
Puis il se rappela ce qu’il avait ordonné la veille au capitaine de l’Hermine. Le meurtre avait dû venir aux oreilles de seigneurs de Vannes et des alentours, et on venait lui demander des comptes.
Il verdit, son estomac se souleva et il vomit à même le sol, à gros hoquets douloureux. Il attendit un long moment que le spasme s’apaise et se releva sur les genoux avec difficulté, le visage juste à hauteur du crucifix suspendu au mur près de son lit.
« Dieu tout Puissant ! Qu’ai-je fait ? »
– Je ne veux voir personne aujourd’hui ! Qu’on aille quérir d’urgence Jehan de Bazvalan, articula-t-il la bouche pâteuse.
– Il vous attend aussi, dans la salle des gardes, monseigneur.
– Alors, appelle mon valet pour m’habiller. Et fais entrer Bazvalan ensuite.
Bazvalan vit tout de suite que le duc n’avait pas dormi, ou bien peu. De larges cernes bleuâtres sous les yeux le cerclaient comme un hibou, une mauvaise teinte verdâtre de peau le rendait soudain hideux, son regard était égaré, incertain, il ne parvenait pas à se fixer, tout comme sa parole embarrassée. Il suait de peur et de remords, et le capitaine, sans pouvoir s’en empêcher, s’en réjouit intérieurement. Après avoir tenté de faire de lui un assassin, le duc pouvait souffrir mille morts, cela lui était bien égal dans l’instant.
Une âcre odeur de vomi stagnait dans la chambre, et Bazvalan, plissant du nez, ne s’approcha pas mais resta près de la porte. Le duc avait dû être malade en s’apercevant, une fois sa colère passée, des conséquences dramatiques que son ordre allait générer. Il ouvrit la bouche pour le rassurer, puis s’arrêta derechef, une idée folle en tête. Pourquoi ne pas continuer à le faire souffrir jusqu’à ce qu’il se repente sincèrement ? N’avait-il pas voulu charger sa conscience d’un acte irréparable, lui mettre un boulet insupportable aux pieds, et ruiner sa vie en l’empêchant lui-même de dormir à jamais avec ce sang sur les mains ?
Alors il choisit de le laisser encore toute une journée expier son intention de crime. Ce ne serait pas trop cher payer tous les tracas à venir, dont il se doutait bien qu’ils étaient loin d’être résolus.
– Alors, capitaine…qu’avez-vous…fait ? murmura enfin Montfort.
– Ce que vous m’avez ordonné hier, monseigneur ! répliqua-t-il fermement.
– Ce que…Tout ce que j’ai ordonné, voulez-vous dire ? souffla le duc, les yeux hors de la tête.
– Tout ! assura encore Bazvalan sans frémir.
– Las ! Las ! Pourquoi donc ne vous ai-je point écouté ? Vous, Laval, Rohan…et même Beaumanoir que j’ai salement blessé. Mais il m’avait cherché, ajouta-t-il non sans mauvaise foi. Pourquoi n’ai-je pu oublier cette haine qui me ronge ? Me voici damné maintenant, continua-t-il en arpentant la pièce et en marmonnant tout bas. Damné, Bazvalan ! Il n’y aura plus de repos pour moi…et ma tombe sera aussi hantée que celle de Clisson ! Partez, capitaine, votre vue m’horrifie ! Sortez, vous dis-je !
Bazvalan se recula, salua sans que le duc puisse voir l’expression de son visage, et il s’en alla à la recherche de Guy de Laval et d’Alain de Rohan. Il n’eut pas à aller bien loin ! Alors qu’il reprenait son cheval dans la cour, une épée lui fut plantée dans les reins, une autre sous la gorge.
– Votre vie contre celle de Clisson, Bazvalan.
– Mes seigneurs, je vous en prie, fit Jehan d’une voix hachée. Le connétable…n’est pas mort !
Il vit les yeux furieux de Rohan tout près des siens.
– Te moques-tu de nous maintenant, capitaine ?
– Je vous assure que messire de Clisson est parfaitement en sécurité sous ma garde. Le duc, lui, est par contre plein de remords, et il gémit à fendre l’âme, car je lui ai laissé croire que j’ai bien rempli ma mission.
La pression des épées se relâcha quelque peu.
– Ne restons pas ici, messires. Il n’est pas bon que l’on nous voit ensemble aujourd’hui. Suivez-moi plutôt jusqu’à l’Hermine, et je vous ferai rencontrer le connétable.
Bazvalan avait transféré Clisson dans une des pièces meublées du château où il avait maintenant un vrai lit, une table et des sièges confortables, et Alain put s’entretenir brièvement avec son beau-père tandis que Laval faisait le guet.
– Laisse-le mijoter dans ses remords toute la journée, décida Olivier. Et va le harceler dès que Bazvalan lui aura révélé que je ne suis pas mort. Je sais comment fonctionne Montfort, Alain. Je le connais depuis qu’il est enfant et il n’a cessé de me jouer des tours pendables. Il va se lamenter, se flageller, en appeler à Dieu et à tous ses saints ! Puis lorsque Bazvalan lui dira que je suis en vie, sa conscience va être soulagée…pour un temps ! Mais ensuite, ne crois pas qu’il va me relâcher pour autant ! Je suis persuadé que c’est à moi qu’il va en vouloir de sa lâcheté, comme toujours. Il va se décharger de sa culpabilité et me faire payer très cher ma liberté, crois-moi. En attendant, occupez-vous de Robert. Faites-le soigner, je vous en prie. Je ne me pardonnerai pas si sa plaie devait s’envenimer !
– Sois rassuré, Olivier. Bazvalan a fait venir son médecin. Robert s’en sortira avec une grande balafre, et demain j’achèterai sa liberté au duc, lorsqu’il voudra bien m’écouter… avant de m’occuper de la tienne !
– Puisse Dieu nous aider ! avait soupiré Clisson. Mais je dois la vie à Jehan de Bazvalan et ma dette envers lui ne s’éteindra qu’avec moi.
*
Montfort passa la pire journée de sa vie. Il avait fait fermer les portes de la Motte, éloigné seigneurs et courtisans, annulé toutes ses audiences, pour errer dans les corridors en marmonnant tout bas des injures ou des regrets, des menaces ou des plaintes. Il ne pouvait se résoudre à prendre un parti. Rester, avouer et affronter l’ire des seigneurs bretons ? Convoquer l’armée pour faire face à celle que le roi Charles n’allait pas manquer d’envoyer pour venger la mort de Clisson ? Ou s’enfuir en Angleterre par le premier navire ?
Il supputait jusqu’au délire toutes les implications qui allaient en découler lorsque la Bretagne tout entière et le royaume de Charles allaient apprendre dans quelles conditions il avait fait arrêter et tuer le connétable. Clisson était un grand seigneur, qui avait ses entrées partout, et il avait tant d’intérêts dans toutes les provinces, tant de négoces et de possessions, tant de débiteurs et jusqu’au Pape lui-même, que l’horreur de son assassinat allait retentir sur lui et sur la Bretagne et les écraser.
Il voulait voir Jeanne, il appelait le secours de son épouse de tous ses vœux, mais il ne pouvait pas lui parler de ce qu’il avait ordonné. Elle le regarderait alors avec horreur et s’en écarterait à jamais. Il tenta pourtant par deux fois d’aller la rejoindre, puis il fit demi-tour au bout du corridor en constatant qu’il était gardé par les gens qui l’avaient accompagnée de sa Navarre natale et qui ne la quittaient guère.
« Juana », gémit-il, en lui donnant ce nom qu’il prononçait avec délices lorsqu’il lui faisait l’amour. Il avait une résonnance si exotique, si chaude et si sensuelle, que cela le faisait défaillir à cet instant-même où il se tordait de douleurs intérieures que rien ne venait apaiser. Il en voulait maintenant à Bazvalan d’avoir obéi si promptement à son ordre, et à Olivier de l’avoir mis dans une telle situation, en oubliant avec cette parfaite mauvaise foi qui le caractérisait souvent, qu’il était seul à l’origine de ce drame.
Vers le soir il n’en pouvait plus de se morfondre dans les affres de l’angoisse et il sursauta lorsqu’on lui annonça que le capitaine de Bazvalan demandait à le voir.
« Veut-il encore m’accabler de mauvaises nouvelles ? ».
Lorsqu’il entra dans le cabinet de travail où le duc tournait en rond, incapable de fixer son esprit sur les affaires qui attendaient sa signature et sa décision, Bazvalan vit que la punition avait fait son effet et que ses ravages étaient à la hauteur de ses espérances.
– Monseigneur, est-ce la mort du connétable de Clisson qui vous afflige tant ?
– Bazvalan, vous ne savez pas combien je regrette cet ordre qui m’a tourmenté toute la nuit et tout le jour. Et pourtant je le hais tellement que je devrais être délivré !
– Il y a un remède à votre angoisse, monseigneur !
– Je n’en vois point à la mort !
– Il n’y en a point en effet. Mais le connétable n’est pas mort. Il m’a été impossible d’exécuter un tel ordre donné sous le coup de votre colère. Messire de Clisson est toujours au château de l’Hermine. Bien vivant.
Le duc ouvrit des yeux ahuris, puis la joie succéda à la peur et il sentit tous ses muscles se relâcher sous le coup du soulagement qui venait mettre un terme à ses frayeurs.
– Capitaine ! Vous êtes un honnête homme, sur ma foi. Venez céans que je vous récompense.
Il sortit de la pièce en courant, appela son trésorier et lui ordonna de compter sur le champ dix mille florins d’or au capitaine de Bazvalan qui en profita pour pousser son avantage et lui demander de recevoir Guy de Laval afin de discuter de la libération de Clisson.
Extrait : "Merlin: la prophétie des elfes"
extrait paru dans "Histoire et Images Médiévales", n° 19, avril-mai 2008
www.histoire-images-medievales.com
Extrait :"Arthur et les elfes d'Avalon", 2008
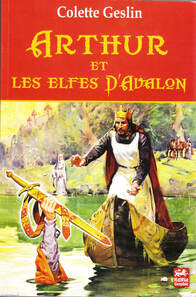
– Maître ? Seigneur Marzin, vous devriez venir là-haut. L’architecte du roi vous réclame à cor et à cri.
Math, essoufflé et hors d’haleine, venait de surgir dans le camp où Uther discutait depuis le petit jour avec Gilloman qu’il avait installé dans sa propre tente pour la nuit, de crainte sans doute que l’Hybernien ne cherche à lui fausser compagnie, ce qui l’aurait obligé à le tuer. Le jeune roi lui tenait tête, plus qu’il ne l’aurait pensé, et cela avait l’air de l’amuser. Uther lâchait quelque chose, reprenait, échangeait, le ramenait à lui comme un pêcheur remonte son poisson en le fatiguant au bout de sa ligne, et Gilloman se battait bien, même s’il savait qu’en fin de compte il devrait céder.
Ils m’exaspéraient avec leurs discussions et je m’étais isolé avec Taliésin près d’un feu de camp pour savourer ma tisane d’herbes en paix lorsque Math me retrouva.
– J’ai compris, Math. Ils n’y arrivent pas, fis-je en soupirant sur le calme du petit matin qui venait de voler en éclats.
– Euh…non. Vous le saviez, n’est-ce-pas ?
J’échangeai un regard avec Taliésin qui sourit en coin. « On ne sait jamais avec les humains. Parfois ils sont capables de grandes choses…parfois du pire. »
Math me considéra un instant, pensif. « Je ne comprends pas toujours ce que vous voulez dire, mon seigneur »
– Ça ne fait rien, Math, ça ne fait rien. Tu n’es pas le seul.
Kadeg, l’architecte d’Uther, un grand type maigre et pourtant d’habitude flegmatique, semblait presque désespéré. « Il n’y a rien à faire, seigneur, rien du tout. Cette fichue pierre ne veut pas bouger d’un pouce. J’y ai mis tous mes hommes, tous les chevaux. Et rien, rien ! Je vais perdre la face et tout crédit auprès du roi ! »
– Est-ce que c’est la force qui doit l’emporter sur l’esprit…ou le contraire, Kadeg ? demandai-je seulement en considérant les engins mis en place pour soulever la masse, les cordes brisées, les chevaux attelés à de lourdes chaînes, les chariots démantelés et les hommes affalés par terre, accablés et luisants de sueur et de poussière.
– Seigneur Marzin, vous seul pouvez décider cette pierre à vous suivre, conclut Kadeg, bien qu’il dût lui en coûter de m’avouer ainsi son échec, et de commencer à entrevoir ce qu’il pouvait y avoir entre la pierre et moi. « Ce n’est pas une simple pierre, n’est-ce-pas ? ».
Il était plus perspicace que je ne l’aurais cru et je me mis à rire de bon cœur. « En effet. Ce n’est pas n’importe quelle pierre, Kadeg. Elle a un rôle important à jouer et je vais devoir lui parler. Allez donc prendre du repos. Tous. Laissez-moi seul avec elle et nous recommencerons plus tard. »
Il me considéra un instant comme si j’avais perdu la raison. Parler avec une pierre ? Puis, sans doute se rappelant qui j’étais, il tourna les talons en hélant ses hommes derrière lui. Les chevaux redescendirent la colline dans un bruit de sabots, le pas des hommes décrût, leurs voix s’évanouirent, Taliésin lui-même s’écarta hors de ma vue, et le silence reprit ses droits, me laissant en tête à tête avec l’esprit des Tuatha emprisonné dans la pierre.
Je m’assis près d’elle, à même le sol pour attendre la visite que j’espérais. Ce furent quelques frôlements furtifs, discrets, qui me firent comprendre, longtemps après, que je n’étais plus seul, puis un bruit d’ailes déplaça l’air au-dessus de moi et la chouette beige et blanche vint se poser droit sur la surface plane de la pierre, qui la laissa faire.
Alors, grand-père, on recommence comme au Plessis Caer ?
Tu as meilleure mine que la dernière fois, renchérit le grand loup gris qui se rapprocha à me toucher.
– As-tu renoncé à tout jamais à ta forme humaine, Bleize ? marmonnai-je.
C’est plus pratique pour voyager vite. Et, apparemment, tu avais besoin de nous ce matin, n’est-ce-pas ?
– C’est vrai. Alors, on la déplace cette pierre magique ?
Si les Tuatha le veulent, c’est leur affaire, rétorqua Bleize. Et la tienne. Mais cela va faire du bruit.
– Il nous suffira de la conduire en bas de la colline et les hommes la traîneront ensuite jusqu’à un des bateaux. Je leur dirai comment construire les engins qu’il faut.
Si tu restes devant elle, grand-père, elle te suivra, assura la chouette, qui était aussi ma petite-fille elfe.
Alors je fis signe à Taliésin de nous rejoindre, car son fluide allait grandement nous aider. La pierre commença à remuer doucement lorsque nous eûmes unis nos esprits au sien, elle bascula un peu, comme si la terre se creusait pour lui permettre de glisser, et elle s’engagea sur la pente herbeuse, portée par son poids. Lorsque nous relâchâmes nos efforts, elle s’immobilisa, dressée au pied de la colline de telle façon que des cordes, des chaînes et des troncs d’arbres pourraient la rouler assez facilement jusqu’à l’embarcadère.
Ganiéda vint alors se poser sur mon épaule, son bec tout contre ma joue, ses yeux d’ambre plongés dans les miens. « Lorsque tu auras mis la pierre sur le tombeau de mon époux, Marzin, il te faudra aller voir Arthur. C’est la prochaine tâche que tu dois accomplir. Il est temps de le préparer. »
– M’accompagneras-tu, Bleize ? demandai-je au grand loup. L’enfant aura bien besoin d’un maître.
Cela risque d’être intéressant. J’y serai avant toi !
– Comment avez-vous réussi cela, seigneur Marzin ? Vous ne pouvez pas l’avoir bougée tout seul. Aucun homme ne le pourrait ! gémit Kadeg en faisant le tour de l’énorme pierre enracinée fermement dans l’herbe.
– Mais le seigneur Marzin est-il vraiment un homme, Kadeg ? intervint Uther arrivé dans notre dos avec Gilloman qui ouvrait des yeux épouvantés.
Je lui lançai un regard noir d’avertissement et Uther se renfrogna. « Kadeg, je te laisse avec Marzin pour l’embarquer sur un bateau. Moi je vais reconduire le seigneur Gilloman chez lui afin que ses hommes sachent que nous sommes désormais des alliés. Nous rejoindras-tu là-bas, Marzin ? »
– Non, Uther. Je reviendrai avec le bateau et la pierre plus tard, j’ai encore une chose à faire. Nous nous retrouverons à Ambrius.
Qu’est-ce qui porta mes pas jusque dans l’ancienne manse de la famille de ma mère ? Il ne restait plus personne, rien que des ruines et des talus herbeux, là où s’était dressées autrefois une habitation, des granges, des écuries, rien que le vent qui soufflait tout autour, lugubrement.
Et pourtant, quelque chose ou quelqu’un m’attendait là, je le savais bien, car jamais on ne m’envoyait dans un endroit sans raison.
Ce fut une enfant, ou ce qui y ressemblait, peut-être de l’âge de Math, qui sortit soudain d’un trou creusé dans le talus, juste au bord de l’étang. Elle était en haillons, défigurée par une vilaine balafre et c’est peut-être ce qui attira l’attention et la compassion de Math qui la vit le premier. Elle nous regardait sans rien dire alors qu’elle aurait dû avoir peur et fuir et, maigre jusqu’à voir ses os saillir sous les lambeaux de peaux qui la vêtaient, elle semblait égarée dans ce monde, surgie des entrailles de la terre et des eaux pour un voyage au pays des humains.
Elle faillit mordre Math lorsqu’il se pencha et tendit la main vers elle, cracha comme un chat en colère, puis se détourna. Math, désemparé, me regarda descendre de cheval et m’approcher d’elle à mon tour. Je savais déjà qui elle était… je le savais au plus profond de moi… le fantôme de la dernière descendante de ma famille maternelle que je n’avais jamais connue. Je ne cherchai pas à la toucher, ni à l’attirer vers moi, au contraire, je m’assis à même le talus et commençai à parler sans m’adresser à elle particulièrement, avec ce langage sonore et chantant des elfes qui la figea sur place en reconnaissant les sons. Ma mère avait été une banfaith, avec ce don pour voir au-delà du réel, qui se transmettait par les femmes, et cette enfant, si c’en était une, en avait hérité à son tour. C’est sans doute ce qui lui avait permis de survivre à la mort, aux massacres, au départ de tous ses proches. Que faisait-elle dans cette solitude et comment parvenait-elle à vivre sans une présence ? A moins qu’elle ne fut tout autre chose, envoyée du peuple des elfes dans un dessein qui ne tarderait pas à se révéler.
Elle m’écouta longtemps, hochant la tête parfois comme si elle comprenait le sens de ce que je disais, et Math nous regardait l’un et l’autre, stupéfait, en se grattant la tête. Puis il alla vers nos sacoches de toile pendues aux flancs des chevaux pour en retirer des galettes un peu friables qu’il posa prudemment sur une pierre, échaudé par son premier contact. La petite créature considéra un instant ce qu’il venait de lui apporter puis, comme si elle avait déjà mangé à satiété quelques instants auparavant, alors que, bien sûr, il n’en était rien, elle les prit posément une à une et les dégusta sans nous quitter des yeux. Math sourit, satisfait.
– Que faisons-nous, seigneur Marzin ? Nous ne pouvons pas la laisser là.
Et encore ne savait-il pas qui elle était, un avatar de ma propre famille.
– Bien sûr que non, Math. Elle va nous suivre.
– Je pourrais la prendre devant moi sur le poney.
– N’en crois rien. Elle essaierait encore de te mordre, ris-je doucement. Laisse-la décider elle-même. Nous irons au pas.
Et, en effet, elle nous suivit sans rien dire tandis que je retenais les chevaux pour ne pas la distancer. Je savais qu’il faudrait quelque temps pour la mettre en confiance, et nous retournâmes ainsi jusqu’à la côte où nos bateaux attendaient toujours. Uther n’était pas encore revenu avec ses guerriers, et je décidai d’embarquer sans lui afin de faire escale en Dyfed chez mon frère. Mais la pierre n’avait pas bougé de l’endroit où elle se trouvait, et Kadeg assis à côté d’elle, m’attendait patiemment.
– Alors Kadeg, la pierre n’a pas voulu te suivre ?
– Seigneur Marzin, ne plaisantez pas avec ça ! C’est assez humiliant et angoissant comme ça. Devoir attendre le bon plaisir d’une pierre…et demander votre aide !
– Alors rappelle tes ouvriers. Relevez ces cordes et ces chaînes. Je vais me mettre devant elle et elle me suivra.
– Ce n’est pas un animal, tout de même, marmonna-t-il désemparé.
– Non, mais elle est vivante, en dépit de ce que tu crois. Ne cherche pas à comprendre et hâtons-nous, car je veux repartir au plus vite.
Je tins ma jument elfique par la bride et fis comme je l’avais dit, sous les yeux ébahis des hommes venus se mettre en place pour la hâler. Ma main posée sur elle, la pierre se laissa soulever et transporter jusque sur le pont du navire. Math, resté auprès de la petite fille, s’écarta soudain car elle s’était mise à rire. Ce n’était pas un rire de démente comme on aurait pu s’y attendre à la voir ainsi absente d’elle-même, juste le rire joyeux et malicieux d’une enfant ou d’une elfe, et il soupira de soulagement. Elle nous accompagna sur le bateau, toujours sans rien dire, sans s’étonner de rien, s’assit près de la pierre, posa sa tête sur ses bras et s’endormit d’un seul coup.
Le navire appareilla et je dus m’endormir aussi près d’elle et de la pierre. Ce fut le cri étouffé de Math qui me sortit de ma torpeur et Taliésin se redressa lui aussi, en ramenant les bords de sa cape car le vent s’était levé. Math tremblait de tous ses membres, accroupi au sol, comme un chat prêt à sauter sur sa proie. « Elle…elle…elle disparaît ! »
Il articulait avec peine, tendait la main vers l’enfant qui dormait à mon côté l’instant auparavant et je tournai la tête vers elle, mal réveillé moi-même. La jeune banfaith n’était plus qu’un pâle reflet sous la lune qui se levait et éclairait le pont de lueurs étranges et blafardes, comme un voile qui s’affadissait rapidement et qui se fondait, peu à peu, dans la pierre qui l’avalait.
Math haletait, en proie à la terreur et Taliésin le prit contre lui pour le calmer. La forme éthérée qui subsistait encore ressemblait maintenant à de la fumée, s’étirait, de plus en plus mince, et s’infiltrait peu à peu dans la pierre bleue.
– Elle…elle n’était pas vraie, n’est-ce pas ? parvint-il à articuler en claquant des dents.
– Non, en effet, soupirai-je. Et je suis même étonné que tu aies pu la voir. C’était juste une projection de mon passé avec mon avenir. Taliésin ?
– Je l’ai vue aussi, admit-il en fronçant les sourcils. Mais nous devons bien être les seuls, Kadeg et les marins n’ont rien remarqué, j’en suis certain. C’était un esprit ?
– Oui, envoyé par les Tuatha… et qui est retourné dans la pierre. Je ne sais pas pourquoi elle a surgi à cet endroit où habitait ma famille. C’est un esprit des eaux, une dame du lac, sans aucun doute. Elle resurgira un jour, ailleurs, sous une autre forme peut-être.
– N’était-elle pas une émanation de tes pensées, parce que tu aurais voulu, de toutes tes forces, retrouver quelqu’un de la famille de ta mère ?
– C’est probable, Taliésin. Mais ils sont bien morts, tous. Il n’y a plus rien ! Et je n’ai plus rien !
– Mais non, Marzin, il y a encore Owen qui te considère comme son frère. Et il y a Arthur. Il sera pour toi un autre fils et un roi.
Math, essoufflé et hors d’haleine, venait de surgir dans le camp où Uther discutait depuis le petit jour avec Gilloman qu’il avait installé dans sa propre tente pour la nuit, de crainte sans doute que l’Hybernien ne cherche à lui fausser compagnie, ce qui l’aurait obligé à le tuer. Le jeune roi lui tenait tête, plus qu’il ne l’aurait pensé, et cela avait l’air de l’amuser. Uther lâchait quelque chose, reprenait, échangeait, le ramenait à lui comme un pêcheur remonte son poisson en le fatiguant au bout de sa ligne, et Gilloman se battait bien, même s’il savait qu’en fin de compte il devrait céder.
Ils m’exaspéraient avec leurs discussions et je m’étais isolé avec Taliésin près d’un feu de camp pour savourer ma tisane d’herbes en paix lorsque Math me retrouva.
– J’ai compris, Math. Ils n’y arrivent pas, fis-je en soupirant sur le calme du petit matin qui venait de voler en éclats.
– Euh…non. Vous le saviez, n’est-ce-pas ?
J’échangeai un regard avec Taliésin qui sourit en coin. « On ne sait jamais avec les humains. Parfois ils sont capables de grandes choses…parfois du pire. »
Math me considéra un instant, pensif. « Je ne comprends pas toujours ce que vous voulez dire, mon seigneur »
– Ça ne fait rien, Math, ça ne fait rien. Tu n’es pas le seul.
Kadeg, l’architecte d’Uther, un grand type maigre et pourtant d’habitude flegmatique, semblait presque désespéré. « Il n’y a rien à faire, seigneur, rien du tout. Cette fichue pierre ne veut pas bouger d’un pouce. J’y ai mis tous mes hommes, tous les chevaux. Et rien, rien ! Je vais perdre la face et tout crédit auprès du roi ! »
– Est-ce que c’est la force qui doit l’emporter sur l’esprit…ou le contraire, Kadeg ? demandai-je seulement en considérant les engins mis en place pour soulever la masse, les cordes brisées, les chevaux attelés à de lourdes chaînes, les chariots démantelés et les hommes affalés par terre, accablés et luisants de sueur et de poussière.
– Seigneur Marzin, vous seul pouvez décider cette pierre à vous suivre, conclut Kadeg, bien qu’il dût lui en coûter de m’avouer ainsi son échec, et de commencer à entrevoir ce qu’il pouvait y avoir entre la pierre et moi. « Ce n’est pas une simple pierre, n’est-ce-pas ? ».
Il était plus perspicace que je ne l’aurais cru et je me mis à rire de bon cœur. « En effet. Ce n’est pas n’importe quelle pierre, Kadeg. Elle a un rôle important à jouer et je vais devoir lui parler. Allez donc prendre du repos. Tous. Laissez-moi seul avec elle et nous recommencerons plus tard. »
Il me considéra un instant comme si j’avais perdu la raison. Parler avec une pierre ? Puis, sans doute se rappelant qui j’étais, il tourna les talons en hélant ses hommes derrière lui. Les chevaux redescendirent la colline dans un bruit de sabots, le pas des hommes décrût, leurs voix s’évanouirent, Taliésin lui-même s’écarta hors de ma vue, et le silence reprit ses droits, me laissant en tête à tête avec l’esprit des Tuatha emprisonné dans la pierre.
Je m’assis près d’elle, à même le sol pour attendre la visite que j’espérais. Ce furent quelques frôlements furtifs, discrets, qui me firent comprendre, longtemps après, que je n’étais plus seul, puis un bruit d’ailes déplaça l’air au-dessus de moi et la chouette beige et blanche vint se poser droit sur la surface plane de la pierre, qui la laissa faire.
Alors, grand-père, on recommence comme au Plessis Caer ?
Tu as meilleure mine que la dernière fois, renchérit le grand loup gris qui se rapprocha à me toucher.
– As-tu renoncé à tout jamais à ta forme humaine, Bleize ? marmonnai-je.
C’est plus pratique pour voyager vite. Et, apparemment, tu avais besoin de nous ce matin, n’est-ce-pas ?
– C’est vrai. Alors, on la déplace cette pierre magique ?
Si les Tuatha le veulent, c’est leur affaire, rétorqua Bleize. Et la tienne. Mais cela va faire du bruit.
– Il nous suffira de la conduire en bas de la colline et les hommes la traîneront ensuite jusqu’à un des bateaux. Je leur dirai comment construire les engins qu’il faut.
Si tu restes devant elle, grand-père, elle te suivra, assura la chouette, qui était aussi ma petite-fille elfe.
Alors je fis signe à Taliésin de nous rejoindre, car son fluide allait grandement nous aider. La pierre commença à remuer doucement lorsque nous eûmes unis nos esprits au sien, elle bascula un peu, comme si la terre se creusait pour lui permettre de glisser, et elle s’engagea sur la pente herbeuse, portée par son poids. Lorsque nous relâchâmes nos efforts, elle s’immobilisa, dressée au pied de la colline de telle façon que des cordes, des chaînes et des troncs d’arbres pourraient la rouler assez facilement jusqu’à l’embarcadère.
Ganiéda vint alors se poser sur mon épaule, son bec tout contre ma joue, ses yeux d’ambre plongés dans les miens. « Lorsque tu auras mis la pierre sur le tombeau de mon époux, Marzin, il te faudra aller voir Arthur. C’est la prochaine tâche que tu dois accomplir. Il est temps de le préparer. »
– M’accompagneras-tu, Bleize ? demandai-je au grand loup. L’enfant aura bien besoin d’un maître.
Cela risque d’être intéressant. J’y serai avant toi !
– Comment avez-vous réussi cela, seigneur Marzin ? Vous ne pouvez pas l’avoir bougée tout seul. Aucun homme ne le pourrait ! gémit Kadeg en faisant le tour de l’énorme pierre enracinée fermement dans l’herbe.
– Mais le seigneur Marzin est-il vraiment un homme, Kadeg ? intervint Uther arrivé dans notre dos avec Gilloman qui ouvrait des yeux épouvantés.
Je lui lançai un regard noir d’avertissement et Uther se renfrogna. « Kadeg, je te laisse avec Marzin pour l’embarquer sur un bateau. Moi je vais reconduire le seigneur Gilloman chez lui afin que ses hommes sachent que nous sommes désormais des alliés. Nous rejoindras-tu là-bas, Marzin ? »
– Non, Uther. Je reviendrai avec le bateau et la pierre plus tard, j’ai encore une chose à faire. Nous nous retrouverons à Ambrius.
Qu’est-ce qui porta mes pas jusque dans l’ancienne manse de la famille de ma mère ? Il ne restait plus personne, rien que des ruines et des talus herbeux, là où s’était dressées autrefois une habitation, des granges, des écuries, rien que le vent qui soufflait tout autour, lugubrement.
Et pourtant, quelque chose ou quelqu’un m’attendait là, je le savais bien, car jamais on ne m’envoyait dans un endroit sans raison.
Ce fut une enfant, ou ce qui y ressemblait, peut-être de l’âge de Math, qui sortit soudain d’un trou creusé dans le talus, juste au bord de l’étang. Elle était en haillons, défigurée par une vilaine balafre et c’est peut-être ce qui attira l’attention et la compassion de Math qui la vit le premier. Elle nous regardait sans rien dire alors qu’elle aurait dû avoir peur et fuir et, maigre jusqu’à voir ses os saillir sous les lambeaux de peaux qui la vêtaient, elle semblait égarée dans ce monde, surgie des entrailles de la terre et des eaux pour un voyage au pays des humains.
Elle faillit mordre Math lorsqu’il se pencha et tendit la main vers elle, cracha comme un chat en colère, puis se détourna. Math, désemparé, me regarda descendre de cheval et m’approcher d’elle à mon tour. Je savais déjà qui elle était… je le savais au plus profond de moi… le fantôme de la dernière descendante de ma famille maternelle que je n’avais jamais connue. Je ne cherchai pas à la toucher, ni à l’attirer vers moi, au contraire, je m’assis à même le talus et commençai à parler sans m’adresser à elle particulièrement, avec ce langage sonore et chantant des elfes qui la figea sur place en reconnaissant les sons. Ma mère avait été une banfaith, avec ce don pour voir au-delà du réel, qui se transmettait par les femmes, et cette enfant, si c’en était une, en avait hérité à son tour. C’est sans doute ce qui lui avait permis de survivre à la mort, aux massacres, au départ de tous ses proches. Que faisait-elle dans cette solitude et comment parvenait-elle à vivre sans une présence ? A moins qu’elle ne fut tout autre chose, envoyée du peuple des elfes dans un dessein qui ne tarderait pas à se révéler.
Elle m’écouta longtemps, hochant la tête parfois comme si elle comprenait le sens de ce que je disais, et Math nous regardait l’un et l’autre, stupéfait, en se grattant la tête. Puis il alla vers nos sacoches de toile pendues aux flancs des chevaux pour en retirer des galettes un peu friables qu’il posa prudemment sur une pierre, échaudé par son premier contact. La petite créature considéra un instant ce qu’il venait de lui apporter puis, comme si elle avait déjà mangé à satiété quelques instants auparavant, alors que, bien sûr, il n’en était rien, elle les prit posément une à une et les dégusta sans nous quitter des yeux. Math sourit, satisfait.
– Que faisons-nous, seigneur Marzin ? Nous ne pouvons pas la laisser là.
Et encore ne savait-il pas qui elle était, un avatar de ma propre famille.
– Bien sûr que non, Math. Elle va nous suivre.
– Je pourrais la prendre devant moi sur le poney.
– N’en crois rien. Elle essaierait encore de te mordre, ris-je doucement. Laisse-la décider elle-même. Nous irons au pas.
Et, en effet, elle nous suivit sans rien dire tandis que je retenais les chevaux pour ne pas la distancer. Je savais qu’il faudrait quelque temps pour la mettre en confiance, et nous retournâmes ainsi jusqu’à la côte où nos bateaux attendaient toujours. Uther n’était pas encore revenu avec ses guerriers, et je décidai d’embarquer sans lui afin de faire escale en Dyfed chez mon frère. Mais la pierre n’avait pas bougé de l’endroit où elle se trouvait, et Kadeg assis à côté d’elle, m’attendait patiemment.
– Alors Kadeg, la pierre n’a pas voulu te suivre ?
– Seigneur Marzin, ne plaisantez pas avec ça ! C’est assez humiliant et angoissant comme ça. Devoir attendre le bon plaisir d’une pierre…et demander votre aide !
– Alors rappelle tes ouvriers. Relevez ces cordes et ces chaînes. Je vais me mettre devant elle et elle me suivra.
– Ce n’est pas un animal, tout de même, marmonna-t-il désemparé.
– Non, mais elle est vivante, en dépit de ce que tu crois. Ne cherche pas à comprendre et hâtons-nous, car je veux repartir au plus vite.
Je tins ma jument elfique par la bride et fis comme je l’avais dit, sous les yeux ébahis des hommes venus se mettre en place pour la hâler. Ma main posée sur elle, la pierre se laissa soulever et transporter jusque sur le pont du navire. Math, resté auprès de la petite fille, s’écarta soudain car elle s’était mise à rire. Ce n’était pas un rire de démente comme on aurait pu s’y attendre à la voir ainsi absente d’elle-même, juste le rire joyeux et malicieux d’une enfant ou d’une elfe, et il soupira de soulagement. Elle nous accompagna sur le bateau, toujours sans rien dire, sans s’étonner de rien, s’assit près de la pierre, posa sa tête sur ses bras et s’endormit d’un seul coup.
Le navire appareilla et je dus m’endormir aussi près d’elle et de la pierre. Ce fut le cri étouffé de Math qui me sortit de ma torpeur et Taliésin se redressa lui aussi, en ramenant les bords de sa cape car le vent s’était levé. Math tremblait de tous ses membres, accroupi au sol, comme un chat prêt à sauter sur sa proie. « Elle…elle…elle disparaît ! »
Il articulait avec peine, tendait la main vers l’enfant qui dormait à mon côté l’instant auparavant et je tournai la tête vers elle, mal réveillé moi-même. La jeune banfaith n’était plus qu’un pâle reflet sous la lune qui se levait et éclairait le pont de lueurs étranges et blafardes, comme un voile qui s’affadissait rapidement et qui se fondait, peu à peu, dans la pierre qui l’avalait.
Math haletait, en proie à la terreur et Taliésin le prit contre lui pour le calmer. La forme éthérée qui subsistait encore ressemblait maintenant à de la fumée, s’étirait, de plus en plus mince, et s’infiltrait peu à peu dans la pierre bleue.
– Elle…elle n’était pas vraie, n’est-ce pas ? parvint-il à articuler en claquant des dents.
– Non, en effet, soupirai-je. Et je suis même étonné que tu aies pu la voir. C’était juste une projection de mon passé avec mon avenir. Taliésin ?
– Je l’ai vue aussi, admit-il en fronçant les sourcils. Mais nous devons bien être les seuls, Kadeg et les marins n’ont rien remarqué, j’en suis certain. C’était un esprit ?
– Oui, envoyé par les Tuatha… et qui est retourné dans la pierre. Je ne sais pas pourquoi elle a surgi à cet endroit où habitait ma famille. C’est un esprit des eaux, une dame du lac, sans aucun doute. Elle resurgira un jour, ailleurs, sous une autre forme peut-être.
– N’était-elle pas une émanation de tes pensées, parce que tu aurais voulu, de toutes tes forces, retrouver quelqu’un de la famille de ta mère ?
– C’est probable, Taliésin. Mais ils sont bien morts, tous. Il n’y a plus rien ! Et je n’ai plus rien !
– Mais non, Marzin, il y a encore Owen qui te considère comme son frère. Et il y a Arthur. Il sera pour toi un autre fils et un roi.
Extrait "Une épée pour le duc de Bretagne", 2006

Alain fit installer le camp, les chariots des cuisiniers, de l’intendance et de l’infirmerie bien à l’arrière dans un endroit protégé, et il entraîna aussitôt ses amis pour une première inspection. Nous étions assez proches pour entendre les bruits de la forteresse Viking, une fortification de terre amassée en retranchements énormes, en fossés profonds, qu’ils détruisaient lorsqu’ils abandonnaient définitivement une position. Ils savaient parfaitement tirer parti d’un terrain et, là, ils avaient excellé dans leur art de la castramétation, car les remparts qui les protégeaient auraient découragé n’importe quel assaillant.
Pas Alain! Il resta un bon moment à examiner l’emplacement du camp et ses environs, à longer la rive sur laquelle nous étions campés et à faire ses calculs secrets qui aboutiraient dès le matin à la façon d’engager ses hommes à l’attaque. Il s’entretint longuement avec Budic, Even, Dilès, Gestin et Goyon, ses meilleurs capitaines, sans omettre l’avis de Wéthénoc et Amalgod, nouveaux venus mais recrues de valeur. Puis il les envoya prendre du repos, et se retira sous sa tente avec Nunnoc pour l’assister. A l’aube, il nous fit réveiller en silence, les cuisiniers avaient déjà fait chauffer des chaudrons de bouillon qu’ils distribuèrent avec du pain, de la viande froide et des fruits séchés et, avant même que le soleil soit levé, l’armée s’élança. Les Vikings, en vieux loups de mer expérimentés et retors, avaient évidemment prévu cette attaque matinale et ils attendaient sur leurs remparts en ricanant, narguant ce jeune chef breton qui avait l’audace de venir les défier dans leur repaire. Mais Alain n’avait cure de leurs quolibets et n’entendait rien, il mettait ses hommes en place, leur indiquant la tactique qu’il allait utiliser, puis il commanda l’assaut.
J’étais resté en arrière sur son ordre et il m’avait demandé de garder l’intendance à l’abri et, en cas de repli, de tout faire pour le rallier. Je suivis donc les différentes tentatives avec angoisse car, malgré ses encouragements, et bien qu’il soit lui-même en première ligne, fortement encadré par ses capitaines, ils ne parvinrent pas à franchir les hauteurs. De nombreux Normands tombèrent pourtant avec les nôtres dans les fossés et les rivières, les flèches faisaient leur travail et sifflaient de partout, s’envolant en gerbes acérées, mais le soleil et la chaleur de l’été eurent finalement raison de l’impétuosité d’Alain. Plusieurs heures après, j’entendis le cor sonner la retraite et tous les hommes refluèrent, entraînés par lui vers une colline proche située au nord, la route leur étant coupée vers le camp par un détachement pirate qui les poursuivit un moment, puis se retira presque aussitôt.
J’avais vu la direction de leur repli et je les rejoignis à cheval avec Calatin. Les hommes étaient exsangues et épuisés par cet assaut et ils gisaient sans force à terre, découragés, allongés bras et jambes écartés, haletants et rouges, la respiration sifflante. Ils souffraient de nombreux coups et chocs, certains tremblaient spasmodiquement, les membres tétanisés, et ils auraient besoin d’un long moment de repos avant de pouvoir repartir. Sur cette position isolée, avant qu’Alain ne prenne une décision, je compris qu’ils allaient mourir de soif car il n’y avait rien à leur donner à boire, les chariots de vivres étant hors de notre portée.
J’examinai attentivement l’endroit en m’écartant un peu sur la colline. Au loin, le camp ennemi s’étendait, impressionnant, retranché derrière ses levées de terre et enchâssé par ses rivières puis, de l’éminence où je me trouvais, je m’aperçus que l’un des flancs de la colline paraissait plus vert qu’ailleurs, la végétation plus dense, et les arbres plus fournis sous lesquels nos soldats s’étaient mis à l’ombre.
– Calatin, fis-je en l’appelant à mon côté car je savais qu’il surveillait mon parcours. Tu vas creuser dans cette direction. Il doit y avoir une source souterraine. Si elle est trop profonde, il faudra redescendre jusqu’aux chariots pour chercher des outils...
– Une source ? répliqua Calatin intrigué, puis un sourire éclaira son visage car il ne mettait jamais en doute mes idées, quelles que soient leur étrangeté, et il partit en courant, bientôt suivi par Cervus qui avait entendu nos propos.
Je revins alors vers Alain qui discutait avec ses amis dont les avis étaient partagés pour une fois, car ils avaient perdu trop des leurs et leur nombre était largement inférieur à celui du camp adverse.
– Ils ne nous ont pas poursuivis jusqu’ici, argumenta Alain. Ce qui veut dire que leurs pertes sont importantes, et qu’ils ne veulent pas se hasarder dans un autre combat tout de suite. Ils espèrent du répit pour réparer leurs dégâts et nous pensent découragés.
– Mais nous le sommes, Alain, objecta quelqu’un.
– Non! répliqua-t-il d’une voix ferme. Nous sommes fatigués, certes, mais pas vaincus. Jamais! Nous attaquerons à nouveau avant la nuit!
J’admirai une fois de plus la force d’Alain, son caractère indomptable quoi qu’il arrive, et je comprenais pourquoi ses amis s’appuyaient tant sur lui et se sentaient protégés et invincibles lorsqu’il était présent. Son charisme était tel qu’il pouvait les envoyer à l’assaut sur un simple signe car ils savaient parfaitement que ses actes étaient calculés et que son génie militaire en avait évalué les dangers et les obstacles.
– Avant la nuit? Mais nous n’avons rien à boire, les hommes refuseront de retourner là-bas...
Alain fit alors un geste pour retirer son épée du fourreau dans l’intention de la brandir vers l’armée affalée autour de lui afin de l’exhorter à repartir. Il n’en retira que la poignée, et la lame, brisée net, tomba sur le sol sous le regard épouvanté de ses amis qui y virent un mauvais présage. Ils étaient nourris de superstitions, de légendes et de croyances anciennes depuis l’enfance et, comme nous tous, craignaient le doigt de Dieu ou du diable chaque fois qu’un acte leur paraissait anormal. Je ramassai prestement le morceau de métal. L’instant était venu, je le savais!
Sous ma cape, j’avais pris avec moi dès le matin la magnifique épée forgée au mont Yr Wyddfa, qui attendait son heure depuis tant d’années.
– C’est un signe néfaste, murmura Amalgod qui paraissait accablé. Il était, plus que nul autre, influençable lorsqu’il ne comprenait pas et, brave sur un champ de bataille, il pouvait être aussi effrayé qu’une femme lorsque le monde des esprits semblait cerner le nôtre. Je vis le regard furieux de Wéthénoc qui, d’un tempérament fonceur, ne se résignait jamais à l’instar d’Alain, celui désemparé d’Even et de Gestin, et l’incrédulité envahir Dilès. Seul Budic resta stoïque et tendit aussitôt sa propre épée vers Alain avec un sang-froid admirable.
– Celle-là vaut la tienne, Alain! dit-il fièrement.
Et c’était en effet une arme unique qu’il aimait et entretenait avec soin, qui lui avait sauvé la vie plus d’une fois et dont il ne se séparait jamais, et la lui donner était le plus généreux des actes d’amour.
– Poher et Cornouaille sont unis, prends l’épée de Cornouaille et tentons un autre assaut.
– Non! dis-je calmement tandis que tous les regards me fixaient, stupéfaits. Ce n’est pas avec cette épée-là qu’Alain obtiendra la victoire. Mais avec celle-ci!
Je sortis alors l’arme de son fourreau et elle étincela dans le soleil, portant sa lueur magique et irréelle aux yeux de tous les soldats. Je l’élevai bien haut, afin que chacun puisse la voir, et ma voix enfla, forte et puissante pour une prédiction.
– Hommes de Bretagne, criai-je. C’est l’épée de votre duc. Suivez-là! Alain, avec elle, vous mènera à la victoire finale !
Je les vis se redresser peu à peu, attirés par sa lumière éblouissante, et j’entendis leurs exclamations en voyant luire les pierres précieuses. Les amis d’Alain comprirent tout de suite ce que j’étais en train de faire, me servir de mon pouvoir sur les hommes et de la crainte que j’inspirais pour galvaniser leur énergie, et Budic, toujours plus rapide, saisit l’occasion au vol et mit un genou en terre.
– Je rends hommage à notre nouveau duc! fit-il à voix haute et claire en inclinant la tête. Longue vie à Alain!
Tous, l’un après l’autre, firent de même sans hésiter et les soldats s’attroupèrent autour d’eux, ébahis, sentant qu’il se passait quelque chose de magique.
– Il faut une épée extraordinaire à un roi! murmurai-je très bas. Et tu vas devenir roi!
Alain me regarda, puis examina l’épée que je venais de lui remettre, et un sourire étira ses lèvres. Il avait reconnu bien sûr le rubis sanglant, l’émeraude et le jaune profond des pierres précieuses que je serrais autrefois dans un petit coffre de mon cabinet de travail, ainsi que le travail du maître qui avait ciselé la poignée d’argent et forgé la lame étincelante comme de la glace. Il comprit que je l’avais gardée près de moi toutes ces années, attendant le moment de la lui remettre, et sa main chercha la mienne pour une étreinte émue.
– As-tu peur, Alain?
– Ai-je le temps d’avoir peur, Aedon? dit-il en se penchant à mon oreille. En ai-je le droit? Nul ne le saura jamais, mon ami, acheva-t-il avec une légère ironie en se redressant. Il était plus subtil et plus secret qu’on ne le pensait, mais cela je le savais déjà.
– Longue vie à Barbetorte! cria soudain l’un des hommes dans un élan d’enthousiasme, et ce cri, répercuté par toute l’armée, enfla et grandit, relayé par le battement des épées sur les boucliers.
– Barbetorte!... Barbetorte!... Barbetorte!...
Ils employaient le surnom affectueux dont ils avaient l’habitude d’affubler Alain et ils entourèrent notre groupe comme s’ils y trouvaient le ressort qui leur manquait pour continuer la guerre qu’ils étaient en train de faire aux pirates de la rive d’en face. Dans un chœur ardent de voix mâles, ils entonnèrent alors la « Chanson du Renard Barbu »
« Le renard barbu glapit, glapit, glapit au bois, malheur aux lapins étrangers! Ses yeux sont deux lames tranchantes. Tranchantes sont ses dents, et rapides ses pieds, et ses ongles rougis de sang. Alain-le-Renard glapit, glapit, glapit. Guerre! Guerre! »
– Vais-je gagner, Aedon ?
– Bien sûr! fis-je avec un large sourire. Ne le dois-tu pas?
– Je ne sais jamais quel prodige tu peux accomplir, mon ami! répliqua-t-il en penchant la tête de côté d’un air dubitatif.
C’est alors qu’un cri plus fort que les autres fit tourner les têtes vers Calatin et Cervus qui revenaient vers nous en courant, le visage hilare et levant bien haut leurs gourdes pleines d’une eau qui éclaboussait chacun de leurs pas. « De l’eau! Nous avons trouvé de l’eau!... »
Ce fut une ruée soudaine et les soldats refluèrent d’un seul bloc vers les deux hommes qui nous entraînèrent à leur suite. Ils avaient creusé un trou avec leurs épées dans un endroit sondé par Calatin, et l’eau avait jailli non comme un geyser mais suffisamment pour remplir leurs gourdes.
On s’écarta devant Alain et moi-même et, une fois près du filet d’eau qui s’écoulait toujours en une petite mare claire et fraiche, il s’agenouilla pour remercier la Vierge, l’implorer de leur accorder de quoi désaltérer ses hommes et la force d’escalader une fois de plus les remparts de terre pirates. Je restai debout près de lui, conscient de tous les yeux de l’armée fixés sur Alain qu’ils idolâtraient, et sur moi dont ils craignaient les prédictions et les pouvoirs dont ils me croyaient investi.
– Creusez encore! ordonnai-je alors. Afin que chacun puisse boire à sa soif.
Tous les bras se tendirent, et chacun se relaya pour dégager la terre, les pierres et les racines jusqu’à ce qu’un jet plus puissant apparaisse et ils s’en aspergèrent en riant. Leurs hurlements de joie s’entendirent jusqu’au camp de l’autre côté de la rivière, inquiétant les Vikings qui devaient se demander quel serait le prochain pas du chef breton. Les attaquer à nouveau ou renoncer et partir en vaincu?
Alain avait prié la Vierge, sa réponse ne s’était pas fait attendre, voilà ce qui importait aux hommes, ce qu’ils voyaient et ce qu’ils entendaient. Il ne leur en fallait pas plus pour retrouver l’énergie qui les avait abandonnés un moment après l’échec de leur premier assaut. L’épée scintillante qui était apparue dans ma main comme si je l’avais fait surgir du néant ou du monde des esprits, l’hommage que ses amis venaient de lui rendre, l’eau enfin qui avait sourdé par miracle sur cette colline, tout cela était largement suffisant pour inciter les soldats d’Alain à retourner affronter les Normands avec la ferme intention de ne pas leur céder le terrain, de leur casser les dents, de leur fracasser le crâne et de leur faire mordre la terre bretonne une bonne fois.
– Buvez! dit Alain. Buvez tout votre saoul... mais videz vos vessies avant de me suivre là-bas, ajouta-t-il en éclatant de rire. Pas question de vous arrêter de combattre pour uriner! Vous y perdriez la vie.
Les hommes s’esclaffèrent, enchantés de la plaisanterie de leur chef qui démontrait bonne humeur et sérénité, et s’approchèrent pour remplir leurs gourdes de cette eau bénie qui venait des entrailles de la colline. Ils firent un léger écart en passant près de moi, et je souris de cette frayeur qu’inspiraient mes paroles et mes actes qu’ils ne pouvaient pas comprendre. J’aurais pu leur expliquer bien sûr d’où venait cette merveilleuse épée que j’avais fait forger des années auparavant, mais n’avais-je pas été dirigé moi-même ce jour-là par une force obscure? J’aurais pu aussi leur dire comment mes expériences avaient permis à Calatin de trouver de l’eau! Mais il est parfois nécessaire d’entourer de mystère certains événements en apparence irrationnels afin de les rendre plus spectaculaires. Les soldats avaient grand besoin de prodiges et je leur avais donné tout leur content pour le jour.
Aucun d’eux ne savait de quel prix je payais mes étranges dons. La solitude extrême, le renoncement à l’amour de la femme que j’aimais, aux enfants que j’aurais pu avoir... à moins que le destin, qui toujours se refusait à me montrer mon propre avenir, n’avait en réserve un présent à sa façon, une aumône pour contrebalancer les sacrifices qu’il exigeait. Aucun d’eux ne pouvait sentir la tristesse de mon cœur qui aimait à la fois Judith et Alain alors qu’ils étaient mes involontaires bourreaux. J’avais joué ma partie! Il restait à Alain à jouer la sienne et elle était, ô combien plus dangereuse que la mienne.
Une heure à peine après, il avait réorganisé son armée et il l’entraîna à sa suite en dévalant la colline à vive allure. Rafraîchis, exaltés par ce qu’ils venaient de vivre et de voir, plus rien ne pouvait arrêter les hommes car ils allaient se battre pour leur duc.
J’entendis leurs cris se mêler là-bas, « Breiz » lançait maintenant Alain au lieu de « Poher », « Léon » hurlait Even, « Cornouaille » clamait Budic, et Gestin, pour la première fois, revendiquant la terre de ses pères, leur répondit par un « Rays » tonitruant.
Je les vis escalader les remparts de terre comme des chenilles à l’aide de grappins, se pousser, se hisser, s’entraider pour parvenir enfin au sommet où les pirates, étonnés de cette audace et de ces forces nouvelles qu’ils prirent peut-être pour l’arrivée de renforts, sentirent leur assurance flancher. Ce guerrier qui les menait à de telles extrémités était sans conteste un chef hardi et redoutable, le plus redoutable sans doute que les Vikings avaient eu à affronter, et leurs nombreuses pertes les firent enfin reculer. Ils ne se battaient plus avec la même hargne, fatigués eux aussi et déjà décimés par le premier combat de la journée, et nos Bretons firent un carnage.
J’étais sur l’épaule d’Alain comme une chouette blanche pour guider son bras qui frappait haut et fort, j’étais aussi cette épée qu’il brandissait en roi, j’étais tous les royaumes bretons réunis, ceux de Cymru et ceux du Deheubarth, ceux de Bretagne, et j’étais l’âme d’Arthur imprégnée dans celle d’Alain.
– Alain! cria soudain Gestin. Les navires... là-bas!...
Quelques uns avaient réussi à s’extirper du piège pour se diriger vers la Loire et rejoindre leurs navires, et ils faisaient maintenant voiles vers la mer, abandonnant à leur sort leurs derniers compagnons blessés, leur butin... et leur rêve de s’établir définitivement en Bretagne. Nantes et sa position stratégique venait de leur échapper!
Alain était maître de la place et il fit sonner le cor de la victoire.
Pas Alain! Il resta un bon moment à examiner l’emplacement du camp et ses environs, à longer la rive sur laquelle nous étions campés et à faire ses calculs secrets qui aboutiraient dès le matin à la façon d’engager ses hommes à l’attaque. Il s’entretint longuement avec Budic, Even, Dilès, Gestin et Goyon, ses meilleurs capitaines, sans omettre l’avis de Wéthénoc et Amalgod, nouveaux venus mais recrues de valeur. Puis il les envoya prendre du repos, et se retira sous sa tente avec Nunnoc pour l’assister. A l’aube, il nous fit réveiller en silence, les cuisiniers avaient déjà fait chauffer des chaudrons de bouillon qu’ils distribuèrent avec du pain, de la viande froide et des fruits séchés et, avant même que le soleil soit levé, l’armée s’élança. Les Vikings, en vieux loups de mer expérimentés et retors, avaient évidemment prévu cette attaque matinale et ils attendaient sur leurs remparts en ricanant, narguant ce jeune chef breton qui avait l’audace de venir les défier dans leur repaire. Mais Alain n’avait cure de leurs quolibets et n’entendait rien, il mettait ses hommes en place, leur indiquant la tactique qu’il allait utiliser, puis il commanda l’assaut.
J’étais resté en arrière sur son ordre et il m’avait demandé de garder l’intendance à l’abri et, en cas de repli, de tout faire pour le rallier. Je suivis donc les différentes tentatives avec angoisse car, malgré ses encouragements, et bien qu’il soit lui-même en première ligne, fortement encadré par ses capitaines, ils ne parvinrent pas à franchir les hauteurs. De nombreux Normands tombèrent pourtant avec les nôtres dans les fossés et les rivières, les flèches faisaient leur travail et sifflaient de partout, s’envolant en gerbes acérées, mais le soleil et la chaleur de l’été eurent finalement raison de l’impétuosité d’Alain. Plusieurs heures après, j’entendis le cor sonner la retraite et tous les hommes refluèrent, entraînés par lui vers une colline proche située au nord, la route leur étant coupée vers le camp par un détachement pirate qui les poursuivit un moment, puis se retira presque aussitôt.
J’avais vu la direction de leur repli et je les rejoignis à cheval avec Calatin. Les hommes étaient exsangues et épuisés par cet assaut et ils gisaient sans force à terre, découragés, allongés bras et jambes écartés, haletants et rouges, la respiration sifflante. Ils souffraient de nombreux coups et chocs, certains tremblaient spasmodiquement, les membres tétanisés, et ils auraient besoin d’un long moment de repos avant de pouvoir repartir. Sur cette position isolée, avant qu’Alain ne prenne une décision, je compris qu’ils allaient mourir de soif car il n’y avait rien à leur donner à boire, les chariots de vivres étant hors de notre portée.
J’examinai attentivement l’endroit en m’écartant un peu sur la colline. Au loin, le camp ennemi s’étendait, impressionnant, retranché derrière ses levées de terre et enchâssé par ses rivières puis, de l’éminence où je me trouvais, je m’aperçus que l’un des flancs de la colline paraissait plus vert qu’ailleurs, la végétation plus dense, et les arbres plus fournis sous lesquels nos soldats s’étaient mis à l’ombre.
– Calatin, fis-je en l’appelant à mon côté car je savais qu’il surveillait mon parcours. Tu vas creuser dans cette direction. Il doit y avoir une source souterraine. Si elle est trop profonde, il faudra redescendre jusqu’aux chariots pour chercher des outils...
– Une source ? répliqua Calatin intrigué, puis un sourire éclaira son visage car il ne mettait jamais en doute mes idées, quelles que soient leur étrangeté, et il partit en courant, bientôt suivi par Cervus qui avait entendu nos propos.
Je revins alors vers Alain qui discutait avec ses amis dont les avis étaient partagés pour une fois, car ils avaient perdu trop des leurs et leur nombre était largement inférieur à celui du camp adverse.
– Ils ne nous ont pas poursuivis jusqu’ici, argumenta Alain. Ce qui veut dire que leurs pertes sont importantes, et qu’ils ne veulent pas se hasarder dans un autre combat tout de suite. Ils espèrent du répit pour réparer leurs dégâts et nous pensent découragés.
– Mais nous le sommes, Alain, objecta quelqu’un.
– Non! répliqua-t-il d’une voix ferme. Nous sommes fatigués, certes, mais pas vaincus. Jamais! Nous attaquerons à nouveau avant la nuit!
J’admirai une fois de plus la force d’Alain, son caractère indomptable quoi qu’il arrive, et je comprenais pourquoi ses amis s’appuyaient tant sur lui et se sentaient protégés et invincibles lorsqu’il était présent. Son charisme était tel qu’il pouvait les envoyer à l’assaut sur un simple signe car ils savaient parfaitement que ses actes étaient calculés et que son génie militaire en avait évalué les dangers et les obstacles.
– Avant la nuit? Mais nous n’avons rien à boire, les hommes refuseront de retourner là-bas...
Alain fit alors un geste pour retirer son épée du fourreau dans l’intention de la brandir vers l’armée affalée autour de lui afin de l’exhorter à repartir. Il n’en retira que la poignée, et la lame, brisée net, tomba sur le sol sous le regard épouvanté de ses amis qui y virent un mauvais présage. Ils étaient nourris de superstitions, de légendes et de croyances anciennes depuis l’enfance et, comme nous tous, craignaient le doigt de Dieu ou du diable chaque fois qu’un acte leur paraissait anormal. Je ramassai prestement le morceau de métal. L’instant était venu, je le savais!
Sous ma cape, j’avais pris avec moi dès le matin la magnifique épée forgée au mont Yr Wyddfa, qui attendait son heure depuis tant d’années.
– C’est un signe néfaste, murmura Amalgod qui paraissait accablé. Il était, plus que nul autre, influençable lorsqu’il ne comprenait pas et, brave sur un champ de bataille, il pouvait être aussi effrayé qu’une femme lorsque le monde des esprits semblait cerner le nôtre. Je vis le regard furieux de Wéthénoc qui, d’un tempérament fonceur, ne se résignait jamais à l’instar d’Alain, celui désemparé d’Even et de Gestin, et l’incrédulité envahir Dilès. Seul Budic resta stoïque et tendit aussitôt sa propre épée vers Alain avec un sang-froid admirable.
– Celle-là vaut la tienne, Alain! dit-il fièrement.
Et c’était en effet une arme unique qu’il aimait et entretenait avec soin, qui lui avait sauvé la vie plus d’une fois et dont il ne se séparait jamais, et la lui donner était le plus généreux des actes d’amour.
– Poher et Cornouaille sont unis, prends l’épée de Cornouaille et tentons un autre assaut.
– Non! dis-je calmement tandis que tous les regards me fixaient, stupéfaits. Ce n’est pas avec cette épée-là qu’Alain obtiendra la victoire. Mais avec celle-ci!
Je sortis alors l’arme de son fourreau et elle étincela dans le soleil, portant sa lueur magique et irréelle aux yeux de tous les soldats. Je l’élevai bien haut, afin que chacun puisse la voir, et ma voix enfla, forte et puissante pour une prédiction.
– Hommes de Bretagne, criai-je. C’est l’épée de votre duc. Suivez-là! Alain, avec elle, vous mènera à la victoire finale !
Je les vis se redresser peu à peu, attirés par sa lumière éblouissante, et j’entendis leurs exclamations en voyant luire les pierres précieuses. Les amis d’Alain comprirent tout de suite ce que j’étais en train de faire, me servir de mon pouvoir sur les hommes et de la crainte que j’inspirais pour galvaniser leur énergie, et Budic, toujours plus rapide, saisit l’occasion au vol et mit un genou en terre.
– Je rends hommage à notre nouveau duc! fit-il à voix haute et claire en inclinant la tête. Longue vie à Alain!
Tous, l’un après l’autre, firent de même sans hésiter et les soldats s’attroupèrent autour d’eux, ébahis, sentant qu’il se passait quelque chose de magique.
– Il faut une épée extraordinaire à un roi! murmurai-je très bas. Et tu vas devenir roi!
Alain me regarda, puis examina l’épée que je venais de lui remettre, et un sourire étira ses lèvres. Il avait reconnu bien sûr le rubis sanglant, l’émeraude et le jaune profond des pierres précieuses que je serrais autrefois dans un petit coffre de mon cabinet de travail, ainsi que le travail du maître qui avait ciselé la poignée d’argent et forgé la lame étincelante comme de la glace. Il comprit que je l’avais gardée près de moi toutes ces années, attendant le moment de la lui remettre, et sa main chercha la mienne pour une étreinte émue.
– As-tu peur, Alain?
– Ai-je le temps d’avoir peur, Aedon? dit-il en se penchant à mon oreille. En ai-je le droit? Nul ne le saura jamais, mon ami, acheva-t-il avec une légère ironie en se redressant. Il était plus subtil et plus secret qu’on ne le pensait, mais cela je le savais déjà.
– Longue vie à Barbetorte! cria soudain l’un des hommes dans un élan d’enthousiasme, et ce cri, répercuté par toute l’armée, enfla et grandit, relayé par le battement des épées sur les boucliers.
– Barbetorte!... Barbetorte!... Barbetorte!...
Ils employaient le surnom affectueux dont ils avaient l’habitude d’affubler Alain et ils entourèrent notre groupe comme s’ils y trouvaient le ressort qui leur manquait pour continuer la guerre qu’ils étaient en train de faire aux pirates de la rive d’en face. Dans un chœur ardent de voix mâles, ils entonnèrent alors la « Chanson du Renard Barbu »
« Le renard barbu glapit, glapit, glapit au bois, malheur aux lapins étrangers! Ses yeux sont deux lames tranchantes. Tranchantes sont ses dents, et rapides ses pieds, et ses ongles rougis de sang. Alain-le-Renard glapit, glapit, glapit. Guerre! Guerre! »
– Vais-je gagner, Aedon ?
– Bien sûr! fis-je avec un large sourire. Ne le dois-tu pas?
– Je ne sais jamais quel prodige tu peux accomplir, mon ami! répliqua-t-il en penchant la tête de côté d’un air dubitatif.
C’est alors qu’un cri plus fort que les autres fit tourner les têtes vers Calatin et Cervus qui revenaient vers nous en courant, le visage hilare et levant bien haut leurs gourdes pleines d’une eau qui éclaboussait chacun de leurs pas. « De l’eau! Nous avons trouvé de l’eau!... »
Ce fut une ruée soudaine et les soldats refluèrent d’un seul bloc vers les deux hommes qui nous entraînèrent à leur suite. Ils avaient creusé un trou avec leurs épées dans un endroit sondé par Calatin, et l’eau avait jailli non comme un geyser mais suffisamment pour remplir leurs gourdes.
On s’écarta devant Alain et moi-même et, une fois près du filet d’eau qui s’écoulait toujours en une petite mare claire et fraiche, il s’agenouilla pour remercier la Vierge, l’implorer de leur accorder de quoi désaltérer ses hommes et la force d’escalader une fois de plus les remparts de terre pirates. Je restai debout près de lui, conscient de tous les yeux de l’armée fixés sur Alain qu’ils idolâtraient, et sur moi dont ils craignaient les prédictions et les pouvoirs dont ils me croyaient investi.
– Creusez encore! ordonnai-je alors. Afin que chacun puisse boire à sa soif.
Tous les bras se tendirent, et chacun se relaya pour dégager la terre, les pierres et les racines jusqu’à ce qu’un jet plus puissant apparaisse et ils s’en aspergèrent en riant. Leurs hurlements de joie s’entendirent jusqu’au camp de l’autre côté de la rivière, inquiétant les Vikings qui devaient se demander quel serait le prochain pas du chef breton. Les attaquer à nouveau ou renoncer et partir en vaincu?
Alain avait prié la Vierge, sa réponse ne s’était pas fait attendre, voilà ce qui importait aux hommes, ce qu’ils voyaient et ce qu’ils entendaient. Il ne leur en fallait pas plus pour retrouver l’énergie qui les avait abandonnés un moment après l’échec de leur premier assaut. L’épée scintillante qui était apparue dans ma main comme si je l’avais fait surgir du néant ou du monde des esprits, l’hommage que ses amis venaient de lui rendre, l’eau enfin qui avait sourdé par miracle sur cette colline, tout cela était largement suffisant pour inciter les soldats d’Alain à retourner affronter les Normands avec la ferme intention de ne pas leur céder le terrain, de leur casser les dents, de leur fracasser le crâne et de leur faire mordre la terre bretonne une bonne fois.
– Buvez! dit Alain. Buvez tout votre saoul... mais videz vos vessies avant de me suivre là-bas, ajouta-t-il en éclatant de rire. Pas question de vous arrêter de combattre pour uriner! Vous y perdriez la vie.
Les hommes s’esclaffèrent, enchantés de la plaisanterie de leur chef qui démontrait bonne humeur et sérénité, et s’approchèrent pour remplir leurs gourdes de cette eau bénie qui venait des entrailles de la colline. Ils firent un léger écart en passant près de moi, et je souris de cette frayeur qu’inspiraient mes paroles et mes actes qu’ils ne pouvaient pas comprendre. J’aurais pu leur expliquer bien sûr d’où venait cette merveilleuse épée que j’avais fait forger des années auparavant, mais n’avais-je pas été dirigé moi-même ce jour-là par une force obscure? J’aurais pu aussi leur dire comment mes expériences avaient permis à Calatin de trouver de l’eau! Mais il est parfois nécessaire d’entourer de mystère certains événements en apparence irrationnels afin de les rendre plus spectaculaires. Les soldats avaient grand besoin de prodiges et je leur avais donné tout leur content pour le jour.
Aucun d’eux ne savait de quel prix je payais mes étranges dons. La solitude extrême, le renoncement à l’amour de la femme que j’aimais, aux enfants que j’aurais pu avoir... à moins que le destin, qui toujours se refusait à me montrer mon propre avenir, n’avait en réserve un présent à sa façon, une aumône pour contrebalancer les sacrifices qu’il exigeait. Aucun d’eux ne pouvait sentir la tristesse de mon cœur qui aimait à la fois Judith et Alain alors qu’ils étaient mes involontaires bourreaux. J’avais joué ma partie! Il restait à Alain à jouer la sienne et elle était, ô combien plus dangereuse que la mienne.
Une heure à peine après, il avait réorganisé son armée et il l’entraîna à sa suite en dévalant la colline à vive allure. Rafraîchis, exaltés par ce qu’ils venaient de vivre et de voir, plus rien ne pouvait arrêter les hommes car ils allaient se battre pour leur duc.
J’entendis leurs cris se mêler là-bas, « Breiz » lançait maintenant Alain au lieu de « Poher », « Léon » hurlait Even, « Cornouaille » clamait Budic, et Gestin, pour la première fois, revendiquant la terre de ses pères, leur répondit par un « Rays » tonitruant.
Je les vis escalader les remparts de terre comme des chenilles à l’aide de grappins, se pousser, se hisser, s’entraider pour parvenir enfin au sommet où les pirates, étonnés de cette audace et de ces forces nouvelles qu’ils prirent peut-être pour l’arrivée de renforts, sentirent leur assurance flancher. Ce guerrier qui les menait à de telles extrémités était sans conteste un chef hardi et redoutable, le plus redoutable sans doute que les Vikings avaient eu à affronter, et leurs nombreuses pertes les firent enfin reculer. Ils ne se battaient plus avec la même hargne, fatigués eux aussi et déjà décimés par le premier combat de la journée, et nos Bretons firent un carnage.
J’étais sur l’épaule d’Alain comme une chouette blanche pour guider son bras qui frappait haut et fort, j’étais aussi cette épée qu’il brandissait en roi, j’étais tous les royaumes bretons réunis, ceux de Cymru et ceux du Deheubarth, ceux de Bretagne, et j’étais l’âme d’Arthur imprégnée dans celle d’Alain.
– Alain! cria soudain Gestin. Les navires... là-bas!...
Quelques uns avaient réussi à s’extirper du piège pour se diriger vers la Loire et rejoindre leurs navires, et ils faisaient maintenant voiles vers la mer, abandonnant à leur sort leurs derniers compagnons blessés, leur butin... et leur rêve de s’établir définitivement en Bretagne. Nantes et sa position stratégique venait de leur échapper!
Alain était maître de la place et il fit sonner le cor de la victoire.
Extrait "Deux Meurtres pour un Royaume", 2005
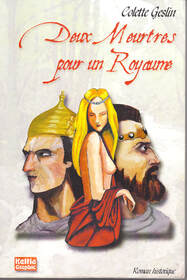
Abbaye de Redon
-Sursum corda!...
Conwoïon ouvrit les mains pour bénir ses moines et il aperçut une haute silhouette sombre adossée à un pilier sculpté dans le fond de l’église. L’homme était vêtu d’un élégant habit lie-de-vin, ourlé d’une soutache dorée et d’un mantel noir retenu à l’épaule par une fibule d’or, tête nue et altier.
Priait-il? Conwoïon n’aurait su le dire. Il termina sa messe puis se retira pour enlever ses habits sacerdotaux et se retrouver en robe de bure, pieds nus dans ses sandales, et les moines qui l’assistaient s’éclipsèrent en entendant les pas du souverain sur les dalles.
Salomon salua Le père abbé avec déférence sur le seuil et Conwoïon, qui le connaissait depuis l’enfance, décela une faille inconnue dans le visage fermé et austère.
-Sire! Vous n’avez pas annoncé votre visite!
-Je suis seul avec mon écuyer et quelques hommes. Je voulais vous parler.
-À moi?..ou à Dieu ?
Salomon ne répondit pas et s’éloigna vers le jardin où il venait autrefois avec Nominoë et Erispoë.
-J’ai toujours aimé cet endroit, murmura-t-il, en contemplant les arbres, les buissons taillés, les roses et les buis. Le lierre couvrait une partie des arcades du cloître et, plus loin, s’ordonnait le carré des simples où travaillait un moine parmi les plantes préférées de l’apothicaire du monastère, camomille et menthe, hysope et tanaisie, mélisse, sauge, absinthe...
-C’était aussi celui que préférait le duc...
-Je le sais bien. Ce temps me semble loin, ajouta-t-il plus bas.
Jamais Conwoïon ne l’avait vu mélancolique ni incertain, ni même inquiet, et il pressentit qu’un tourment, dans lequel il se débattait, empoisonnait sa vie.
-N’avez-vous pas tout ce que vous désirez, roi Salomon? répliqua-t-il d’une voix plus dure qu’il ne l’aurait voulu
-Oui l’abbé. J’ai tout maintenant...sauf la paix!
-Le rôle de roi n’est pas des plus paisibles! se contenta de rétorquer Conwoïon, tout en sachant très bien que ce n’était pas ce à quoi Salomon faisait allusion.
-Ce n’est pas cela qui me pèse, Conwoïon. Je suis tout à fait capable d’assumer cette charge...et vous le savez bien.
Conwoïon continua d’avancer lentement sous les arbres sans répliquer. Sa jambe lui faisait mal et il grimaçait de temps en temps sans se plaindre, car il voulait savoir le poids que le roi avait sur l’âme, et il attendait son aveu.
-Désirez-vous que je vous entende en confession? demanda-t-il, alors que le silence s’installait et que Salomon semblait absent.
-Je n’ai pas besoin de cela, tonna Salomon soudain en colère. Je ne suis pas de ceux qui se précipitent dans un confessionnal à la moindre faute.
-Pourtant, vous semblez avoir besoin de vous confier, Salaün, reprit Conwoïon patiemment. Je vous écoute. Nous sommes seuls...avec Dieu!
Salomon déambulait à grands pas saccadés autour du jardin si bien que Conwoïon, qui marchait de plus en plus mal, ne put le suivre. Il s’arrêta et attendit qu’il revienne vers lui.
-Suis-je devenu fou, Conwoïon? cria presque le roi en faisant demi-tour. J’entends la voix de mon cousin!
-Erispoë? n’est-ce pas plutôt celle de votre conscience? murmura Conwoïon atterré.
-Beau jargon d’homme d’Église, Conwoïon, ricana Salomon. Je sais que c’est celui que vous employez avec vos moines et vos ouailles. Pas avec moi! fit-il sourdement en rapprochant son visage d’une façon presque menaçante. Erispoë me parle vraiment !
-Bien, sire, rompit Conwoïon qui ne voulut pas l’irriter davantage. Je vous crois. L’avez-vous tué? ajouta-t-il tout à trac en fermant les yeux sous la colère qu’il allait attiser.
-Non! Non, Conwoïon, je ne l’ai pas tué, articula sourdement Salomon en accentuant chaque mot. C’est bien Almar, même si personne ne le croit. Mais je suis tout de même coupable. Je me sens coupable. Car j’ai désiré sa mort je ne sais combien de fois. Je voulais...je voulais tout ce qu’il avait, et je l’ai tué en pensée bien avant qu’Almar ne le fasse!
-Almar ne l’a-t-il pas fait...parce qu’il croyait que c’était ce que vous vouliez? osa Conwoïon.
-C’est pour ça que je suis coupable, l’abbé, même si je n’ai pas enfoncé l’épée. Et maintenant...
-Et maintenant vous êtes hanté par ce meurtre, n’est-ce pas? constata Conwoïon en regardant de côté le visage crispé, presque tétanisé du souverain.
Il se rappelait très bien les interrogations de Nominoë à son sujet, l’inquiétude de Maelcat devant les colères du jeune garçon qu’il éduquait avec Erispoë, puis son renvoi par le duc pour une raison qu’il avait toujours ignorée, et il se dit que le destin avait rattrapé l’homme, alors même que ses mentors avaient essayé d’inculquer à son adolescence tous les principes moraux qui étaient les leurs.
-Aidez-moi l’abbé! pria soudain Salomon.
Conwoïon soupira, accablé et impuissant. Comment morigéner un roi, un homme aussi rétif et autoritaire que Salomon, comment l’apaiser, et était-il seulement repentant de son acte?
-Vous repentez-vous de ce...de cet...
-Mais je ne cesse de le faire, Conwoïon! J’aimais Erispoë... même si je le détestais en même temps...Et je voudrais bien effacer ce jour-là...Je crois que je n’aurais plus jamais la paix maintenant, avoua-t-il dans un gémissement de bête.
-Vous entendez vraiment sa voix, roi Salomon?
-Vraiment, oui! répliqua-t-il fermement. Mais, après tout, vous avez peut-être raison...ce n’est sans doute que ma conscience qui se rebelle.
-Priez!
-Je prie, l’abbé, je prie...
-Repentez-vous, implorez Dieu, faites pénitence, énuméra Conwoïon à bout de forces. Et soyez plus humble, ajouta-t-il plus bas.
-N’est-ce pas ce que je suis venu faire dans votre monastère?.Mais Dieu...Dieu...
-Ne blasphémez pas! l’arrêta Conwoïon qui ne voulait pas entendre de paroles impies. Dieu écoute chacun de ses enfants...vous y compris, roi Salomon. Si vous y mettez le prix!
Conwoïon, épuisé par leur échange, s’assit sur la margelle du puits, la tête dans les mains. Salomon tourna les talons et s’éloigna.
-Merci l’abbé! Vous avez fait ce que vous avez pu. Nous nous reverrons bientôt. Demandez-moi ce dont vous avez besoin.
- J’ai surtout besoin de paix, Salaün, soupira tout bas Conwoïon accablé. Mais tu viens de me l’ôter à jamais!
-Sursum corda!...
Conwoïon ouvrit les mains pour bénir ses moines et il aperçut une haute silhouette sombre adossée à un pilier sculpté dans le fond de l’église. L’homme était vêtu d’un élégant habit lie-de-vin, ourlé d’une soutache dorée et d’un mantel noir retenu à l’épaule par une fibule d’or, tête nue et altier.
Priait-il? Conwoïon n’aurait su le dire. Il termina sa messe puis se retira pour enlever ses habits sacerdotaux et se retrouver en robe de bure, pieds nus dans ses sandales, et les moines qui l’assistaient s’éclipsèrent en entendant les pas du souverain sur les dalles.
Salomon salua Le père abbé avec déférence sur le seuil et Conwoïon, qui le connaissait depuis l’enfance, décela une faille inconnue dans le visage fermé et austère.
-Sire! Vous n’avez pas annoncé votre visite!
-Je suis seul avec mon écuyer et quelques hommes. Je voulais vous parler.
-À moi?..ou à Dieu ?
Salomon ne répondit pas et s’éloigna vers le jardin où il venait autrefois avec Nominoë et Erispoë.
-J’ai toujours aimé cet endroit, murmura-t-il, en contemplant les arbres, les buissons taillés, les roses et les buis. Le lierre couvrait une partie des arcades du cloître et, plus loin, s’ordonnait le carré des simples où travaillait un moine parmi les plantes préférées de l’apothicaire du monastère, camomille et menthe, hysope et tanaisie, mélisse, sauge, absinthe...
-C’était aussi celui que préférait le duc...
-Je le sais bien. Ce temps me semble loin, ajouta-t-il plus bas.
Jamais Conwoïon ne l’avait vu mélancolique ni incertain, ni même inquiet, et il pressentit qu’un tourment, dans lequel il se débattait, empoisonnait sa vie.
-N’avez-vous pas tout ce que vous désirez, roi Salomon? répliqua-t-il d’une voix plus dure qu’il ne l’aurait voulu
-Oui l’abbé. J’ai tout maintenant...sauf la paix!
-Le rôle de roi n’est pas des plus paisibles! se contenta de rétorquer Conwoïon, tout en sachant très bien que ce n’était pas ce à quoi Salomon faisait allusion.
-Ce n’est pas cela qui me pèse, Conwoïon. Je suis tout à fait capable d’assumer cette charge...et vous le savez bien.
Conwoïon continua d’avancer lentement sous les arbres sans répliquer. Sa jambe lui faisait mal et il grimaçait de temps en temps sans se plaindre, car il voulait savoir le poids que le roi avait sur l’âme, et il attendait son aveu.
-Désirez-vous que je vous entende en confession? demanda-t-il, alors que le silence s’installait et que Salomon semblait absent.
-Je n’ai pas besoin de cela, tonna Salomon soudain en colère. Je ne suis pas de ceux qui se précipitent dans un confessionnal à la moindre faute.
-Pourtant, vous semblez avoir besoin de vous confier, Salaün, reprit Conwoïon patiemment. Je vous écoute. Nous sommes seuls...avec Dieu!
Salomon déambulait à grands pas saccadés autour du jardin si bien que Conwoïon, qui marchait de plus en plus mal, ne put le suivre. Il s’arrêta et attendit qu’il revienne vers lui.
-Suis-je devenu fou, Conwoïon? cria presque le roi en faisant demi-tour. J’entends la voix de mon cousin!
-Erispoë? n’est-ce pas plutôt celle de votre conscience? murmura Conwoïon atterré.
-Beau jargon d’homme d’Église, Conwoïon, ricana Salomon. Je sais que c’est celui que vous employez avec vos moines et vos ouailles. Pas avec moi! fit-il sourdement en rapprochant son visage d’une façon presque menaçante. Erispoë me parle vraiment !
-Bien, sire, rompit Conwoïon qui ne voulut pas l’irriter davantage. Je vous crois. L’avez-vous tué? ajouta-t-il tout à trac en fermant les yeux sous la colère qu’il allait attiser.
-Non! Non, Conwoïon, je ne l’ai pas tué, articula sourdement Salomon en accentuant chaque mot. C’est bien Almar, même si personne ne le croit. Mais je suis tout de même coupable. Je me sens coupable. Car j’ai désiré sa mort je ne sais combien de fois. Je voulais...je voulais tout ce qu’il avait, et je l’ai tué en pensée bien avant qu’Almar ne le fasse!
-Almar ne l’a-t-il pas fait...parce qu’il croyait que c’était ce que vous vouliez? osa Conwoïon.
-C’est pour ça que je suis coupable, l’abbé, même si je n’ai pas enfoncé l’épée. Et maintenant...
-Et maintenant vous êtes hanté par ce meurtre, n’est-ce pas? constata Conwoïon en regardant de côté le visage crispé, presque tétanisé du souverain.
Il se rappelait très bien les interrogations de Nominoë à son sujet, l’inquiétude de Maelcat devant les colères du jeune garçon qu’il éduquait avec Erispoë, puis son renvoi par le duc pour une raison qu’il avait toujours ignorée, et il se dit que le destin avait rattrapé l’homme, alors même que ses mentors avaient essayé d’inculquer à son adolescence tous les principes moraux qui étaient les leurs.
-Aidez-moi l’abbé! pria soudain Salomon.
Conwoïon soupira, accablé et impuissant. Comment morigéner un roi, un homme aussi rétif et autoritaire que Salomon, comment l’apaiser, et était-il seulement repentant de son acte?
-Vous repentez-vous de ce...de cet...
-Mais je ne cesse de le faire, Conwoïon! J’aimais Erispoë... même si je le détestais en même temps...Et je voudrais bien effacer ce jour-là...Je crois que je n’aurais plus jamais la paix maintenant, avoua-t-il dans un gémissement de bête.
-Vous entendez vraiment sa voix, roi Salomon?
-Vraiment, oui! répliqua-t-il fermement. Mais, après tout, vous avez peut-être raison...ce n’est sans doute que ma conscience qui se rebelle.
-Priez!
-Je prie, l’abbé, je prie...
-Repentez-vous, implorez Dieu, faites pénitence, énuméra Conwoïon à bout de forces. Et soyez plus humble, ajouta-t-il plus bas.
-N’est-ce pas ce que je suis venu faire dans votre monastère?.Mais Dieu...Dieu...
-Ne blasphémez pas! l’arrêta Conwoïon qui ne voulait pas entendre de paroles impies. Dieu écoute chacun de ses enfants...vous y compris, roi Salomon. Si vous y mettez le prix!
Conwoïon, épuisé par leur échange, s’assit sur la margelle du puits, la tête dans les mains. Salomon tourna les talons et s’éloigna.
-Merci l’abbé! Vous avez fait ce que vous avez pu. Nous nous reverrons bientôt. Demandez-moi ce dont vous avez besoin.
- J’ai surtout besoin de paix, Salaün, soupira tout bas Conwoïon accablé. Mais tu viens de me l’ôter à jamais!
Extrait "La Chevauchée Nominoë" 2001

Nominoë s’avança alors, seul sur son cheval, pour faire face aux hommes qui attendaient, silencieux et attentifs malgré le froid. Sa voix s’éleva et envahit le camp qu’il dominait de sa haute stature.
– Je vais vous emmener là où nous ne sommes jamais allés! Je vais vous conduire à la victoire! Car nous vaincrons les Francs cette fois, c’est une promesse! Je serai à votre tête, je vous guiderai, et ensemble nous nous libérerons du joug qui oppresse le peuple Breton. Vous n’aurez plus à obéir, plus à payer de tribut, plus à partager vos biens et vos récoltes avec la Francie! Vous serez enfin libres et si vous me faites confiance, je vous protégerai comme mes frères et mes enfants!
Vous êtes jeunes et braves, vous avez tous répondu à mon appel pour mettre vos bras et vos forces au service de votre terre et de votre duc. Vous êtes venus vous enrôler sous ma bannière avec vos chevaux, vos armes, vos équipements, et pour cela vous avez dû payer de votre personne et de vos biens...Je vous rendrai tout cela en victoires car nous aurons demain un pays libre de servitudes où vous serez vos propres maîtres sous le seul commandement du duc de Bretagne!...Vous êtes l’âme de ce pays. Restez unis et suivez-moi...
Il y eut un instant de silence étonné, un moment de flottement où les hommes se regardèrent, puis ils se mirent à frapper sur leurs boucliers noirs et scandèrent le nom de Nominoë d’une seule voix de gorge, sourde et rauque, comme un vent immense qui se met à souffler sur un champ de blé:
–Nominoë! Nominoë! Nominoë!
Ils répétaient ce nom comme s’il était magique, comme s’il était le talisman qui avaient le pouvoir de leur donner ce qu’ils attendaient le plus au monde depuis des générations, depuis la mort de leurs ancêtres, de leurs pères et de leurs frères, et ce nom était l’étendard blanc et noir qui se déployait dans le vent au-dessus de la tête de ce chef qu’ils s’étaient choisis et qui leur parlait de liberté. Il s’envolait jusque sous les pas des Francs qui galopaient dans la plaine pour venir les occire avec leurs angons. Il planait, s’amplifiait, devenait mugissement de démons:
–Nominoë! Nominoë! Nominoë!
Nominoë s’était tendu soudain, fixant l’horizon où les Francs allaient apparaître et, lorsque leur masse sombre et impressionnante fut à la distance qui le satisfaisait, il leva le bras, poussa un cri guttural et tous s’ébranlèrent derrière lui, sans laisser à l’armée franque le temps de reconnaître les lieux.
Érispoë commandait une aile avec ses cavaliers, Maelcat une autre, de part et d’autre de Nominoë qui conduisait le gros de la cavalerie, Rodald devant attaquer sur un autre flanc avec Brian et Anaugen. Les javelines partirent comme des éclairs, tandis que les Bretons surgissaient de partout à la fois, de tous côtés, en hurlant comme des sauvages.
La panique gagna aussitôt les archers saxons qui ne s’attendaient sans doute qu’à rencontrer une petite armée à pied et non des détachements de cavaliers qui lançaient des charges furieuses et furtives, et ils détalèrent pour aller se réfugier derrière leur cavalerie.
Les cavaliers francs s’apprêtèrent alors pour combattre comme ils le faisaient toujours, au corps à corps, mais Nominoë avait expressément défendu ce genre d’affrontement et il avait déjà fait faire demi-tour à ses chevaux. C’étaient de petits chevaux nerveux et rapides qu’il avait patiemment choisis et élevés depuis des années dans ses haras, et que les lourds destriers des Francs s’essoufflaient à poursuivre dans les marécages où ils allaient se perdre et s’enliser.
Puis Nominoë commanda le second lancer des javelines qui vinrent s’abattre sur leurs boucliers avec un bruit d’enfer. Il fit encore volte-face et repartit à nouveau l’attaque, harcelant sans répit l’adversaire franc, sans jamais l’approcher de trop près pour éviter les angons et les épées courtes au tranchant carré.
Les Francs, désemparés par cette inhabituelle tactique de fuite, de feinte, d’esquive et d’attaques surprises, finirent par s’arrêter pour se former en carré, pensant sans doute, en restant sur place, s’épargner une inutile et meurtrière poursuite qui les isolaient et les laissaient à merci. Un déluge de javelines s’abattit, tel que leurs boucliers ne purent parer, les transperçant de part en part jusqu’à ce qu’ils finissent par rompre les rangs et s’éparpiller en petites colonnes faciles à embrocher à bonne distance.
À la nuit, ils envoyèrent une bannière blanche pour demander une trêve que Nominoë, satisfait, accepta, afin de laisser également reposer ses hommes. Il y avait, chez les Francs, des morts et des blessés en grande quantité, et les Bretons, de leur camp, les virent achever leurs chevaux atteints, tandis que Nominoë se faisait remettre le bilan de ses propres pertes qui étaient faibles. Il rejoignit alors le chirurgien, apportant paroles de réconfort aux blessés et aux mourants auxquels il ferma les yeux, faisant soigner sur place, puis évacuer, ceux qui ne pouvaient plus monter à cheval.
Revenu dans sa tente, il convoqua tous les officiers chargés du commandement pour analyser les actions de la journée, commenta, rectifia, et lorsqu’ils furent partis avec leurs ordres, il félicita son fils pour sa bravoure et son endurance.
–Tu as été très bien, Érispoë! Veille à toujours garder le contact avec tes hommes et avec Maelcat, Brian, Anaugen et moi-même. Tu ne dois jamais te retrouver isolé par tes adversaires, donc en position de faiblesse et en danger. Tu dois t’arranger pour rester à porter de voix et de secours....Coordonnez tous vos actions d’attaque et de repli et suivez mes ordres...Demain nous retrouverons sans doute la même situation, mais il faudra gagner du terrain et faire une percée plus importante dans les rangs francs. Allez maintenant prendre du repos. Je vais parler aux soldats...
Suivi de ses compagnons, il parcourut à grands pas tout le camp où les hommes, étendus près des feux, tentaient de reposer leur corps endolori par des heures de monte et d’attaque, les remercia, les encouragea, répondit patiemment à leurs questions et s’enquit des chevaux. Il était toujours proche de ses hommes qui savaient pouvoir compter sur leur duc en n’importe quelle occasion. Il en profita pour faire le tri parmi les cavaliers blessés pour les remplacer par des troupes fraîches qu’il gardait en réserve.
Puis il ordonna le repos général, après avoir fait distribuer nourriture et bière, et fit patrouiller régulièrement les abords du camp pour éviter toute intrusion nocturne. Il vint s’étendre enfin sur sa couche auprès de Maelcat et de Brian, en leur serrant amicalement l’épaule et s’endormit paisiblement, la tente gardée par le fidèle Guérec qui en défendait l’accès.
Au lever du jour, il fut le premier debout, arpentant le camp pour réveiller les soldats qui se relevèrent aussitôt dans un petit matin froid et humide, sans maugréer, habitués aux façons de leur duc. Comme ses amis, il n’avait quitté que sa broigne pour dormir, et ils s’équipèrent à nouveau en hâte pour reprendre le combat là ou il était resté la veille.
Les Francs ne gagnèrent point de terrain, bien au contraire, ils ne parvinrent jamais à atteindre les cavaliers de Nominoë, s’éparpillant en vain, et s’enrageant de ces attaques éprouvantes qui laissaient de grands vides dans leurs rangs. Les allées et venues incessantes, la tactique énervante du duc, les laissaient désemparés et incertains, inquiets, et ils perdaient pied d’heure en heure. Mais rien de décisif n’était advenu au soir de ce second jour de combat et les deux camps se replièrent, comme la veille, sur leurs positions. Au petit matin, Nominoë secoua ses amis le jour à peine levé et leur montra le camp d’en face où les officiers francs s’agglutinaient autour de la tente royale en discutant âprement, attendant sans doute l’ordre de reprise du combat.
Charles avait-il décidé de les faire massacrer jusqu’au dernier pour avoir raison du duc breton ? Nominoë, immobile sur son cheval, impassible et confiant dans la supériorité de ses hommes, attendait, bien en vue devant son camp comme un dieu statufié.
Soudain un cri fut répété par plusieurs poitrines incrédules et affolées.
–Le roi est mort...le roi est mort...
Nominoë fronça les sourcils tandis qu’Érispoë, Maelcat, Brian et Anaugen venaient aux ordres.
–Avancez au pas! commanda-t-il tandis que les Bretons se rapprochaient du camp royal dont les officiers francs sortaient soudain à cheval, suivis bientôt par ceux qui pouvaient encore courir ou marcher et qui s’enfuyaient inexplicablement, laissant les blessés et les mourants sur place.
Toute la cavalerie bretonne s’élança et déferla dans le camp des Francs subitement abandonné. La tente royale était béante et vide, sauf le trésor qui y avait été laissé et Nominoë n’en crut pas ses yeux. Le roi Charles s’était enfui dans la nuit avec son escorte, sans même emporter son trésor de guerre afin de s’alléger et de ne pas donner l’alerte.
–Mettez ceci en lieu sûr et acheminez-le vers Vannes. Nous, nous continuons!...
Tous s’élancèrent à la suite de Nominoë qui galopait à la poursuite des fuyards, et Erispoë se mit à rire en chevauchant au flanc de la monture de son père, car il savait, comme tous les compagnons du duc, qu’ils venaient de remporter une grande victoire qui allait faire date en Bretagne.
Les hommes ne firent guère de quartiers, ils laissèrent la vie sauve à ceux qui pouvaient la payer, mais les autres furent impitoyablement massacrés, résultat de la grande tension de ces deux journées de combat.
Nominoë fit envoyer les prisonniers à Vannes, en longues colonnes sous bonne escorte, avec le trésor, tandis qu’il tournait à nouveau sa monture vers la Francie pour emmener l’armée envahir les territoires proches qui furent aisément soumis jusqu’à la Mayenne. Le roi Franc s’étant enfui lâchement devant lui, Nominoë voulait pousser son avantage sans perdre de temps pour soumettre les comtés qui bordaient son territoire où il laissa quelques contingents de Bretons pour les occuper.
– Je vais vous emmener là où nous ne sommes jamais allés! Je vais vous conduire à la victoire! Car nous vaincrons les Francs cette fois, c’est une promesse! Je serai à votre tête, je vous guiderai, et ensemble nous nous libérerons du joug qui oppresse le peuple Breton. Vous n’aurez plus à obéir, plus à payer de tribut, plus à partager vos biens et vos récoltes avec la Francie! Vous serez enfin libres et si vous me faites confiance, je vous protégerai comme mes frères et mes enfants!
Vous êtes jeunes et braves, vous avez tous répondu à mon appel pour mettre vos bras et vos forces au service de votre terre et de votre duc. Vous êtes venus vous enrôler sous ma bannière avec vos chevaux, vos armes, vos équipements, et pour cela vous avez dû payer de votre personne et de vos biens...Je vous rendrai tout cela en victoires car nous aurons demain un pays libre de servitudes où vous serez vos propres maîtres sous le seul commandement du duc de Bretagne!...Vous êtes l’âme de ce pays. Restez unis et suivez-moi...
Il y eut un instant de silence étonné, un moment de flottement où les hommes se regardèrent, puis ils se mirent à frapper sur leurs boucliers noirs et scandèrent le nom de Nominoë d’une seule voix de gorge, sourde et rauque, comme un vent immense qui se met à souffler sur un champ de blé:
–Nominoë! Nominoë! Nominoë!
Ils répétaient ce nom comme s’il était magique, comme s’il était le talisman qui avaient le pouvoir de leur donner ce qu’ils attendaient le plus au monde depuis des générations, depuis la mort de leurs ancêtres, de leurs pères et de leurs frères, et ce nom était l’étendard blanc et noir qui se déployait dans le vent au-dessus de la tête de ce chef qu’ils s’étaient choisis et qui leur parlait de liberté. Il s’envolait jusque sous les pas des Francs qui galopaient dans la plaine pour venir les occire avec leurs angons. Il planait, s’amplifiait, devenait mugissement de démons:
–Nominoë! Nominoë! Nominoë!
Nominoë s’était tendu soudain, fixant l’horizon où les Francs allaient apparaître et, lorsque leur masse sombre et impressionnante fut à la distance qui le satisfaisait, il leva le bras, poussa un cri guttural et tous s’ébranlèrent derrière lui, sans laisser à l’armée franque le temps de reconnaître les lieux.
Érispoë commandait une aile avec ses cavaliers, Maelcat une autre, de part et d’autre de Nominoë qui conduisait le gros de la cavalerie, Rodald devant attaquer sur un autre flanc avec Brian et Anaugen. Les javelines partirent comme des éclairs, tandis que les Bretons surgissaient de partout à la fois, de tous côtés, en hurlant comme des sauvages.
La panique gagna aussitôt les archers saxons qui ne s’attendaient sans doute qu’à rencontrer une petite armée à pied et non des détachements de cavaliers qui lançaient des charges furieuses et furtives, et ils détalèrent pour aller se réfugier derrière leur cavalerie.
Les cavaliers francs s’apprêtèrent alors pour combattre comme ils le faisaient toujours, au corps à corps, mais Nominoë avait expressément défendu ce genre d’affrontement et il avait déjà fait faire demi-tour à ses chevaux. C’étaient de petits chevaux nerveux et rapides qu’il avait patiemment choisis et élevés depuis des années dans ses haras, et que les lourds destriers des Francs s’essoufflaient à poursuivre dans les marécages où ils allaient se perdre et s’enliser.
Puis Nominoë commanda le second lancer des javelines qui vinrent s’abattre sur leurs boucliers avec un bruit d’enfer. Il fit encore volte-face et repartit à nouveau l’attaque, harcelant sans répit l’adversaire franc, sans jamais l’approcher de trop près pour éviter les angons et les épées courtes au tranchant carré.
Les Francs, désemparés par cette inhabituelle tactique de fuite, de feinte, d’esquive et d’attaques surprises, finirent par s’arrêter pour se former en carré, pensant sans doute, en restant sur place, s’épargner une inutile et meurtrière poursuite qui les isolaient et les laissaient à merci. Un déluge de javelines s’abattit, tel que leurs boucliers ne purent parer, les transperçant de part en part jusqu’à ce qu’ils finissent par rompre les rangs et s’éparpiller en petites colonnes faciles à embrocher à bonne distance.
À la nuit, ils envoyèrent une bannière blanche pour demander une trêve que Nominoë, satisfait, accepta, afin de laisser également reposer ses hommes. Il y avait, chez les Francs, des morts et des blessés en grande quantité, et les Bretons, de leur camp, les virent achever leurs chevaux atteints, tandis que Nominoë se faisait remettre le bilan de ses propres pertes qui étaient faibles. Il rejoignit alors le chirurgien, apportant paroles de réconfort aux blessés et aux mourants auxquels il ferma les yeux, faisant soigner sur place, puis évacuer, ceux qui ne pouvaient plus monter à cheval.
Revenu dans sa tente, il convoqua tous les officiers chargés du commandement pour analyser les actions de la journée, commenta, rectifia, et lorsqu’ils furent partis avec leurs ordres, il félicita son fils pour sa bravoure et son endurance.
–Tu as été très bien, Érispoë! Veille à toujours garder le contact avec tes hommes et avec Maelcat, Brian, Anaugen et moi-même. Tu ne dois jamais te retrouver isolé par tes adversaires, donc en position de faiblesse et en danger. Tu dois t’arranger pour rester à porter de voix et de secours....Coordonnez tous vos actions d’attaque et de repli et suivez mes ordres...Demain nous retrouverons sans doute la même situation, mais il faudra gagner du terrain et faire une percée plus importante dans les rangs francs. Allez maintenant prendre du repos. Je vais parler aux soldats...
Suivi de ses compagnons, il parcourut à grands pas tout le camp où les hommes, étendus près des feux, tentaient de reposer leur corps endolori par des heures de monte et d’attaque, les remercia, les encouragea, répondit patiemment à leurs questions et s’enquit des chevaux. Il était toujours proche de ses hommes qui savaient pouvoir compter sur leur duc en n’importe quelle occasion. Il en profita pour faire le tri parmi les cavaliers blessés pour les remplacer par des troupes fraîches qu’il gardait en réserve.
Puis il ordonna le repos général, après avoir fait distribuer nourriture et bière, et fit patrouiller régulièrement les abords du camp pour éviter toute intrusion nocturne. Il vint s’étendre enfin sur sa couche auprès de Maelcat et de Brian, en leur serrant amicalement l’épaule et s’endormit paisiblement, la tente gardée par le fidèle Guérec qui en défendait l’accès.
Au lever du jour, il fut le premier debout, arpentant le camp pour réveiller les soldats qui se relevèrent aussitôt dans un petit matin froid et humide, sans maugréer, habitués aux façons de leur duc. Comme ses amis, il n’avait quitté que sa broigne pour dormir, et ils s’équipèrent à nouveau en hâte pour reprendre le combat là ou il était resté la veille.
Les Francs ne gagnèrent point de terrain, bien au contraire, ils ne parvinrent jamais à atteindre les cavaliers de Nominoë, s’éparpillant en vain, et s’enrageant de ces attaques éprouvantes qui laissaient de grands vides dans leurs rangs. Les allées et venues incessantes, la tactique énervante du duc, les laissaient désemparés et incertains, inquiets, et ils perdaient pied d’heure en heure. Mais rien de décisif n’était advenu au soir de ce second jour de combat et les deux camps se replièrent, comme la veille, sur leurs positions. Au petit matin, Nominoë secoua ses amis le jour à peine levé et leur montra le camp d’en face où les officiers francs s’agglutinaient autour de la tente royale en discutant âprement, attendant sans doute l’ordre de reprise du combat.
Charles avait-il décidé de les faire massacrer jusqu’au dernier pour avoir raison du duc breton ? Nominoë, immobile sur son cheval, impassible et confiant dans la supériorité de ses hommes, attendait, bien en vue devant son camp comme un dieu statufié.
Soudain un cri fut répété par plusieurs poitrines incrédules et affolées.
–Le roi est mort...le roi est mort...
Nominoë fronça les sourcils tandis qu’Érispoë, Maelcat, Brian et Anaugen venaient aux ordres.
–Avancez au pas! commanda-t-il tandis que les Bretons se rapprochaient du camp royal dont les officiers francs sortaient soudain à cheval, suivis bientôt par ceux qui pouvaient encore courir ou marcher et qui s’enfuyaient inexplicablement, laissant les blessés et les mourants sur place.
Toute la cavalerie bretonne s’élança et déferla dans le camp des Francs subitement abandonné. La tente royale était béante et vide, sauf le trésor qui y avait été laissé et Nominoë n’en crut pas ses yeux. Le roi Charles s’était enfui dans la nuit avec son escorte, sans même emporter son trésor de guerre afin de s’alléger et de ne pas donner l’alerte.
–Mettez ceci en lieu sûr et acheminez-le vers Vannes. Nous, nous continuons!...
Tous s’élancèrent à la suite de Nominoë qui galopait à la poursuite des fuyards, et Erispoë se mit à rire en chevauchant au flanc de la monture de son père, car il savait, comme tous les compagnons du duc, qu’ils venaient de remporter une grande victoire qui allait faire date en Bretagne.
Les hommes ne firent guère de quartiers, ils laissèrent la vie sauve à ceux qui pouvaient la payer, mais les autres furent impitoyablement massacrés, résultat de la grande tension de ces deux journées de combat.
Nominoë fit envoyer les prisonniers à Vannes, en longues colonnes sous bonne escorte, avec le trésor, tandis qu’il tournait à nouveau sa monture vers la Francie pour emmener l’armée envahir les territoires proches qui furent aisément soumis jusqu’à la Mayenne. Le roi Franc s’étant enfui lâchement devant lui, Nominoë voulait pousser son avantage sans perdre de temps pour soumettre les comtés qui bordaient son territoire où il laissa quelques contingents de Bretons pour les occuper.
Extrait : Les destins veulent changer de chevaux
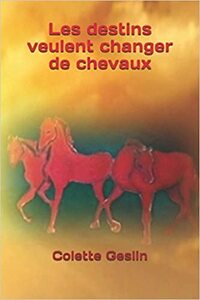
–Monsieur l’ambassadeur! appela Guillaume en me rejoignant à l’avant du bateau.
Il n’y avait pas de passager sur le pont arrière où je m’étais réfugié depuis notre départ du Pirée, et je cherchais à distinguer les côtes de la Voloraquie vers lesquelles nous nous dirigions. De temps à autre une vague plus forte projetait des paquets d’embruns jusqu’au bastingage et je reculais machinalement pour éviter d’être trempé à l’arrivée.
Nous étions partis du port au lever du jour et Guillaume, après s’être occupé de nos bagages, avait disparu un long moment, sans doute pour visiter le navire et parler aux voyageurs assis à l’abri du vent dans la cabine principale, car je savais qu’il pratiquait très bien le grec.
–Monsieur l’ambassadeur! reprit-il en me touchant l’épaule. Le capitaine serait très honoré si vous acceptiez de prendre un verre au poste de pilotage avant l’accostage.
–Guillaume, pour l’amour du ciel, cessez de m’appeler ainsi lorsque nous sommes seuls! dis-je d’un ton faussement réprobateur.
–Non! répliqua t-il d’un air obstiné. Vous devez vous y habituer très vite car je ne veux pas que vous commettiez d’impair lorsque nous serons à Volos!
–N’êtes-vous pas là pour me rappeler à l’ordre, le cas échéant, mon cher Guillaume ? fis-je avec un rien d’ironie amicale.
Guillaume plissa les yeux et se mit à rire sans s’offusquer, et c’est en partie pour cela que je m’étais pris d’amitié pour lui qui allait être mon second et mon mentor, mon Conseiller d’Ambassade, puisque tel était son titre désormais, comme le mien était devenu celui d'Ambassadeur en Voloraquie.
–Nous arriverons à Volos dans une heure environ, d'après le capitaine.
–Il me semble que vous avez déjà discuté un grand moment avec lui pour que vous jugiez nécessaire de m'entraîner à boire à cette heure matinale.
–Il n'est pas si tôt que cela, protesta Guillaume en me précédant vers le poste où le capitaine nous attendait derrière sa vitre. Et je vous assure que j'ai appris des choses très instructives.
Le capitaine du "Prométhée", qui faisait la desserte de Volos avec les côtes grecques, était un Grec un peu corpulent dans son tricot bleu marine, le visage tanné sous la casquette, les cheveux gris et un sourire affable aux lèvres.
–Monsieur l’ambassadeur! s'exclama-t-il. Je ne savais pas qui vous étiez, sans cela je vous aurais salué à votre arrivée à bord. Pardonnez-moi cette pauvre hospitalité le jour même de votre venue sur l'île.
–Vous êtes tout pardonné, capitaine, d'autant plus que j'avais l'intention de voyager discrètement. Mais il semble que je n'y sois pas réellement parvenu, ajoutai-je en jetant un regard de côté à Guillaume qui m'ignora pour contempler la mer.
–Je viens d'apprendre que vous êtes nommé en Voloraquie, s'étonna le capitaine, en un anglais très acceptable.
Contrairement à Guillaume, je ne parlais pas le grec et les quelques mots de voloraque que l'on m'avait enseignés avant mon départ, en attendant la mise au point d’un conversophone qui devait nous être livré plus tard, étaient bien pauvres pour soutenir une conversation.
–Je ne me souviens pas d'y avoir vu un seul Ambassadeur, et nous n'y avons nous-mêmes qu'un Consul. C'est une île étrange, ajouta-t-il après un léger silence, qui a subi diverses infortunes et un gouvernement militaire assez dur jusqu'à la fin du siècle dernier où le vieux général Achillès l'a rendue au roi descendant de la famille franque de Jonvel. Actuellement nous ne savons pas très bien qui gouverne, car le roi Ambros ne semble pas avoir les coudées franches! Il y a des partis agités, des opposants, des hommes difficiles sur l'île... un en particulier dont il faudra vous méfier, monsieur l’ambassadeur. Le Général Zia, ministre des Affaires Intérieures, qui dirige aussi les forces de police! Prenez garde à cet homme-là, j'ai déjà eu à faire à lui et je n'en garde pas un bon souvenir, termina-t-il d'un ton sombre en me tendant un verre du célèbre ouzo que les grecs appréciaient tant, mais que je me voyais mal avaler au cœur de la matinée et en pleine mer.
Guillaume choqua courtoisement son verre contre celui du capitaine, puis contre le mien, en me faisant le signe discret de le porter à mes lèvres. Il savait fort bien que je ne buvais guère d'alcool mais sans doute avait-il jugé, fort de sa mission, qu'il était nécessaire de sacrifier à ce rite qui pouvait nous faire un précieux ami et un allié du capitaine du "Prométhée".
–Je reviens sur l'île chaque semaine, expliquait celui-ci, pour apporter des marchandises à mon frère Iannis, qui tient un magasin général sur le port. Je transporte aussi quelques voyageurs, mais guère de touristes car les audacieux qui se présentent en Voloraquie sont vite arrêtés et reconduits au quai pour y être embarqués.
–Les habitants ne sont pas accueillants? m'étonnai-je en reposant discrètement mon verre.
–Les habitants? Si!... Le général et ses sbires, non! Zia mène une action sévère pour tenir l'île à l'écart et ne fait aucun effort pour les étrangers, bien au contraire. Quelques-uns ont même goûté à ses prisons pour des vétilles. Si bien que le bouche à oreille fonctionne, et peu de gens ne s'y hasardent désormais. Zia a obtenu ce qu'il voulait par la peur.
–Mais le roi ?
-Oh! Il ne doit pas savoir tout cela et, même s'il le sait, ou le soupçonne, il ne peut guère l'empêcher! fit le capitaine avec une grimace significative.
–Je vois!
En fait, je ne voyais pas très bien le but de Zia pour isoler l'île de cette façon, mais je ne pouvais guère en discuter avec le capitaine, et Guillaume devait avoir glané d'autres informations intéressantes qu'il me distillerait plus tard.
Je commençais à le connaître un peu mieux et je convenais, en mon fort intérieur, qu'il eût sans doute été plus apte à ce poste que je ne l'étais moi-même. Mais c'était moi que l'on avait réclamé, moi que l'on envoyait en Voloraquie et il fallait me glisser peu à peu dans le personnage d'ambassadeur que je représentais maintenant aux yeux des autres.
–Si vous avez besoin de moi, ou si vous devez me confier un message ou un paquet, ajouta le capitaine, vous n'aurez qu'à avertir Iannis au port à cette adresse. C'est un Grec, c'est mon frère, et il sera pour vous de toute confiance. D'ailleurs vous serez condamné à le fréquenter puisqu'il a le seul magasin bien achalandé de Volos! rit-il bruyamment. Il saura où me joindre.
–Entendu capitaine! Nous ne vous oublierons pas, fit Guillaume en lui glissant sous le bras une boite de cigares qu'il venait de faire apparaitre comme par enchantement. Fumez-les en pensant à nous. Nous vous donnerons des nouvelles plus tard. Je compris que Guillaume venait de nouer habilement une relation qui pourrait nous être utile, car le capitaine se rappellerait de nous, et j'appréciai sa convivialité qui allait m'aider à Volos.
Nous accostâmes une demi-heure plus tard après avoir longé, sur une face de l'île, des baies superbes aux eaux claires, des plages comme des écrins, enchâssées dans la verdure, si désertes et si calmes que je me promis de venir sans tarder à leur découverte.
Autant que je pus en juger, cette partie de la côte était verdoyante et boisée, quelques petits villages coupaient de leur blancheur le vert profond de la végétation et, dans le lointain, de majestueuses montagnes signalaient le cœur de la Voloraquie où leurs sommets violacés et brumeux semblaient se confondre avec le ciel.
Lorsque nous eûmes atteint la pointe de l'île, le paysage changea quelque peu et nous sûmes ainsi que nous approchions de Volos. Les habitations se firent de plus en plus denses, la végétation plus rare, là où les forêts avaient dû être défrichées autrefois pour édifier une ville, un port, des forts, et une citadelle qui remontait au temps des Croisés et à la présence franque.
La vieille Citadelle, devenue aujourd'hui le Palais Royal, se dressait de toute sa hauteur impressionnante, au bord de hauts rochers. La tour carrée semblait en bon état mais sans doute avait-elle été restaurée, la pierre, ocre, luisait dans le soleil et les dentelures des créneaux couronnaient le tout en majesté. C'était un beau château, un peu lourd comme on les construisait alors, fait pour défier le temps et les attaques et je ne pus qu'admirer béatement ce chef d'oeuvre. Lorsque le bateau s'en écarta pour aller s'ancrer dans le port, je quittai à regret cette vision qui plongeait dans le lointain passé de la Voloraquie.
–Déjà conquis, monsieur l’ambassadeur? fit Guillaume qui avait surpris ma rêverie.
–C'est une merveille, Guillaume! fis-je sans cacher mon enthousiasme. Je ne sais s'il y a encore d'autres constructions de cette époque, mais celle-là...
Il savait combien j'aimais les châteaux, les ruines et autres vestiges du passé, pour lui avoir parlé de mon enfance à Korkikian, manoir ancestral de ma famille, peu de temps avant notre départ de Paris.
–Il y en a, mon cher Quentin! répliqua Guillaume d'un air réjoui. Le capitaine m'a parlé de plusieurs forts et d'anciens monastères, certains désaffectés, d'autres encore occupés par des moines orthodoxes et catholiques. Bien sûr, beaucoup de ces bâtiments ont souffert pendant la guerre au siècle dernier et ont été bombardés. La Citadelle elle-même, que vous admirez tant, a été endommagée et c'est Volmar, père du roi actuel, qui l'a fait reconstruire en partie lors de son retour sur l'île. Nous aurons sûrement l'occasion de visiter ces vestiges...si le général Zia le permet, bien entendu.
Je n'eus pas le temps de répondre à cette dernière boutade, qui n'en était peut-être pas vraiment une, car le bateau avait accosté et un groupe de policiers vêtus d'uniformes gris s'empressait de monter à bord, interdisant par gestes autoritaires toute tentative de descente sur le quai.
Ils se dirigèrent droit sur le capitaine qui, résigné et fataliste, avait perdu son sourire et ils l'interrogèrent assez âprement à ce qu'il me sembla.
Il finit par nous désigner, avec un haussement d'épaules et un regard désolé dans ma direction, et nous fûmes à notre tour la cible de cette escouade policière.
Le plus gradé d'entre eux, après nous avoir jaugé du regard et sans se tromper aucunement, s'avança pour me saluer d'un geste sec, presque violemment et sans aucune aménité et il s'adressa à moi en grec, ou en voloraque, signe évident de malignité et de mauvaise volonté puisqu'il ne pouvait ignorer ma nationalité.
Je fis une grimace d'incompréhension en me gardant bien de me retourner vers Guillaume dont le silence indiquait expressément qu'il jouait mon jeu et n'avait nulle intention de traduire et de leur révéler qu'il parlait le grec . Le policier arrogant dut se résoudre finalement, après diverses pantomimes, à parler en un mauvais anglais que je consentis à comprendre.
–Vous n'avez pas prévenu de votre arrivée par ce bateau, éructa t-il. Quels bagages avez-vous? Ouvrez-les je vous prie!
–Je regrette, euh!...commandant! fis-je à tout hasard, ne sachant pas son grade et préférant le flatter plutôt que l'abaisser. Vous connaissez mon rang d'ambassadeur de France et je ne suis pas tenu de vous ouvrir mes bagages.
–Ici, les lois sont différentes, sir! répliqua t-il avec une lueur d'orage dans les yeux. Vous êtes désormais en Voloraquie!
–Je le sais bien, commandant, repris-je avec patience et en affectant même une certaine nonchalance toute britannique. Et je suis certain de votre grande hospitalité. Je vous remercie d'être venu m'accueillir si...aimablement. Puis-je solliciter votre escorte pour me rendre jusqu'à l'ambassade?
–Je...je ne suis pas ici pour...commença l'homme qui s'empourpra. Puis il se tut soudainement et un mouvement sur la passerelle attira mon attention.
Une dizaine de soldats, dans un autre uniforme qui me sembla être celui de l'armée, prenaient pied à leur tour sur le pont et le capitaine se hâtait cette fois à leur rencontre, ce qui me sembla de bon augure. Ils suivaient un homme de très haute stature, puissant et bâti en athlète, aux traits assez accusés et aux pommettes hautes de Mongol, et j'entendis Guillaume murmurer derrière moi avec un rien d'ironie:
–Cette fois, c'est Rambo!, en faisant allusion à un célèbre acteur américain de la fin du siècle dernier, qui avait joué un personnage de justicier aux pectoraux impressionnants.
Je me gardai bien de sourire à ce trait d'esprit qui visait à me détendre et je m'appliquai à ne montrer aucune nervosité. L'officier avança droit sur mon interlocuteur, le toisant d'une bonne tête avec un air déterminé et froid, et je ne pus m'empêcher de penser que l'autre ne devait pas faire le poids et qu'il allait s'effacer.
–Commissaire! Ces passagers sont des hôtes de marque...l'ambassadeur de France à Volos et son Conseiller! Ils sont attendus par le roi et je me chargerai moi-même de leur sécurité. Merci de vous être déplacé!
–Colonel! salua le dit commissaire avec raideur en faisant signe à ses hommes de le suivre. Je ne m'étais pas trompé sur l'issue de l'entrevue qui avait été brève, et je les vis s'éloigner avec soulagement tandis que le géant militaire se présentait.
–Colonel Josef Grikos, pour vous servir, monsieur l’ambassadeur. Je suis envoyé par le prince Giorgio. Le roi était souffrant ce matin et le prince est resté auprès de lui. Mais il vous recevra ce soir. En attendant je vais vous conduire à votre Ambassade.
Son ton, pour s'adresser à moi, était devenu amène et courtois et je ne sus m'expliquer pourquoi il me parut fiable.
–Capitaine, continua t-il, voulez-vous faire descendre les bagages de monsieur l’ambassadeur? Mes hommes s'en occuperont ensuite.
Le capitaine du "Prométhée" s'inclina lui aussi, avec un rien de déférence qui confirma mon opinion sur le colonel et il vint me serrer la main.
–Partez tranquilles avec le colonel Grikos, monsieur l’ambassadeur. C'est l'homme de confiance du prince Giorgio et il a beaucoup d'influence dans l'île. Vous serez en sécurité avec lui.
Après la petite scène sur le pont avec les policiers, que mon rang d'ambassadeur ne semblait pas avoir impressionnés, je commençai à croire que ses avertissements de tout à l’heure étaient fondés et je compris qu'il serait bon de nous tenir sur nos gardes.
Extrait : Le voyageur du fond des Temps
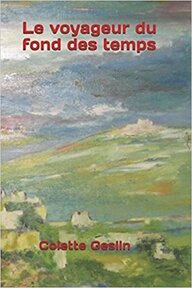
Lorsqu’elle est née, ses parents l’ont appelée Merline, à cause de cette étrange impression qu’ils avaient de dialoguer avec elle comme si elle leur soufflait ce qu’elle pensait et voulait... alors qu’elle ne savait même pas encore parler et qu’elle n’était, bien sûr, qu’un petit morceau de chair issu de leurs propres corps.
En fait, elle était beaucoup plus que cela, mais ils ne le surent réellement que longtemps plus tard, car rien ne les avaient préparés à cette découverte.
Jade devint proprement amoureuse de sa fille à la maternité, et Ambrose Cardeillac, son mari, astrophysicien respecté dans les milieux scientifiques, sourit de cet emportement maternel, bien qu’ému lui-même jusqu’aux entrailles par cette naissance qu’il n’espérait plus.
Cela faisait des années qu’ils essayaient en vain d’avoir un enfant et Jade, de fausses-couches en avortements spontanés, peut-être dus à la vie désorganisée de pianiste qu’elle devait mener de villes en pays différents, avait presque renoncé lorsque le médecin lui confirma enfin qu’elle était enceinte de quatre mois et que le fœtus, pour une fois, se portait bien!
Elle aussi se porta bien, et de mieux en mieux au fur et à mesure où l’enfant se développait en elle et, lorsque l’échographie lui révéla que ce serait une fille, qui naîtrait à l’aube de l’an 2020, elle la nomma tout bas l’Enchanteresse, tant sa vie semblait avoir pris un cours nouveau.
Pianiste dans un orchestre réputé, et fort sollicitée par les plus grands Chefs, elle ne cessa pas de jouer durant toute sa grossesse comme si l’enfant qui était en elle l’inspirait et magnifiait son jeu.
–J’ai l’impression d’être portée par quelque chose d’incompréhensible, expliqua-t-elle à Ambrose, étonné de sa virtuosité et de son appétit inlassable pour répéter, improviser et s’entraîner à son piano. C’est comme si cette enfant me soufflait ce qu’il faut faire pour être meilleure.
–C’est seulement le bonheur, Jade! sourit Ambrose. Cet intense bonheur qui fait que l’on se surpasse et que l’on trouve en soi des ressources inconnues.
-Peut-être... Peut-être!
Mais Jade n’était qu’à demi satisfaite de cette explication de ses progrès qui la propulsaient soudain au premier rang des pianistes de concert.
La chance de la renommée vint lorsqu’elle dut remplacer l’une des plus grandes pianistes américaines souffrante, alors qu’elle-même en était à son septième mois de grossesse. Elle mit une longue robe blanche, ample pour cacher son ventre arrondi, rassura le maestro qui s’inquiétait de savoir si son état lui permettrait de tenir toute la soirée, et fut éblouissante.
La salle applaudit la nouvelle étoile et les critiques s’enflammèrent au moment même où Jade sut qu’elle allait mettre sa fille au monde avec un bon mois d’avance!
Elle refusa d’être anesthésiée et le bébé naquit presque sans douleur. Jade fit appeler Ambrose dès qu’on lui remit sa fille entre les bras, et l’enfant ouvrit immédiatement les yeux sur leurs deux visages, contrairement aux nouveaux nés qui gardent obstinément les paupières closes.
–Elle nous dit qu’elle est...une bulle! s’étonna Jade.
Et Ambrose, qui avait perçu lui-même le message, ne sut que répondre à cette étrangeté. Le bébé referma tout de suite les yeux et ils crurent avoir rêvé ce regard curieux, si vivant, qui les fixait comme s’il venait d’un au-delà inconnu.
Jade emmena sa fille partout avec elle lorsqu’elle reprit ses concerts, et l’enfant assista ainsi aux répétitions, parfois fort longues et fatigantes, surveillée par une femme engagée pour s’occuper d’elle. Elle ne pleurait ni ne s’impatientait jamais, et Jade la regardait souvent en jouant, comme si elle puisait en elle quelque force, quelque génie secret.
Merline, puisqu’on l’appelait ainsi, bien qu’elle ait aussi été déclarée sous le nom peu commun de Bulle, et sous celui de Yu qui se transférait de génération en génération dans la famille chinoise de Jade, était dans les coulisses chaque soir de grand concert, avec son père, et ils restaient tous les deux, main dans la main, comme s’ils portaient ensemble Jade, isolée dans le halo de lumière sur la scène.
Aubin Cardeillac, le père d’Ambrose, qui était biologiste, aimait à dire que l’enfant avait l’oreille musicale et qu’elle serait une pianiste prodige pour peu qu’elle veuille jouer un jour. Mais personne n’avait encore vu Merline toucher au piano de sa mère!
Elle accompagnait son grand-père parfois à son laboratoire, regardait, comme si elle comprenait, les analyses qu’on y faisait, posait des questions si sensées que les laborantins lui répondaient le plus sérieusement du monde malgré son jeune âge, et Aubin considérait sa petite-fille avec une certaine perplexité mélangée d’une sourde inquiétude comme s’il s’agissait là d’un phénomène inexplicable.
Merline s’exprima très tôt, sans jamais pratiquer le parler-bébé des autres enfants et, au vu de sa capacité à apprendre, Jade et Ambrose décidèrent de retarder son entrée à l’école afin de ne pas lui infliger le pensum d’une classe maternelle où elle eût sûrement été peu à sa place.
Elle n’entra donc en programme scolaire qu’en sachant parfaitement lire et écrire, et fut une élève brillante que ses parents soupçonnèrent bientôt de dissimuler des compétences beaucoup plus étendues, pour se mettre à l’égal des autres afin de ne pas attirer l’attention.
–Merline sait plus de choses qu’on ne croit! constata Ambrose un soir alors qu’ils veillaient près du feu. Elle est de loin plus intelligente que la plupart des enfants, mais semble refuser de se mettre en avant...comme si elle voulait cacher quelque chose.
–Mais elle n’a guère que huit ans, Ambrose, et elle ne peut quand même pas être surdouée en toutes matières! murmura Jade.
–Aubin dit qu’elle affectionne particulièrement son laboratoire et qu’elle manipule dans son coin certaines éprouvettes sans vouloir s’expliquer et sans rien ne demander à personne.
–Elle ne joue pas de piano, remarqua Jade pensive, mais elle semble connaître toutes mes partitions par cœur et, parfois, elle m’indique et me suggère silencieusement quelque passage à travailler. C’est une sorte de communication intérieure entre nous comme si elle me permettait de capter les mouvements de son esprit! C’est difficile à expliquer et je ne peux pas en parler à d’autres que toi sous peine de passer pour folle ou illuminée.
–J’ai déjà ressenti moi-même cette transmission avec Merline, avoua Ambrose un rien embarrassé. Peut-être pourrons-nous en parler avec elle plus tard, lorsqu’elle sera plus âgée... si l’âge veut dire quelque chose dans son cas!
Merline avait également une singularité qui intriguait ses parents. Ses yeux, très clairs et presque transparents, prenaient parfois une intensité et une luminosité insoutenable, si bien qu’elle fuyait le regard des gens qui la tenaient pour timide.
Ambrose finit par s’inquiéter de la gêne qu’il ressentait chez sa fille et, pour avoir observé cet éclair qui jaillissait dans des circonstances particulières, il décida de l’aider en lui proposant des lunettes teintées assorties à ses vêtements.
Merline qui ne réclamait jamais rien de ce qu’aimaient les enfants de son âge, parut approuver l’offre et Ambrose l’emmena dès le lendemain choisir des montures de formes diverses pourvues de verres colorés. Elle les mit désormais presque continuellement, surtout lorsqu’elle était en présence de quelqu’un, et son père devina un soulagement sensible dans le fait de se cacher derrière un écran.
Il avait vu cet éclat étrange qui faisait briller et phosphorer ses yeux dans la nuit, comme ceux d’un chat, et ne cessait de se poser des questions sur sa fille, par ailleurs facile à vivre et d’un caractère égal et sans caprice. Jamais il ne la vit se mettre en colère et rien ne l’alerta vraiment jusqu’à ce premier incident dramatique où il comprit que Merline était bien autre chose qu’une fillette de neuf ans.
Jade venait de terminer un concert et il était tard dans la nuit lorsqu’ils retournèrent tous les trois au parking pour y reprendre leur voiture. La longue robe de scène de Jade, brodée de perles, bruissait doucement à chacun de ses pas, et Merline marchait entre eux, la main dans celle de son père.
Ambrose la sentit soudain se crisper et se figer comme en alerte. Elle s’arrêta et souffla :
–Attention, on nous suit. Quelqu’un d’agressif...
Au même instant, deux hommes surgirent de l’allée, derrière les voitures, vêtus de blousons et de jeans, de ceinturons et de bottes, cheveux coupés ras comme certaines bandes l’affectionnaient, l’air inquiétant et décidé.
Ambrose, plus tard, eut du mal à reconstituer la scène. Il fut empoigné par l’un d’eux qui le frappa violemment au ventre et au visage, tandis que l’autre, négligeant Merline, attrapait Jade et déchirait sa robe en ricanant, la renversant sur le capot d’une voiture dans l’intention de la violer.
Jade hurla et son cri retentit fortement dans la nuit tandis qu’Ambrose, sonné par les coups et aveuglé par le sang qui jaillissait de sa pommette et de son arcade sourcilière fendues, taraudé par la douleur d’un coup de pied à l’aine, cherchait en vain à se relever. Son seul cri fut pour Merline, mais il ne sut s’expliquer s’il craignait pour elle ou s’il l’appelait au secours.
–Merline!...
*
« La Force est en moi! Je dois l’utiliser maintenant. Le temps est venu. Bulle, tu peux essayer ce pouvoir de tes yeux et de ton bras. Ces bulles sont mauvaises...elles doivent être éliminées! »
Merline comprend que le moment est venu pour elle. Elle sait depuis longtemps qu’elle est différente, mais elle s’applique à le cacher aux autres et à ses parents pour ne pas les inquiéter.
Ses yeux voient des choses secrètes que les humains ne peuvent percevoir, son cerveau enregistre et retient les données, puis les mémorise et restitue fidèlement ce qu’elle désire lorsqu’elle le lui commande.
Ses mains, qu’elle a déjà essayé dans les bois lorsqu’elle est seule, ont une force qu’elle ne sait pas encore bien maîtriser et elle tremble à la pensée d’un geste qui pourrait la trahir et contrevenir aux règles édictées par la société dans laquelle elle se trouve plongée. Elle est sûre que ses parents l’aideraient, à défaut de la comprendre, mais elle recule le moment de les entraîner dans son monde et de mettre ce poids sur leurs épaules.
Maintenant elle ne peut plus attendre. Le danger est là qui menace Jade et Ambrose. Elle doit utiliser cette Force, même si elle ne sait pas encore en contrôler la puissance, et son corps s’apprête pour cette transformation.
Sa voix retentit dans le parking désert, calme, décidée, différente, et Ambrose l’entend comme si elle venait de très loin.
–Lâchez-les tous les deux!
Ce n’est plus une voix d’enfant, mais une voix qui sait, une voix qui donne un ordre que les deux hommes, aveuglés par leur agressivité et leur envie de mal, tardent à reconnaître.
Merline est maintenant juste derrière celui qui agresse sa mère, blanche et aérienne, presque immatérielle. Elle n’a plus d’âge et a grandi tout à coup, comme si elle surgissait d’une autre dimension. Elle est une bulle, un bloc compact de toutes les forces qui lui ont été données!
L’homme se retourne un instant en ricanant :
–Je vais m’occuper de toi aussitôt après, fillette. Laisse-moi finir ta mère.
La tête de Jade a heurté le rétroviseur extérieur de la voiture et elle est presque inconsciente sous les mains qui la cherchent. Ambrose, lui, dans un brouillard, réalise que Merline ne porte plus ses lunettes et qu’un éclair bleu, comme un rayon laser, jaillit de son regard en plein dans le visage de l’homme qui vient de tourner la tête vers la voix. Celui-ci se fige alors, interloqué un moment, tandis que la main de Merline avance vers sa nuque et le soulève de terre pour le projeter en arrière avec violence, comme un vent d’ouragan.
Au bruit que fait le corps en retombant, l’agresseur d’Ambrose cesse de le frapper pour se retourner lui aussi, et il se trouve alors face à l’enfant. Il ne peut éviter la main tendue vers lui comme un broyeur impitoyable et une force inconnue lui brise les vertèbres cervicales avant même de réaliser ce qui lui arrive.
Les deux hommes gisent maintenant au sol, face contre terre, et Merline relève son père pour l’adosser contre la voiture dans laquelle elle porte Jade presque inconsciente.
–Je ne pense pas que tu pourras conduire, dit-elle. Donne-moi les clefs, je vais vous ramener.
Ambrose, que l’homme a frappé sur le larynx en lui paralysant momentanément les cordes vocales, ne s’étonne pas d’être soudain pris en charge par sa fille et de se retrouver à l’arrière de la voiture, Jade contre lui et Merline au volant. Elle n’a évidemment ni papiers, ni l’âge de conduire, mais Ambrose ne songe pas à ce ridicule détail. La voiture roule dans la nuit, ils sont hors de ce parking où ils laissent derrière eux les deux hommes inanimés, Merline prend soin d’eux, et un étrange sentiment de quiétude totale l’envahit à cet instant près de cette enfant de neuf ans qui est sa fille et qui vient de les sauver.
Il sait maintenant qu’elle n’est certainement pas la fillette qu’elle paraît être, et il se laisse aller contre le dossier en pensant qu’il sera bien temps d’en parler plus tard.
Merline panse leurs plaies avec habileté, les aide à se coucher en leur donnant à chacun un somnifère et, debout près de la fenêtre qui donne sur la nuit, veille jusqu’à ce qu’ils soient endormis.
Ils ne voient ni son visage, ni ses yeux. Merline n’a plus d’âge et songe à ce qu’elle doit leur dire.
Le lendemain, les journaux relatèrent l’étrange mort de deux voyous dans un parking, qui se seraient entretués avec une force peu commune, l’un d’eux ayant les vertèbres brisées, l’autre les deux bras écrasés comme s’il était passé sous un bulldozer!...